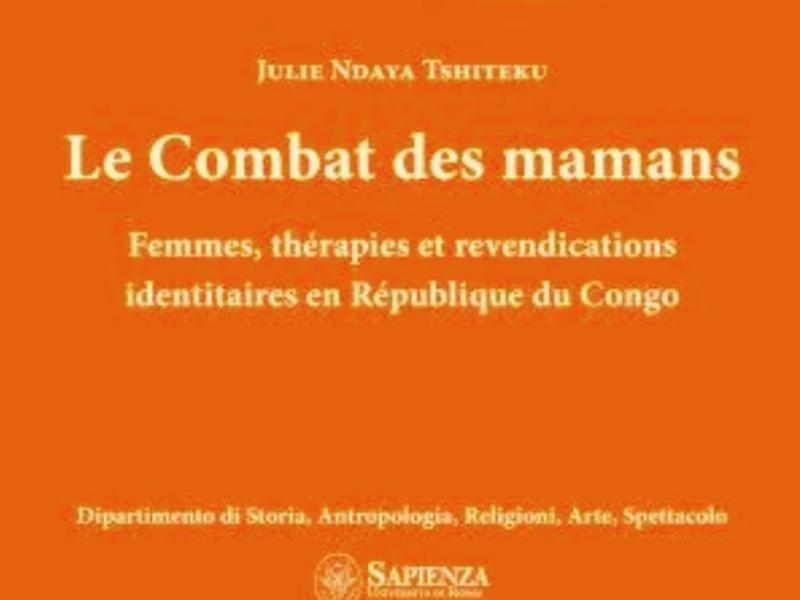
À l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science, le Desk Femme d'Actualité.cd a exploré le livre « Le Combat des mamans » de la professeure Julie Ndaya Tshiteku. Publié en octobre 2024, l'objectif de cet ouvrage est de mettre en lumière l'engagement des femmes scientifiques qui, par leur travail, contribuent à la transformation sociale et culturelle des communautés.
Ce livre de 112 pages propose une réflexion sur le rôle des pratiques religieuses en tant que technologies sociales, notamment dans la gestion des conflits sociaux et des tensions identitaires, qui sont souvent à l’origine de l’anomie dans la vie des individus.
Julie Ndaya Tshiteku, anthropologue et professeure ordinaire à l’Université de Kinshasa (UNIKIN), est une spécialiste des questions liées à la revendication identitaire des Congolais, tant en RDC qu’à l’étranger. Ses recherches se concentrent notamment sur les groupes religieux dirigés par des femmes et sur la manière dont ces groupes utilisent les pratiques religieuses pour initier des transformations sociales. Selon elle, ces « thérapies » proposées par ces leaders sont des technologies sociales visant à modifier les comportements ancrés dans les traditions et les coutumes.
Membre de la communauté de recherche du Centre d’Études Africaines de l’Université de Leiden (Pays-Bas) et chercheure associée au Centre International de Recherche et de Documentation sur les Traditions et les Langues Africaines (CERDOTOLA) au Cameroun, Julie Ndaya Tshiteku s’intéresse également aux enjeux de la mondialisation culturelle.
Elle analyse les interactions entre la République Démocratique du Congo, la Chine et la Corée, une dimension importante de ses recherches.
En plus de ses activités académiques, elle est rédactrice en chef de la revue Le Carrefour Congolais et est à l’origine du projet de création du centre Femmes, Christianismes et Développement, visant à approfondir les études sur les femmes et le christianisme en Afrique.
Dans ses recherches, la professeure Ndaya Tshiteku met également l’accent sur les méthodologies qualitatives qui permettent aux chercheurs autochtones de mener des études au sein de leurs propres communautés. Ces approches ont pour but d’encourager une recherche plus proche des réalités locales et des besoins des populations étudiées.
Nancy Clémence Tshimueneka



















