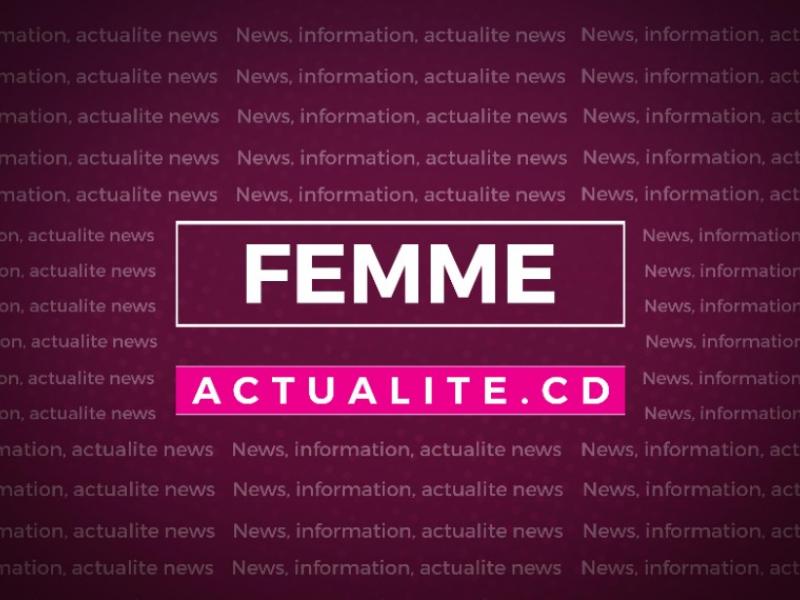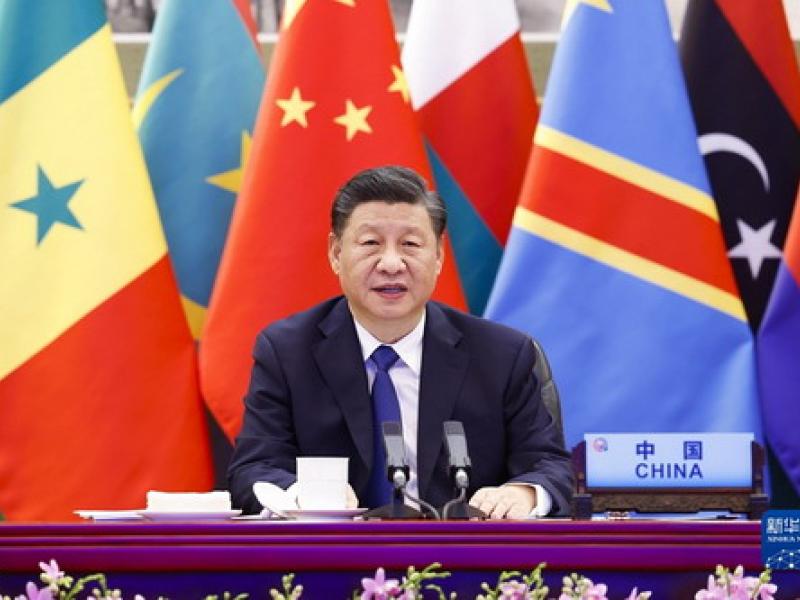Marcel H. K. Kapitene 1
À Pakadjuma, les autorités de la ville-province de Kinshasa ont posé un acte spectaculaire, et teinté de honte : démolir des constructions jugées « anarchiques » le long de l’emprise ferroviaire ; au nom de la relance du rail, de la sécurité et de la salubrité. L’opération est documentée, avec ses tensions immédiates et l’annonce d’un relogement vers Kinkole.
À Pakadjuma, comme dans toutes les cités informelles de la périphérie et du centre de Kinshasa, le problème n’est pas de contester l’existence d’un enjeu urbain réel, mais bien la pauvreté. L’emprise ferroviaire est une contrainte, la mobilité est un enjeu, les risques sanitaires sont graves. Mais le problème est ailleurs : on a traité un système social comme un obstacle matériel. On a confondu « corriger une carte » et gouverner une ville. On a tout simplement essayé de « déplacer » la honte qu’on ne supporte plus de regarder en face, en recourant à des méthodes beaucoup plus honteuses, brusques, brutales et on ne peut plus deshumanisantes.
Une ville vue de haut dans un vécue d’en bas
Pakadjuma n’est pas qu’un « bidonville » au sens descriptif. C’est une économie de survie, une géographie d’emplois minuscules et informels, une organisation de solidarités, une intelligence du risque. En langage académique, c’est un exemple presque didactique de ce que AbdouMaliq Simone appelle « les personnes comme infrastructure » : quand les réseaux, les arrangements et la coopération remplacent les systèmes formels absents. Ici, malgré eux, et avec la complicité de toute la communauté de Kinshasa, des gens abandonnés à leur triste sort, utilisent leurs corps, leurs forces physiques et leurs interactions sociales pour compenser l'absence ou le dysfonctionnement des infrastructures physiques traditionnelles
Or l’action publique a opéré comme si ce tissu n’existait pas. James C. Scott a décrit depuis longtemps ce réflexe : l’État cherche la « lisibilité » administrative, simplifie, standardise, rend l’objet gouvernable ; et, ce faisant, efface la connaissance locale qui faisait tenir l’ensemble. En simplifiant les règles, l'administration cherche à rendre l'objet gouvernable, souvent à travers des normes nationales (ou économiques !), au détriment des spécificités locales. Le bulldozer devient alors une solution parce qu’il est lisible. Mais ce qu’il détruit, lui, ne l’est pas. C’est tout un tissu social et anthropologique qui s’en retrouve détruit, contraint de se fondre dans une masse, dans les normes, entre les clous, et hors de tout repère.
On ne « déplace » pas un foyer comme un objet
Il faut nommer ce que la décision de l’administration urbaine de Kinshasa a sous-estimé : l’attachement au lieu, à l’emplacement, à soi, à l’autre. La littérature scientifique ne traite pas cela comme un sentiment vague, mais comme un mécanisme structurant : l’attachement articule affect, mémoire, identité, routines, et capacité d’agir. L'attachement au lieu est un lien cognitivo-émotionnel profond, unissant identité, mémoire et routines, agissant comme un repère stable malgré une précarité matérielle. Détruire ce lieu brise ces ancrages, entraînant des conséquences sociales et psychologiques négatives et perturbant la disposition d'agir des individus. Détruire brusquement Pakadjuma casse aussi des repères psychologiques et sociaux, même quand la matérialité du logement était précaire.
Sur le plan économique, la recherche sur les déplacements involontaires est encore plus nette : le risque central est l’aggravation de l’appauvrissement et de la déconnexion, via une chaîne de pertes sociales économiques inestimables. Cernea a formalisé ces risques et, surtout, les conditions de leur « renversement » : cela exige une stratégie explicite de reconstruction des moyens de subsistance, financée, séquencée, vérifiable. Sans capital d'amorçage ou filets de sécurité financiers, les populations délocalisés par force restent bloquées dans la survie. Cela implique des fonds débloqués sur le long terme pour couvrir la recapitalisation des actifs (bétail, outils, stocks).
Autrement dit : annoncer un relogement après coup n’est pas une politique de réinstallation. C’est un pansement. Même pas un correctif. C’est une contrainte à la précarité aggravée. Et c’est atroce. Et l’Etat n’est pas fait pour.
L’angle mort sanitaire
Les autorités urbaines de Kinshasa justifient aussi l’opération par la salubrité. Mais Pakadjuma était précisément documenté comme « hotspot » de choléra à Kinshasa, avec des barrières structurelles à l’élimination (eau, assainissement, confiance, capacités du système, pratiques). Malheureusement, un bulldozer ne traite aucune de ces variables ; il peut même, en disloquant les accès, aggraver temporairement l’exposition.
La santé publique, ici, plaide moins pour une destruction que pour une ingénierie : eau, assainissement, hygiène, gestion des déchets, drainage, et gouvernance de proximité. Sans cela, on déplace un risque, on ne le réduit pas.
La comparaison qui dérange
On entend souvent : « on évacue pour protéger ». C’est l’argument des villages déplacés dans les zones de conflit, en Ituri ou au Nord-Kivu : déplacer pour sauver. Mais l’expérience humanitaire montre que le déplacement non accompagné fabrique une vulnérabilité durable. Surtout, la protection ne se résume pas au mouvement, elle suppose des droits, des moyens, une réintégration. Si l'on se place dans un contexte humanitaire, social ou juridique, la protection est souvent réduite à tort à la simple mise en sécurité (le mouvement, l'évacuation). C’est le cadre légal. Sans statut juridique, l'individu reste dans une zone grise, vulnérable à l'exploitation (y compris sexuelle, même lorsqu’on essaie de l’en soustraire) et à l'arbitraire. La protection, c'est d'abord avoir le « droit d'avoir des droits », y compris celui de se choisir son « chez-soi » dans son propre pays. Car, malgré tout, la sécurité physique n'est rien sans l'accès à la santé, au logement, à l'éducation et à une autonomie financière. Les moyens transforment une survie passive en une vie digne.
On se le doit, mais Pakadjuma n’est pas Beni, et la violence n’est pas la même. La structure de l’erreur, elle, se ressemble : croire qu’un changement de lieu suffit à changer le destin. On ne peut « déplacer » sans « réintégrer ». Car, une protection est réussie quand elle permet à la personne de retrouver une place dans la société (que ce soit par le retour volontaire, l'intégration locale ou la réinstallation). C'est la fin de l'exceptionnalité et le retour à la normalité citoyenne. Kinshasa n’y a pas pensé pour nos compatriotes de Pakadjuma. On a préféré cacher notre honte collective, en jouant sur un semblant de pudeur, mal cachée derrière les arguments urbanistiques et politiques.
Ce qui aurait dû être fait
Les standards existent. L’ONU a publié des principes et directives sur les expulsions liées au développement : consultation réelle, exploration d’alternatives, préavis, recours, compensation adéquate, relogement convenable, attention aux groupes vulnérables.
Les standards internationaux de l'ONU concernant les expulsions liées au développement exigent le respect rigoureux des droits humains. On ne devrait pas se cacher derrière l’ordre public, en laissant faire l’arbitraire. Car, le quotidien inhumain de Pakadjuma n’oblige pas la déshumanisation par les pouvoirs publics. Et une « consultation réelle » ne peut être remplacée par une simple séance d'information, empêchant les populations ciblées d'influencer réellement le tracé ou la nature du projet de déguerpissements.
La Banque mondiale, via l’ESS5, formalise la même exigence opérationnelle : éviter et minimiser le déplacement, et, s’il est inévitable, restaurer les moyens de subsistance et traiter aussi le déplacement économique (perte d’activité) ; pas seulement le déplacement physique.
UN-Habitat, enfin, a construit une doctrine d’« upgrading participatif » des quartiers informels : améliorer in situ, co-produire, phaser, plutôt que « nettoyer » puis improviser.
Dans une cité de la taille de Pakadjuma, une reconversion et une sécurisation des revenus sur le temps long devraient précéder toute relocalisation massive. Non par romantisme, mais parce que c’est la seule manière d’éviter que la ville fabrique, par sa propre main, une nouvelle précarité.
Relancer le rail est légitime, si pas une nécessité. Ce qui ne l’est pas, c’est de croire que la ville se « débarrasse » d’elle-même, et à coup de force. Pakadjuma c’est Kinshasa.
___________
- Economiste et Actuaire, bénévole au sein de Pakadjuma Résilience ASBL. Militant de la LUCHA.