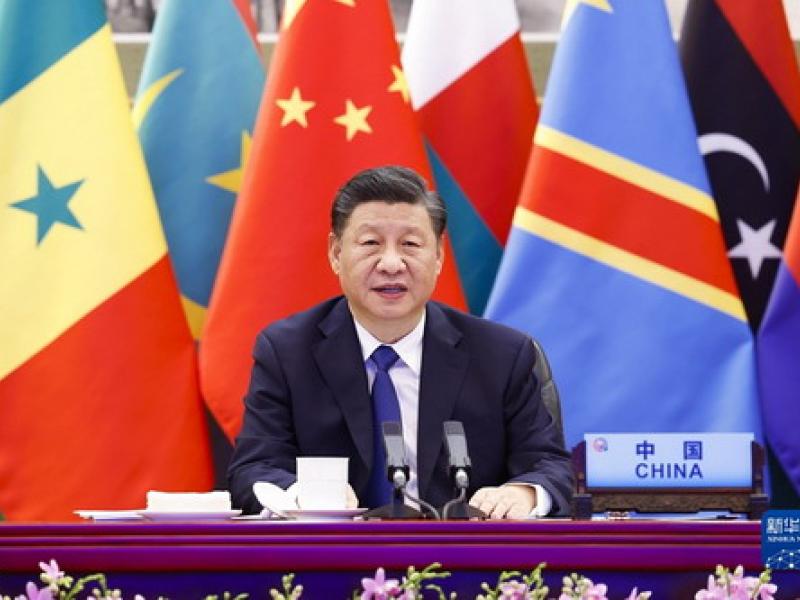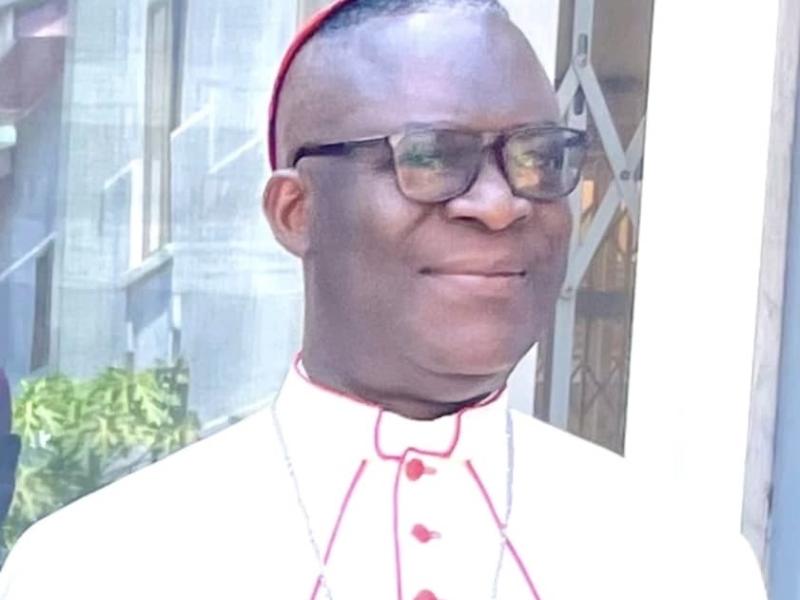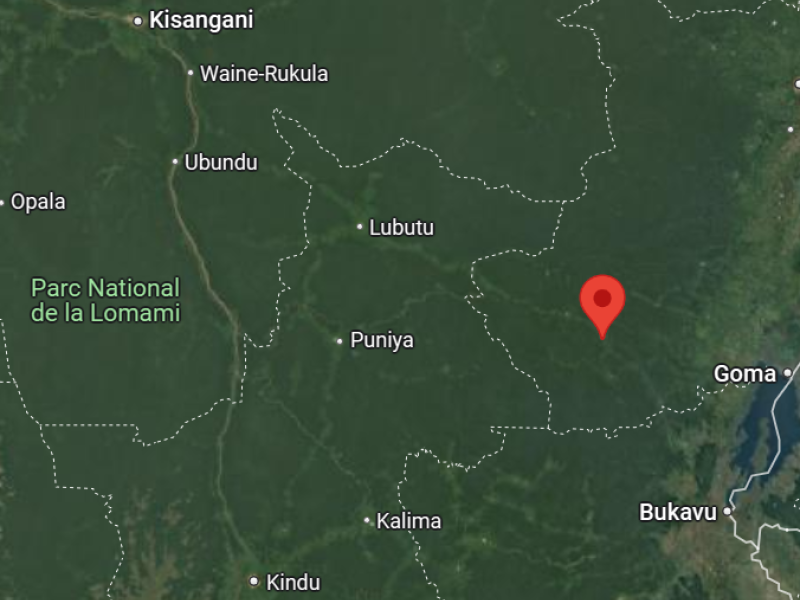Depuis quelques jours, certains télé-juristes et juristes de dimanche se sont plus, sans arguments de fait et de droit fondés, à remettre en cause tant la légalité que la légitimité de la majeure partie de l’actuelle composition de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo.
Dans leur gymnastique fortuite, ils se fondent sur l’article 8 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de ladite Cour qui dispose : « Le membre delaCour nomméenremplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant terme achève le mandat de ce dernier. Il peut être nommé pour un autre mandat s’il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de trois ans ».
Il est clair que se fondant uniquement sur cette disposition, leur raisonnement consiste à considérer que tous les juges nommés en remplacement de ceux de la promotion 2015 ayant exercé moins de neuf ans de mandat sont dans la situation de suppléance. En effet, si on se fie à leur point de vue qui frise l’inanité, cela suppose qu'en 2024 la Cour devait être complètement renouvelée par la nomination de neuf nouveaux juges.
Il ne fait pas de doute que les tenants de cette tendance hérétique ont lamentablement ignoré, intentionnellement ou non, d’autres dispositions pertinentes et la ratio legis de la loi qui concourent à la détermination de la durée de mandat des juges constitutionnels congolais.
En effet, il faut d’abord rappeler le principe de base qui, en vertu de l’article 158 alinéa 3 et 4 de la Constitution et de l’article 6 de la loi organique pré-rappelée, veut que le mandat des membres de la Cour est de neuf ans non renouvelable. En outre, il est prévu un renouvellement triennal d'un tiers des membres de la Cour à travers un tirage au sort, s’agissant particulièrement et logiquement de la première composition de 2015.
Il sied de préciser que ce mécanisme de renouvellement de la juridiction constitutionnelle qui est prévu dans la quasi-totalité des pays du système romano germanique ou civiliste a pour mission d’assurer de manière progressive le transfert de l’expertise d’une génération de la Cour à une autre et sans accroc, ainsi que de consolider la jurisprudence de la Cour, sans quoi on aboutirait à un éternel recommencement. En d’autres termes, renouveler l’ensemble de la Cour constitutionnelle après un mandat collectif de neuf ans et recruter neuf autre juges d’un seul coup fera courir le risque d’écrouler tout l’édifice jurisprudentiel (Voir Cihunda et Kapinga, 2017, p.121). Ces vertus qui permettent en même temps d’assurer la continuité constitutionnelle de la juridiction échappent à l’autonomie des membres de ceclub de confusionnistes.
Les modalités pratiques de ce principe de renouvellement triennal et tertiaire devraient être appréciées selon qu'il s'agit de l'hypothèse d'un renouvellement par tirage au sort ou celle d'un renouvellement en dehors de tirage au sort.
Dans la première hypothèse, signalons que le législateur avait institué une exception tendant à la différenciation des mandats des juges constitutionnels, en particulier ceux nommés en 2015. A cet effet, l’article 116 de la loi organique précitée, jusqu'ici ignoré par certains juristes faussaires, prévoit pertinemment que les membres de la première formation de la Cour tirés au sort auront, à titre exceptionnel, respectivement un mandat de trois, six et neuf ans. Cette disposition a d'ailleurs été reprise dans d'autres pays africains, dont la guinée dans sa Constitution de 2020.
L’un des effets juridiques largement attachés au renouvellement de mandat par ces procédés consiste en ce que le membre de la Cour désigné dans ce contexte exerce un nouveau mandat qui lui est propre (Voir dans ce sens Ngusu Masuta, 2021, p.88). Il est donc clair que les juges nommés au bout de trois ans, soit après 2018, commencent un nouveau cycle d’un mandat de neuf ans, la logique étant que les juges qui sont débarqués de la Cour à la fin de cette période ont terminé leur mandat de trois ans, d'où l'inopportunité d'une quelconque suppléance pour un mandat déjà à terme. Il en est de même pour ceux nommé à l’issue de six ans ainsi que de neuf ans.
Quant à la seconde hypothèse, il importe de retenir que l'effet juridique sus-indiqué vaut également pour les juges nommés dans les circonstances autres que le tirage au sort sans toutefois que leur soient imposées les dispositions de l'article 8 de la loi organique tant vanté à tort, notamment par ceux qui en revendiquent indignement la paternité.
En effet, l’application de cet article devrait être vue comme inopérante car manifestement inconstitutionnelle en ce qu'elle laisse entrevoir la possibilité d'un double mandat ou d'un mandat de plus de neuf ans. Cela ressort du forcing inséré par le législateur, malheureusement induit en erreur, qui envisage qu'un membre de la Cour qui aurait assuré une quelconque suppléance pendant au moins deux ans est éligible à un nouveau mandat de neuf ans.
L'on devrait garder à l'esprit que ce n'est pas par ce qu'un tirage au sort n'a pas été organisé lors d'un renouvellement de la Cour que cela doive impliquer automatiquement la suppléance de mandat plutôt que la nouveauté. Par essence, le tirage au sort qui a été prévu en vue d'éviter toute forme d'arbitraire lors du renouvellement de la Cour ne sert qu'à identifier les trois membres de la Cour appelés à être remplacés. Si on se retrouve dans des circonstances exceptionnelles, comme la vacance de trois postes de juges constitutionnels pour des raisons diverses, alors le renouvellement peut s'opérer sans qu'on ait besoin de tirer au sort ceux dont la vacance est déjà opérante. Il est aussi vrai que tous les renouvellements à opérer après les neuf ans de l'existence de la Cour, soit à partir de 2024, ne sauront se faire par tirage au sort. Dans tous les cas, il est vivement souhaitable qu’une interprétation d'autorité soit donnée par la Cour elle-même au sujet des dispositions de l'article 158 de la Constitution en relation avec celles de l'article 8 de la loi organique pour s'enconvaincre.
Mais en attendant, il aurait été toutefois pertinent, pour éviter les confusions interprétatives, que les ordonnances de nomination des membres de la Cour puissent préciser la nature nouvelle ou continuelle du mandat de chacun comme c'est le cas notamment en Algérie (Lire utilement le Décret présidentiel n° 25-01 du 5 Rajab 1446 correspondant au 5 janvier 2025 portant désignation de deux (2) membres de la Cour Constitutionnelle). Autrement dit, on aurait précisé la durée du mandat de chaque juge dans l'acte de nomination (Voir dans ce sens Balingene, 2018, p.151). Sans cette précision, le caractère nouveau du mandat devrait l'emporter sur toutes autres considérations.
Au regard de ces postulats, on peut remarquer en l'occurrence que, d'un côté, compte tenu des renouvellements de 2018 et de 2022 intervenus à la suite des tirages au sort, les juges nommés en ces périodes devaient en toute logique assurer un mandat de neuf ans.
En effet, en lisant le préambule de l’Ordonnance n°18/038 du 14 mai 2018 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle tiré du Journal officiel, il est renseigné l'existence des procès-verbaux de tirage au sort du 9 avril 2018 qui ont été pris en compte (Voir le paragraphe 3 du préambule de ladite ordonnance), contrairement aux affirmations des communs de mortel pour qui consulter le Journal officiel relève du grand hasard, se contentant des affirmations de la rue.
Il en est de même de l’Ordonnance n° 22/062 du 14 juin 2022 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle (Voir le paragraphe 6 de ladite ordonnance) qui fait mention des procès-verbaux de tirage au sort du 10 mai 2022 nonobstant les critiques en s'en étaient suivies.
C’est donc faux et archifaux de considérer que les juges NKULU, BOKONA, LUMU, JALAR et MANDZA qui ont été nommés en vertu de ces deux ordonnances soient hors mandat. En réalité, leur mandat de neuf ans respectivement commencé en 2018 et en 2022, selon le cas, continue de courir valablement jusqu'à ce jour.
Dans un autre registre, les juges KAMULETA et KALUME nommés à la suite d'un autre renouvellement de la Cour en 2020 consécutif à certaines circonstances exceptionnelles étaient aussi fondés à exercer un mandat de neuf ans. Eu égard à l'année de leur nomination et par ricochet celle du début de leurs prises de fonctions, il est sans conteste que leurs mandats sont toujours en cours.
A la lumière de tout ce qui précède, il est sans conteste que l'actuelle composition de la Cour est légalement et légitimement en plein mandat, n'en déplaise à ceux qui en veulent à cette composition qui s'est souvent distinguée par sa maîtrise de la justice constitutionnelle et son seul leitmotiv de promouvoir l'État de droit dans notre pays.
Maître Joël Bole