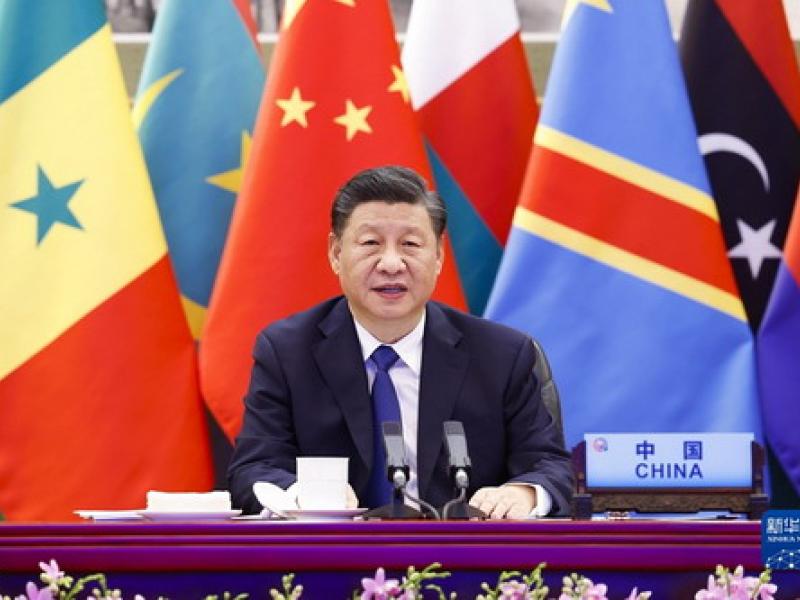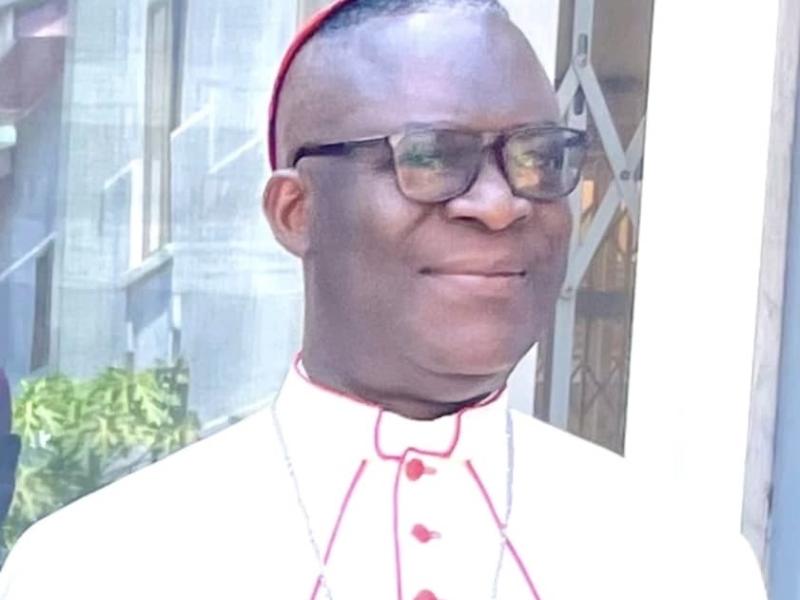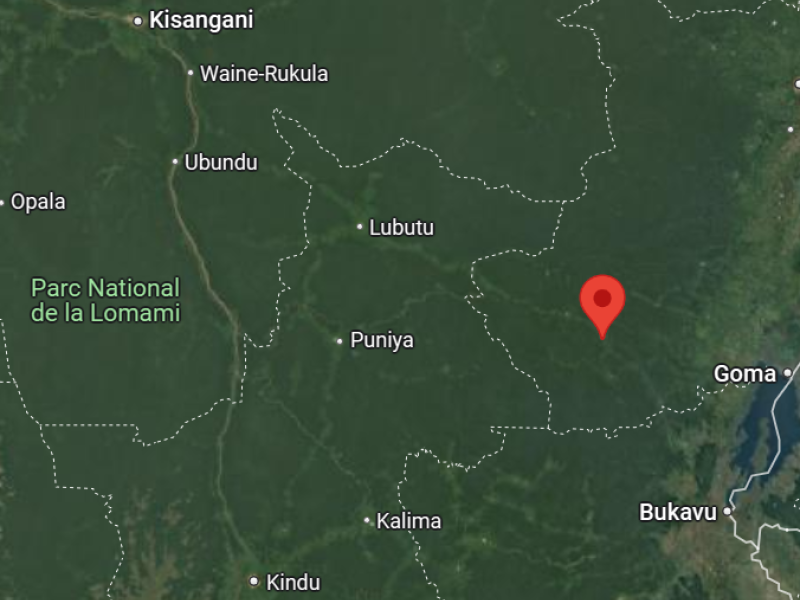Le 10 octobre 2025, à Oslo, le Comité Nobel norvégien a pris une décision qui a eu des répercussions bien au-delà des murs de sa salle : attribuer le prix Nobel de la paix à Maria Corina Machado, figure inflexible de l'opposition démocratique vénézuélienne. Il ne s'agissait pas seulement d'une distinction personnelle, mais d'un signal géopolitique, d'une déclaration morale et d'un recentrage de l'attention mondiale sur une région longtemps prise au piège entre dérive autoritaire et aspiration démocratique. Cette décision transcende les clivages partisans et le symbolisme. Elle témoigne des profonds bouleversements en cours en Amérique latine et du pouvoir silencieux de la résistance civique face à la force brute.
Un prix forgé dans le silence, la répression et l'espoir rebelle
Maria Corina Machado n'est pas une leader de l'opposition ordinaire. Elle ne se définit pas uniquement par son ambition électorale, mais aussi par sa résistance morale face à la répression étatique. Après des années de surveillance, d'intimidation et d'exil politique forcé dans son propre pays, elle a refusé l'exil à l'étranger. Elle est restée. Elle a pris la parole. Elle a uni les forces.
Dans un pays où les institutions démocratiques ont été systématiquement démantelées, la société civile réduite au silence et plus de 7 millions de citoyens contraints à l'exil, Machado a tenu bon, insistant sur une transition non violente, résistant à la tentation de la rébellion armée et affirmant que la démocratie doit être reconquise, et non imposée.
Son rôle central dans l'unification d'une opposition profondément fragmentée, autrefois marquée par la cooptation et les rivalités internes, n'était pas un simple exploit stratégique. Il s'agissait d'un acte politique fondateur. Sa victoire écrasante aux primaires de 2023 (plus de 90 % des voix de 3 millions de citoyens) a marqué non seulement une légitimité politique, mais aussi un référendum civil contre la tyrannie. Elle est devenue plus qu'une candidate, elle est devenue le miroir de la défiance nationale.
Une boussole morale pour l'Amérique latine
Le choix du Comité Nobel résonne à travers un continent en pleine mutation. Le Venezuela, autrefois une démocratie riche en pétrole, est devenu l'épicentre de l'effondrement régional : corruption, hyperinflation, catastrophe humanitaire et montée en puissance de la consolidation autoritaire. L'État, pris en otage par une élite militarisée et soutenu par des puissances étrangères, est devenu à la fois un exemple à ne pas suivre et un vide stratégique.
Mais en décernant ce prix à Machado, le Comité a envoyé un message non seulement à Caracas, mais à tout l'hémisphère : la résistance démocratique pacifique n'est pas naïve, elle est noble, nécessaire et mérite l'attention du monde entier.
Ce prix Nobel n'est pas un chapitre final, mais un levier, un acte symbolique de solidarité qui rappelle à l'Amérique latine que les transitions pacifiques, aussi lentes soient-elles, peuvent encore être célébrées et amplifiées.
Un courant sous-jacent mondial : Oslo, Caracas et Washington
Ce prix n'a pas été unanimement applaudi. À Washington, la Maison Blanche a accusé le comité Nobel de « privilégier la politique plutôt que la paix », déplorant le choix de Machado plutôt que celui de l'ancien président Donald Trump, qui espérait que les récents efforts de cessez-le-feu négociés par les États-Unis à Gaza lui vaudraient cette distinction.
Cette critique souligne toutefois ce que le prix Nobel de la paix a toujours risqué de devenir : un trophée géopolitique. En récompensant Machado, le comité a délibérément pris du recul par rapport à l'esprit d'Alfred Nobel, en récompensant non pas les puissants, mais les courageux ; non pas les négociateurs, mais les dissidents.
Le contraste est révélateur. Machado ne commande aucune armée. Elle ne représente aucun État. Elle ne dispose d'aucun appareil diplomatique. Et pourtant, sa résistance a fait basculer le poids politique de son pays.
Un moment décisif dans le paysage latino-américain
Vu sous un angle plus profond, presque géologique, ce prix Nobel reflète plus qu'un triomphe personnel. Il marque un changement continental dans la lutte entre l'autoritarisme et la démocratie. Dans des pays comme le Nicaragua, Cuba et le Venezuela, les régimes autoritaires sont de plus en plus exposés, incapables d'apporter prospérité, légitimité ou espoir.
Dans leur sillage, une nouvelle génération d'opposition, souvent menée par des femmes, ancrée dans la société civile et non armée, est en train d'émerger. Machado, surnommée « La Libertadora » par ses partisans, rejoint une lignée symbolique qui remonte à Bolívar, en passant par les dissidents latino-américains du XXe siècle, et qui s'incarne aujourd'hui dans une femme qui poursuit son combat non pas depuis l'exil, mais au sein même du système qui cherche à la réduire au silence.
Plus qu'un prix : une condamnation morale de la tyrannie
Le prix Nobel de la paix 2025 est donc moins un honneur individuel qu'un verdict collectif. Il s'agit d'une reconnaissance de la persévérance démocratique, d'un avertissement aux autocrates et d'un phare pour les désabusés d'Amérique latine et d'ailleurs.
Au niveau régional, c'est un appel à la vigilance : les dictatures modernes ne tombent pas sous les bombes, mais sous le poids de la vérité, sous le poids de l'accumulation progressive du courage, de l'unité et de la clarté morale. Et au niveau mondial, cela nous rappelle que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais la présence de la justice.
Dans un monde de plus en plus fasciné par les effets théâtraux du pouvoir, le prix Nobel de la paix décerné à Maria Corina Machado est un acte radical de reconnaissance : non pas de la puissance, mais du sens.
(Professor of International Affairs, Envoy for Multilateral Diplomacy, and Senior Advisor. The laureate of the 2024 Nelson Mandela International Peace Prize.Global Vice-Chair & High Rep. /UNAccc)
Traduit et édité par le Doctorant Ghislain Kabumba R. Baderha (Chercheur & Consultant Indépendant).