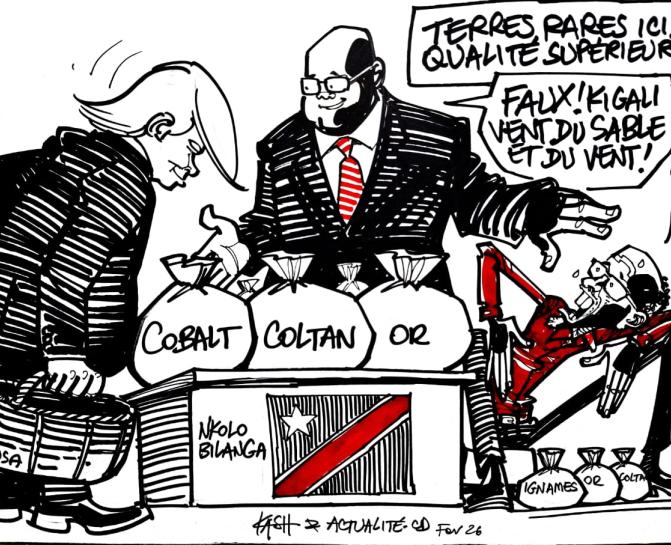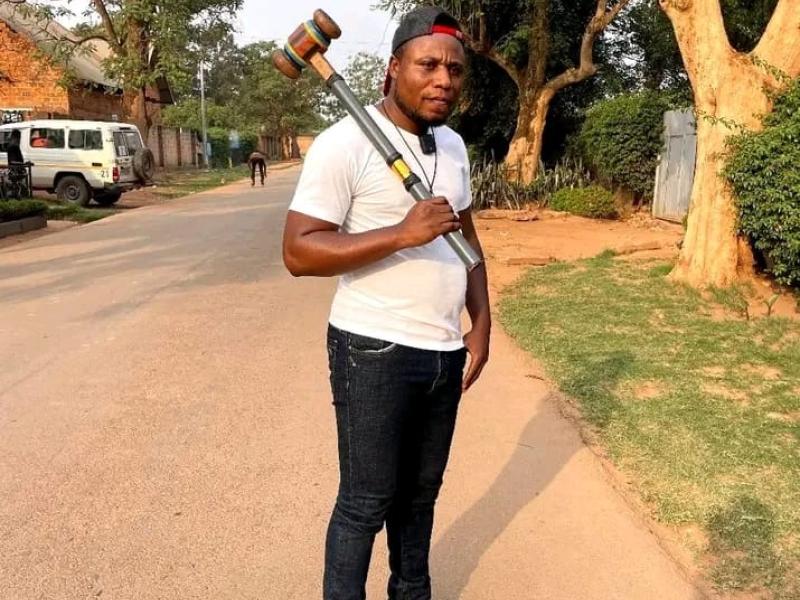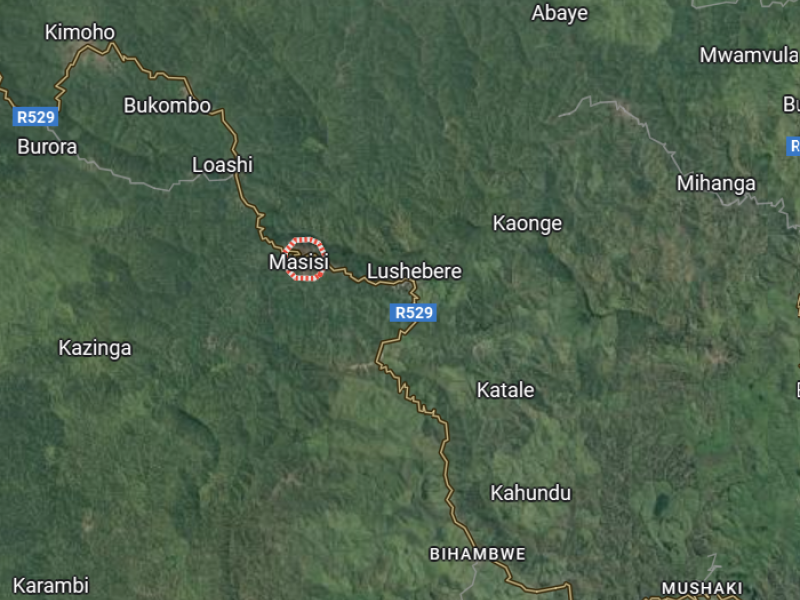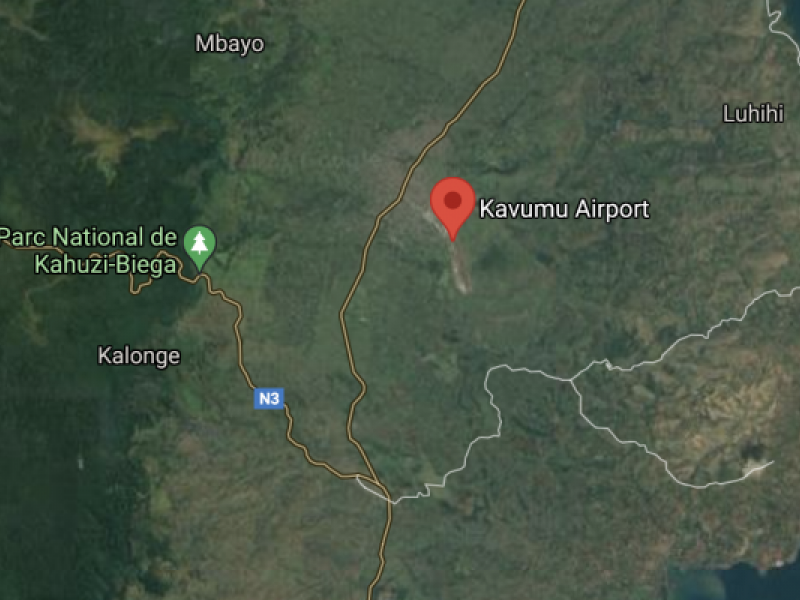Les étudiants du département de design de l'Académie des Beaux-Arts ont procédé, jeudi 21 août, à l'exposition de leurs œuvres d'art lors de l'événement dénommé "Made in Congo". À travers cette exhibition, l'école de la culture et de l'innovation artistique congolaise a mis en lumière la richesse, la créativité et le savoir-faire congolais au moyen d'œuvres originales, tirées de la tradition ancestrale africaine et adaptées à la modernité.
"Cette chaise, je l'ai appelée kimia (repos en français). Je me suis inspiré de la chaise traditionnelle. Je suis parti d'un modèle ancien pour montrer sa résilience à travers le temps", explique Mimbole, étudiant en deuxième licence, en désignant une chaise essentiellement en bois massif.
Une chaise qui n'est pas simplement une chaise, car à travers elle, l'artiste raconte l'histoire de la culture congolaise. Il l'a nommée "Kiti kwala", terme kinkongo désignant la chaise traditionnelle de repos souvent utilisée par les vieillards.
La plupart des artistes ont été marqués par l’idée de préconiser l'interaction entre le passé et le présent. Un pic d'émotion pour rappeler à la communauté leurs racines, source d'inspiration pour toute innovation.
Fifi Kikangala Omoyi, enseignante en design, gère "La collection Kuba", un arsenal de fabrication d'objets d'art inspirés de l'art royal Kuba. Devant elle se trouvent un tabouret et une table, couverts d'un tapis kuba, entièrement constitués de soie tissée.
"On consomme beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur. Il est donc temps de réveiller les consciences sur la richesse de notre patrimoine culturel", s'indigne-t-elle.

L'art comme outil de cohésion sociale
En recourant à la pensée ancestrale, les étudiants ne se contentent pas seulement de remémorer l'art ancestral. Ils le perpétuent comme une force intemporelle, capable de résoudre les maux d'aujourd'hui. Derrière chaque œuvre se cache un appel ou une solution à un problème de la société. De l'appel à l'unité familiale au vivre-ensemble entre les communautés, chaque œuvre reflète une philosophie de la vie, qu'elle tente d'insuffler à ses utilisateurs.
Yann Kimbamba, étudiant, utilise du symbolisme pour rappeler "la communion entre les peuples", qu'il estime "perdue aujourd'hui". Il est l'auteur du concept "Mboka", un mot lingala qui signifie "pays" ou "village", selon les cas.
"En parlant de Mboka, j'ai créé une table pour évoquer l'harmonie, la convivialité, l'unicité et l'identité culturelle. Le thème Mboka représente un village, une nation, un peuple duquel reposent plusieurs tribus et coutumes", affirme-t-il.
Pour accorder l'acte à la parole, Yann Kimbamba a créé la table "Mboka", sur laquelle sont repris des motifs triangulaires que l'on retrouve sur des masques dans la majorité des cultures congolaises. Ces motifs divisent la table en quatre secteurs, représentant les quatre langues nationales de la RDC.
"Mboka n'est pas qu'un simple meuble ; c'est une invitation à célébrer la culture, les liens familiaux et l'importance de la communauté. En réunissant les gens autour de cette table, on perpétue les traditions et on renforce les liens sociaux, incarnant ainsi l'esprit du 'Mboka', la case africaine du bien vivre", souligne-t-il.
Mulunda Ngalula et Mimbole, tous étudiants en deuxième licence, utilisent le syncrétisme en rassemblant les idées venues de plusieurs cultures pour les faire cohabiter à travers une seule invention.
"L'inspiration de cette œuvre, c'est le masque 'Bwa' du Burkina Faso. Ce masque est utilisé dans les cérémonies funéraires. Il est porté par un homme ou une femme dans le but d'honorer le défunt et de l'accompagner dans son voyage vers l'au-delà", explique Ngalula Mulunda.
En montrant une table pliante sur laquelle était posée une statue de la Vierge Marie transportant le Christ, une statue de Bouddha et des statues africaines, l'artiste designer précise les fondements de sa pensée.
"Mon objectif était de ramener ce masque vers une reconnaissance internationale. C'est ainsi que j'ai inventé la table Themid Ethia (mot emprunté du grec, qui signifie Toujours avec moi). Cette table est utilisable par les personnes issues de chaque culture et de toutes les religions. Les différents objets de culte y sont repris pour montrer que mon invention n'appartient pas à une seule culture", ajoute-t-il.
À côté de Ngalula se trouve Mimbole, étudiant et auteur du concept "Mbonda ya muinda" (tambour de lumière), présenté lors de son exposition. En s'inspirant de la lanterne asiatique utilisée en Chine et au Japon, il a fabriqué une lampe en combinant la soie et les roseaux, question de faire cohabiter les deux concepts.
Redonner vie à l'écologie
Actuellement, le design n’est pas du reste dans les enjeux environnementaux. Face à la crise climatique, à l'épuisement des ressources et à la surconsommation, les étudiants créateurs se sont invités à repenser leurs choix en privilégiant le recyclage de matériaux locaux, parfois négligés et peu transformés.
Kahasha Ma Joie travaille depuis des années sur la noix de coco. Elle a remarqué que la coque de noix de coco est souvent perçue comme un simple résidu. Pourtant, observe-t-elle, cette coque cache un potentiel esthétique et fonctionnel remarquable. Dure, résistante et naturellement texturée, elle peut se transformer entre les mains d'artisans en objets uniques. En retouchant ses formes, elle a ressorti de nouvelles utilisations de cette denrée négligée.
"J'ai réalisé un menu qui est rassemblé sur un seul plat. Dans ce nouveau menu, la coque peut servir d'assiette et de verre. Elle peut aussi servir d'objet de décoration pour embellir la maison, dans certaines situations", déclare-t-elle.
Fifi Kinkangala, déjà conceptrice de la collection Kuba, gère aussi la "collection Mbila". Une collection qui récupère les branches de palmiers, les traite et les transforme en meubles de décoration pour maisons et bureaux.
Aussi vaste que soit le patrimoine culturel congolais, il souffre d'un problème de financement et d'intérêt, remarque le Pr Jean-Pierre Tunda. Il invite les autorités et la population à prendre conscience de la richesse du patrimoine culturel afin de le sublimer.
Mbaya Honoré, stagiaire Unisic