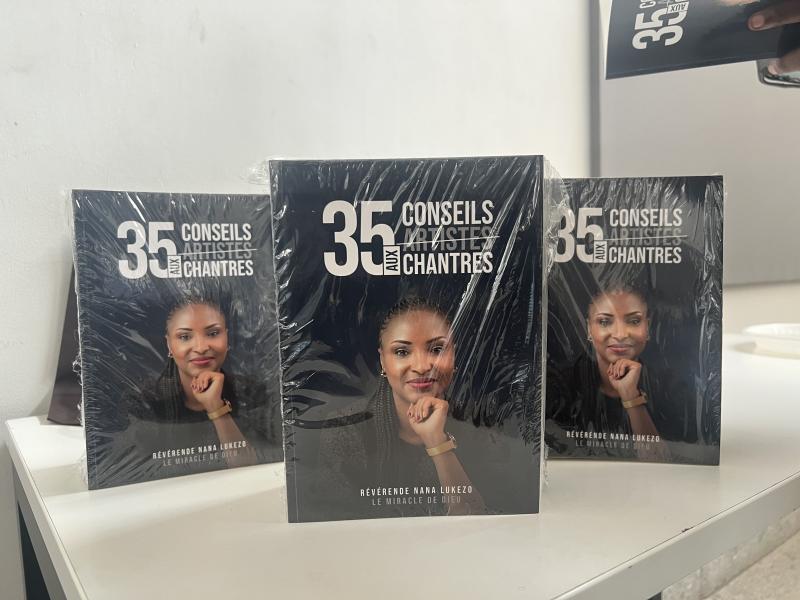Ce vendredi 11 juillet, un débat citoyen s’est tenu au Centre d'Études pour l'Action Sociale (CEPAS), dans la commune de la Gombe. Organisé conjointement par le réseau Pona Congo et la Synergie pour la Transparence des Processus de Paix (STP), cet échange a tourné autour du thème : "Différents processus de paix : Et le peuple dans tout ça ?".
L’événement a réuni des universitaires, des responsables religieux, des figures politiques, ou encore des membres de la société civile, avec pour objectif d’analyser les diverses initiatives de paix en cours en République Démocratique du Congo, tout en mettant en lumière la nécessité d’une implication plus active de la population.
En ouverture, le coordonnateur du réseau Pona Congo, Charis Basoko, a délivré un mot d’accueil prononcé au nom du père Alain Nzadi. Il a insisté sur la nécessité de « réfléchir librement pour agir efficacement », appelant à un changement de paradigme : celui d’« Impliquer le peuple, intéresser le peuple dans tout ce qui se fait en son nom. Car ce qui se fait sans ce peuple risque de ne pas impliquer ce peuple ». Son adresse est vue comme une invitation claire à tous les acteurs à s'approprier ces processus pour l'avenir du pays et de ses enfants.
Une lecture technique et diplomatique des processus en cours
La première intervention, celle du professeur Tshibangu Kalala a dressé un état des lieux des processus de paix en cours, notamment ceux de Luanda, Nairobi, Doha et Washington. Il a souligné les difficultés d’aboutissement de certains, et les lenteurs des autres ; citant par exemples le boycott du président rwandais au processus de Luanda ou l’essoufflement du processus de Nairobi piloté par le l’ancien président Kényan, Uhuru Kenyatta. Il a mis en lumière la complexité d’un système multi-acteurs où plusieurs initiatives peinent à s’articuler.
Le professeur Tshibangu Kalala a ensuite détaillé l’accord de Washington signé le 27 juin 2025, sous l’égide des États-Unis, composé de 37 chapitres, en soulignant six axes majeurs à savoir : l’intégrité territoriale et la cessation des combats, le désarmement et la réintégration individualisée des combattant, le mécanismes conjoints de sécurité, le retour des réfugiés et déplacés internes, le soutien au mandat de la MONUSCO et l’application de la résolution 2773, ainsi que le cadre d’intégration économique régionale, à déployer dans un délai de 90 jours.
Le sixième chapitre, relatif au cadre d'intégration économique régionale, a particulièrement retenu l'attention. Le Professeur Kalala a souligné que l'enjeu principal de la guerre « est la prédation des ressources minières », reprenant la théorie d'Henry Kissinger. Il a martelé qu'il est impossible de résoudre le conflit sans s'attaquer à la "prédation des ressources minières" et à la "clarification des chaînes d'approvisionnement", en lien avec la "mobilisation des ressources par la violence". Ce cadre économique devra aboutir, à en croire ses mots, à un accord complémentaire à l'accord de Washington.
Le dialogue comme constante historique
L’ancien ministre et député Thomas Luhaka Losendjola a ensuite pris la parole pour une analyse historique des défis et perspectives du dialogue comme réponse aux crises politiques et à la violence armée. Adoptant une approche diachronique, il a analysé trois grandes crises politiques aux quelles la RDC a fait face : la crise post-indépendance (1960-62), la guerre de 80 jours (1977) et la crise de 1998.
À travers ces épisodes, il a démontré que les dialogues politiques, notamment celui de Tananarive, de Lovanium, de Lusaka, ou encore de Sun City, ont toujours servi de levier pour restaurer une forme de stabilité. Il a identifié trois causes récurrentes aux crises congolaises, dont : la confiscation du pouvoir politique par une élite minoritaire, la gestion patrimoniale de l’Etat, ainsi que le clientélisme et l’incompétence dans la gestion publique.
Thomas Luhaka a proposé deux pistes pour une sortie durable de crise : une gouvernance géopolitique équilibrée et un leadership cohésif, à l’image de Patrice Lumumba, capable de transcender l’ethnicité, les partis et les appartenances tribales.
Plaidoyer pour un pacte social inclusif
Le Secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Nshole, a recentré le débat sur la profondeur des causes internes des conflits, souvent ignorées par les accords internationaux. Selon lui, ni l’accord de Washington, ni les autres processus actuels ne prennent en compte ces éléments cruciaux.
C’est dans cette optique qu’il a présenté le Pacte social pour la paix, une initiative lancée conjointement par les deux grandes Églises (catholique et protestante), le 25 décembre 2025, jour de Noël « symbolisant la naissance du prince de paix Jésus-Christ ».
Ce pacte vise à répondre aux problématiques internes du pays à travers quatre axes de réflexion : la sécurité et défense, la gouvernance politique et économique, la cohésion sociale, et la gouvernance inclusive.
Il s’agira de produire des feuilles de route concrètes avec des experts et des scientifiques, pour influencer les décisions politiques. Le pacte social, selon Mgr Nshole, n’est pas un document figé, mais une construction collective fondée sur un consensus national, loin des logiques diplomatiques traditionnelles.
Le débat s'est ensuite ouvert, avec des contributions de personnalités comme du président de l’Ecidé, Martin Fayulu et du Professeur Oumar Nassefou, ainsi que des échanges fructueux entre les participants et les panelistes.
Ce débat citoyen a permis d’éclairer les enjeux multiples, complexes et imbriqués qui entourent la paix en RDC. De la diplomatie multilatérale à l’action communautaire, en passant par l’analyse historique et la réflexion spirituelle, les intervenants ont souligné l’urgence d’inclure le peuple au cœur des discussions. Une paix sans peuple est une paix sans socle.
James Mutuba