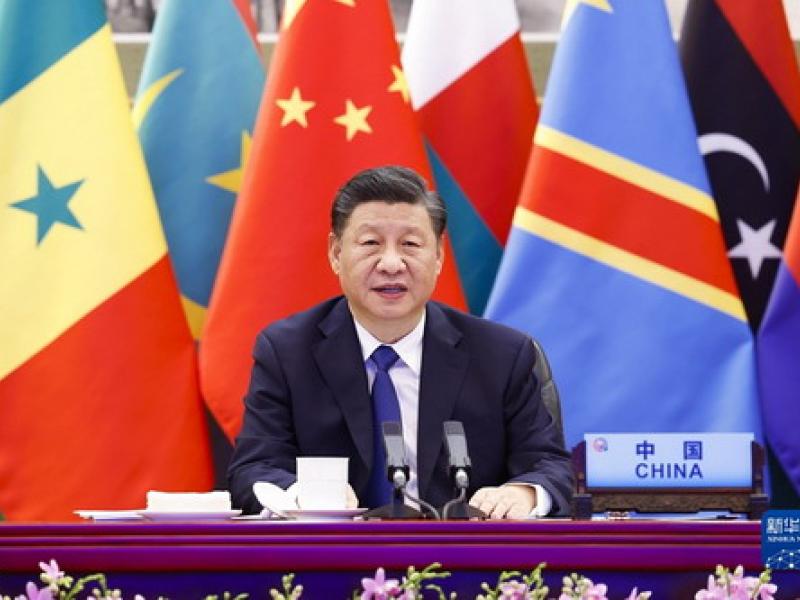Par Dagmar Dirkx et Hugues Makaba Ntoto (texte traduit par Charlotte Van Hooijdonk)
Nous avons oublié de le mentionner.
Lorsque le roi et l’Etat se taisent, le citoyen parle à leur place. En 2019, le concours d’écriture Pardon est un début partait à la recherche des excuses belges les plus appropriées pour le passé colonial. Mais une telle excuse est-elle accomplie sans réplique ? Dagmar Dirkx, lauréate du concours, et Hugues Makaba Ntoto, rédacteur de rekto:verso, répondent par une lettre critique.
Voici la lettre originale :
A tous les Congolais, Rwandais et Burundais, qu’ils soient au Congo, au Rwanda, au Burundi, ou en Belgique,
‘Qui a la liberté d’oublier ?’ est une citation du film Aphasia (2019) de l’artiste serbe Jelena Jureša. L’aphasie est un trouble du langage dû aux suites d’une lésion cérébrale. Celui ou celle qui souffre d’aphasie, bégaye et éprouve des difficultés à formuler des phrases. Apparemment, c’est également en bégayant que nous présentons nos excuses pour notre passé colonial. Selon Jureša, le peuple belge souffre d’une aphasie collective lorsqu’il est question de mettre des mots sur l’héritage colonial.
Jusqu’à présent, nos excuses se faisaient de manière hésitante. Notre gouvernement ne commémorait que quelques victimes, et jamais le peuple entier. La place Patrice Lumumba à Ixelles n’est pas érigée à l’endroit honorable qu’elle mériterait. Les panneaux apposés aux statues coloniales ne donnent guère des informations nuancées et n’attirent pas l’attention. L’AfricaMuseum renouvelé s’arrête à un ‘Oui, mais’. Nous gardons le silence : nos excuses ne vont pas au-delà d’un faible bégaiement. Nous oublions : mais uniquement parce que nous avons la liberté d’oublier. Non, nous ne sommes guère confrontés aux cicatrices de notre héritage colonial. Mais même celui qui le nie rencontrera un jour ou l’autre le spectre tant refoulé.
Nous gardons le silence : nos excuses ne vont pas au-delà d’un faible bégaiement. Nous oublions : mais uniquement parce que nous avons la liberté d’oublier
Je suis ravi qu’en 2014 – aussi tard que cela puisse paraître – je rencontrais ce spectre. Des artistes et Des historiens m’ouvraient les yeux et ceux des autres. Tout à coup, nous reconnaissions dans nos statues les portraits de tueurs de masse. Nous découvrions dans le Père Fouettard une vieille tradition qui reproduit sans gêne les rapports de pouvoir coloniaux. Nous apprenions que les tâches les plus terribles étaient assignés à d’innombrables soldats congolais dans cette Seconde Guerre mondiale qui est naïvement perçue par nous comme ‘européenne’. Nous pâlissions lorsque nous apprenions que la Belgique avait ordonné le meurtre sur Lumumba. Nous ne pouvions pas faire autrement que de nous taire quand nous comprenions que notre prospérité a été bâtie sur des siècles de pillages de vos richesses : le cuivre, l’or, le caoutchouc. Pour toutes les douleurs que nous vous avons causées, nous vous présentons sincèrement ces excuses.
Il y a quelque temps, un directeur de musée me disait : ‘Désolé pour la pagaille que ma génération laisse à la vôtre’. Il parlait certainement de l’état lamentable du climat, du capitalisme débridé et d’une société où ceux qui n’ont pas la même origine, la même couleur, le même genre, la même orientation sexuelle ou la même classe n’ont pas les mêmes opportunités que lui : un homme blanc, riche, à la tête de l’institution. Ses excuses résonnaient aigrement ; il paraissait n’avoir aucune envie de changer ce système d’exclusion en l’an 2019.
Il est aussi aigre de nous excuser pour un passé dans un présent teint par l’héritage colonial. Ce pardon n’est qu’un début. Il ne peut pas rester sans résolutions. A partir d’aujourd’hui, nous votons pour les partis politiques qui laissent à tout pays sa souveraineté. A partir d’aujourd’hui, vous aurez la parole dans l’enseignement et dans les médias sur la honte coloniale. A partir d’aujourd’hui, nous discutons ensemble sur d’autres perspectives pour éclairer, valoriser et critiquer notre histoire, sur la façon dont notre espace public peut tenir compte de cette histoire, sur les manières dont nos pays peuvent s’entraider.
Les cicatrices de l’oppression belge au Congo, au Rwanda et au Burundi ne disparaîtront pas. Mais nous avons le devoir d’essayer de panser les plaies ensemble. Non pas en prenant la liberté d’oublier, mais la liberté de se souvenir et d’avancer vers un nouvel avenir ensemble.
Nos excuses les plus sincères,
Au nom de tout le peuple belge.
Pas de pardon sans dialogue
Dagmar Dirkx
Intriguée par l’(im)possibilité d’un pardon collectif, je participais au concours Pardon est un début en 2019. Ma lettre finissait dans le top cinq, sélectionnée par un jury de faiseurs d’opinion, d’écrivains, d’historiens et d’artistes. Les Belges pouvaient indiquer leur pardon préféré par un vote en ligne. La lettre de Bregtje Van Bockstaele, intitulée Chère personne du Congo, remportait le prix. Elle a été remise à l’ambassade congolaise avec les autres lettres. Les responsables du concours motivaient ainsi leur initiative : ‘En tant que pays, il est temps de nous réconcilier avec notre passé colonial. Au nom de la population, nous pouvons faire ce que nos instances ne font pas. Pardon est un début.’ Cependant, ce pardon semble en rester à ses débuts. Si le concours était annoncé par une véritable offensive médiatique, le silence à l’issue n’en paraissait que plus assourdissant.
Ce pardon semble en rester à ses débuts. Si le concours était annoncé par une véritable offensive médiatique, le silence à l’issue n’en paraissait que plus assourdissant.
Pourtant, pour moi, la promesse d’une discussion publique était la motivation la plus importante pour participer. L’idée est excitante : une pluralité de voix qui s’excusent dans différentes lettres des crimes de l’Etat belge. Dans ma naïveté, je supposais que l’élément compétitif disparaîtrait au fur et à mesure que le concours avancerait, mais le format de concours classique ne laissait pas de place à des échanges réciproques. Ainsi, le concours subvertissait son propre titre. Pardon est un début… mais de quoi ?
‘Nous’, c’est qui ?
Un point délicat de Pardon est un début s’avérait le nombre réduit de participants. Seulement 177 personnes envoyaient une lettre. Et au-delà de ce maigre échantillon, il est étrange, en tant qu’organisateur, de parler d’un unique pardon définitif, adressé à tous les Congolais. Il n’est pas étonnant que beaucoup de gens aient pris la campagne de travers. Sur les réseaux sociaux, les organisateurs essuyaient beaucoup de critiques. ‘Enfantillages politiquement corrects’, objectait l’un. ‘Pourquoi devrais-je m’excuser, moi, de faits commis par Léopold II ?’ écrivait un autre.
De telles réactions prouvent qu’il nous reste beaucoup à apprendre. Assurément, un pardon national n’est possible que si la majorité de la population est au courant des abus coloniaux. Une grande partie des excuses sélectionnées sont conçues comme un appel au gouvernement et au Roi. Investissez dans cette connaissance. Engagez ce dialogue. Présentez vos excuses, mais faites qu’elles ne soient pas le terme de l’histoire.
J’écrivais du point de vue de ma propre conviction et l’extrapolais par commodité à toute la population.
Ce n’est pas une fin, donc, et ainsi, je prenais l’occasion de relire ma lettre. Je me butais à des choses que je formulerais à coup sûr différemment aujourd’hui. L’énumération d’intentions, notamment, laisse un arrière-goût amère après le 26 mai 2019, car la Flandre optait ce jour-là pour un discours populiste de droite. La perspective du ‘nous’ à partir de laquelle j’écrivais était injustement généralisatrice. La question du concours était la suivante : écris une lettre au nom du peuple belge. Malheureusement, je l’ai trop suivie à la lettre. J’écrivais du point de vue de ma propre conviction et l’extrapolais par commodité à toute la population.
Qui est ce ‘nous’ dans ma lettre ? à partir de quelle perspective est-il permis d’écrire lorsqu’il s’agit d’excuses pour des décennies d’oppression coloniale ? Récemment, j’ai lu un entretien qui datait de 2005 avec l’Iranienne Marjan Satrapi, connue pour son roman graphique Persepolis, publié sur le site d’infos américain Salon. La discussion portait sur la frontière trouble entre une perspective personnelle et politique. Sur une question qui avait été posée sur la relation entre l’Iran et les Etats-Unis elle répondait comme suit :
‘The world is not divided between East and West. You are American, I am Iranian, we don’t know each other, but we talk together and we understand each other perfectly. The difference between you and your government is much bigger than the difference between you and me. And the difference between me and my government is much bigger than the difference between me and you. And our governments are very much the same.’
La distance entre le gouvernement et les citoyens : c’est elle qui, tout comme la distance que nous ressentons avec la période de la colonisation, explique la difficulté d’une excuse nationale. Aujourd’hui règne peut-être le sentiment qu’à l’époque, l’histoire coloniale se passait au-dessus de la tête des citoyens. En fait, le système colonial engageait le peuple belge en entier, des médecins jusqu’aux missionnaires, des professeurs jusqu’aux metteurs en scène, des commerçants jusqu’aux ministres. De nombreux articles ont été rédigés sur les zones grises de la responsabilité individuelle, politique et collective. La quête de la bonne perspective est aussi pénible dans l’historiographie que dans la mise à l’écrit d’une excuse.
Dialogue à deux
Dans la citation de Satrapi, il y a un passage que je trouvais encore plus intéressant que celui sur la distance. ‘Tu es Américain, je suis Iranienne. Nous ne nous connaissons pas. Pourtant, nous nous parlons, ici et maintenant, et nous nous comprenons parfaitement.’ Après ma participation, je recevais une réaction de la voisine de mes parents. En tant que Ruandaise en Belgique, elle me disait qu’elle avait été touchée par ma lettre et qu’elle l’avait traduite pour sa famille au Rwanda. Sa réaction m’a appris deux choses.
En premier lieu qu’une excuse peut bien mener à une reconnaissance : les méfaits coloniaux ont effectivement eu lieu, le traumatisme existe et la douleur est réelle. Une reconnaissance n’implique pas un adoucissement des blessures infligées, encore moins un ‘rétablissement’. La tâche est peut-être trop grande pour une unique lettre. Cependant, la réaction à cette lettre peut inciter à un nouveau dialogue, dans lequel ma voisine et moi, à partir d’un point de vue différent, nous pouvons ‘nous parler et nous comprendre parfaitement’.
Ma connaissance ruandaise me confrontait avec ce qui était sous-représenté dans ma lettre : la perspective du destinataire.
Dans un monde idéal, ce ‘nous’ dans ma lettre porterait en effet sur tout le peuple belge, et aussi bien le gouvernement que les citoyens ne fermeraient plus les yeux sur le passé. Ils entameraient la conversation par le biais d’excuses collectives. Jusqu’à ce jour, rien ne nous empêche de commencer cette conversation de façon individuelle. A deux, bien entendu. Ma connaissance ruandaise me confrontait avec ce qui était sous-représenté dans ma lettre : la perspective du destinataire. Aussi loin qu’on puisse aller dans l’épluchage d’une histoire, si l’on ne parle pas avec ceux pour qui le traumatisme colonial est une réalité quotidienne, on commet une erreur. J’aurais dû, beaucoup plus tôt, frapper à la porte de la voisine de mes parents. Je ne l’ai toujours pas fait. Mes excuses : j’arrive.
Pardon est un verbe
Hugues Makaba Ntoto
Comment faut-il s’excuser pour le passé colonial de son propre pays? Il n’existe pas de réponse simple à cette question ; d’ailleurs, elle ne serait pas souhaitable. L’ampleur de l’injustice et de la souffrance humaine qu’a été infligée au Congo en tant que colonie belge et domaine de Léopold II demande de l’introspection, de l’humilité et du remords. Le genre de remords qui aspire à une rectification. Mais il n’est pas question de rectification si elle ne sert que d’expédient pour le remords et la honte collectifs.
Regretter le passé colonial n’est que le début d’une longue conversation, qui devrait être plus osée que le concours d’écriture Pardon est un début. L’initiative de Creative Belgium et de l’agence publicitaire Happiness était destinée, en premier lieu, à recruter des auteurs prometteurs pour un masterclass en rédaction publicitaire. En même temps, Creative Belgium voulait prouver que les publicitaires se soucient également de phénomènes sociaux tels que le colonialisme et la décolonisation. Mais de telles bonnes intentions ne sont qu’une simple distraction lorsque la forme de l’excuse les gêne.
La ‘chère personne du Congo’ est une abstraction, visible en tant qu’idée, mais du reste sans voix.
Si de bonnes intentions ne valent rien pour les victimes de la colonisation, c’est bien parce qu’elles placent le coupable au centre de l’action. Un récit où le pardon adressé à la victime est présenté comme cadeau n’existe que par la grâce du coupable qui décide de se prosterner. C’est la position dans laquelle la campagne Pardon est un début se trouve. La ‘chère personne du Congo’ est une abstraction, visible en tant qu’idée, mais du reste sans voix. Elle est de nouveau déshumanisée. Les mots savent effectivement changer le monde, comme l’indique Creative Belgium sur le site de son concours. Mais les mots peuvent tout aussi bien créer l’illusion du changement ou de l’action.
Il est bien sûr impossible qu’un appel tel que Pardon est un début puisse œuvrer à une rectification sur le même niveau que pourrait le faire le gouvernement belge. Ce n’était pas le but du concours d’écriture, qui était surtout orienté vers la recherche de fines plumes. Mais l’appel aux épistoliers ne naissait pas dans un vide : il prenait racine dans le contexte plus vaste de la décolonisation qui depuis quelques années reçoit plus d’attention en tant que problème social. Le souvenir postcolonial de peuples entiers renferme de la souffrance et de l’espoir et mérite plus qu’une simple objectivation. ‘Un pardon unique à tous les Congolais’ ne peut jamais être accompli sans réponse.
Bien sûr : s’excuser pour des actes impérialistes de générations antérieures constitue un champ de mines pour leurs descendants. Ces excuses sont-elles utiles ou simplement une façade avantageuse derrière laquelle peuvent se cacher le gouvernement et les hommes politiques ? Sont-elles même correctes ? L’on pourrait avancer que les anciens pouvoirs coloniaux ne devraient pas s’excuser aujourd’hui puisque les véritables responsables ne sont plus au pouvoir. En même temps, d’autres voix font remarquer que le rapport de forces entre les anciens colonisateurs et leurs colonies n’a pas fondamentalement changé.
Peut une excuse réellement mener vers une réconciliation ?
La question de savoir si une excuse peut réellement mener vers une réconciliation est d’une égale importance. Il est possible que des précédents puissent servir de leçon, tels que les excuses présentées en 2002 par Louis Michel, Ministre des Affaires Etrangères de l’époque, à propos du rôle qu’avait joué la Belgique dans l’assassinat de Patrice Lumumba. Ces excuses étaient suscitées par une commission d’enquête du parlement qui avait conclu que la Belgique a eu une ‘responsabilité indéniable dans les événements qui ont mené vers la mort de Lumumba’.
La parole de l’agresseur
Les excuses belges présentaient de grandes failles, révélait le chercheur britannique Tom Bentley dans son essai Colonial apologies and the problem of the transgressor speaking (2018). En effet, Michel n’entrait pas dans les détails sur l’exécution de Lumumba, mais attaquait seulement la ‘neutralité apathique et indifférente’ du gouvernement belge à propos de son bien-être. Les excuses concernaient l’incapacité de la part du gouvernement d’assurer l’intégrité physique d’un homme politique africain. En outre, ils ne reconnaissaient pas cet assassinat comme étant le résultat excessif d’un sentiment de supériorité et de racisme. Puisque l’enquête parlementaire focalisait sur la période 1960 – 1961, l’assassinat de Lumumba se trouvait isolé du contexte colonial plus large qui avait l’avait permis.
Bentley pose à juste titre qu’un comportement paternaliste se cache derrière ces excuses, comportement qui perpétue l’idée du colonisateur noble en tant que bienfaiteur protégeant la colonie. La forme des excuses formulées par Michel contribue également à cette idée : elle consiste en l’adresse à son ancienne colonie d’un gouvernement colonial qui monte sur scène pour encadrer ses excuses. De cette manière, le colonisateur, dans sa position supérieure, s’approprie la narration pour la façonner à sa guise. Bentley reconnaît dans ce procédé un rituel formel qui prépare le terrain pour des non-victim centered apologies, et, par conséquent, pour l’autoconservation et l’autosatisfaction. Celles-ci se manifestent dans la formulation des excuses et dans le choix de souligner ou, au contraire, de minimiser certains événements.
La plateforme pour un pardon historique qu’offre Creative Belgium n’équivaut pas un pardon historique de l’état belge. Mais il se situe dans la lignée des excuses telles qu’elles sont décrites par Bentley dans son essai. Pardon est un début est, essentiellement, une prouesse publicitaire qui repose sur la sensibilité de la thématique coloniale. Les lettres contiennent, il est vrai, le message d’un ‘pardon accompli’, mais Creative Belgium et l’agence publicitaire Happiness en restent les protagonistes. Ce sont eux qui décident des formes et fonctions rituelles (un pardon accompli) de ces excuses et ce sont eux qui jugent de ces lettres adressées à un destinataire invisible sans voix.
Rituals of speaking
Ce qui est dit est donc aussi important que par qui cela est dit, tout comme le sont le contexte et la forme spécifiques dans lesquels un discours se produit. Une initiative pour s’adresser à l’autre, même faite avec de bonnes intentions, a toujours la possibilité d’affaiblir cet autre. La philosophe latino-américaine Linda Alcoff décrit ce problème de manière perspicace dans The Problem of speaking for others (1991). Alcoff y cherche ce que veut dire parler sur, au nom de et avec quelqu’un et comment ces moyens de dialogue fonctionnent. Elle met l’accent sur la difficulté à parler des autres sans parler à leur place. Dans les deux cas, l’orateur forge une identité pour lui-même et pour les autres, qui ne naissent que de sa propre interprétation.
Le problème qui s’ensuit est double : la position sociale (ou location) d’un orateur a une influence sur le sens et la véracité de certaines revendications. De plus, une position privilégiée peut former un danger dans le sens où elle fait entièrement et essentiellement partie des structures de pouvoir existantes. Ce qui est dit change selon la personne qui parle et celle qui écoute : ces rituals of speaking, comme Alcoff les nomme, sont politiques et, par conséquent, ancrés dans un jeu de force où sont impliqués le pouvoir et la domination. Avec Pardon est un début, Happiness et Creative Belgium mènent la danse – mais celle-ci ne laisse que peu d’auctorialité au partenaire proposé, le peuple congolais. Par corollaire, l’initiative, malgré ses bonnes intentions, garde intacte la même dynamique dominatrice qui continue à placer ‘l’autre’ dans sa position de complément d’objet sans voix.
Une initiative pour s’adresser à l’autre, même faite avec de bonnes intentions, a toujours la possibilité d’affaiblir cet autre.
Un pardon historique peut changer notre regard sur le passé colonial de ce pays et devenir l’occasion d’une restitution d’œuvres d’art volées, de réparations financières, ou en tout cas d’un programme d’études qui ne traite pas la période coloniale comme une note de bas de page dans l’histoire belge. Le débat sur ces corrections ne peut être mené que si, dans nos rituals of speaking, nous tenons compte des positions de nos interlocuteurs et du contexte historique et social du discours. Dans ce seul cas serait-il possible de parler d’un dialogue historique sur le passé colonial. Ce dialogue est effectivement plus grand que l’idée d’un désir sentimental, individualiste et égoïste de certains anciens agresseurs de se réconcilier avec leur propre passé. A l’ordre du jour est une interrogation sincère des rapports de force et des positions sociales qui donnent leur poids à nos mots.