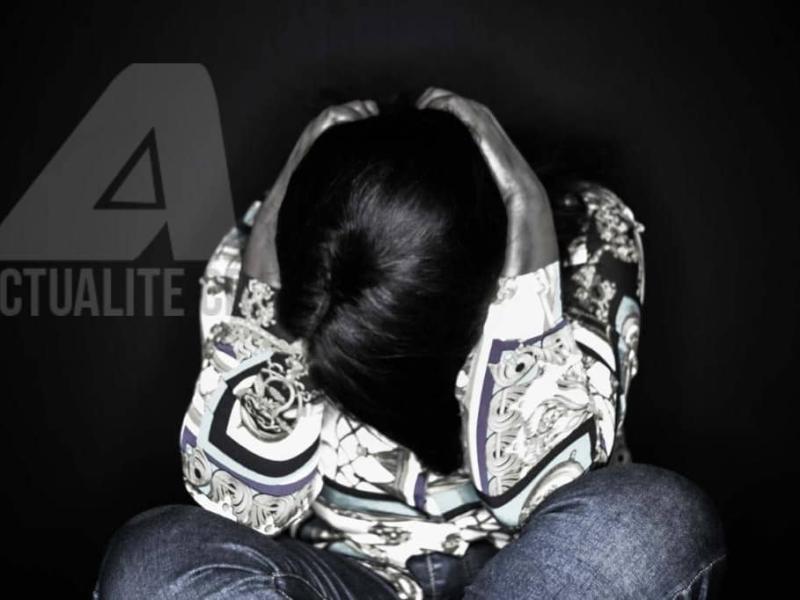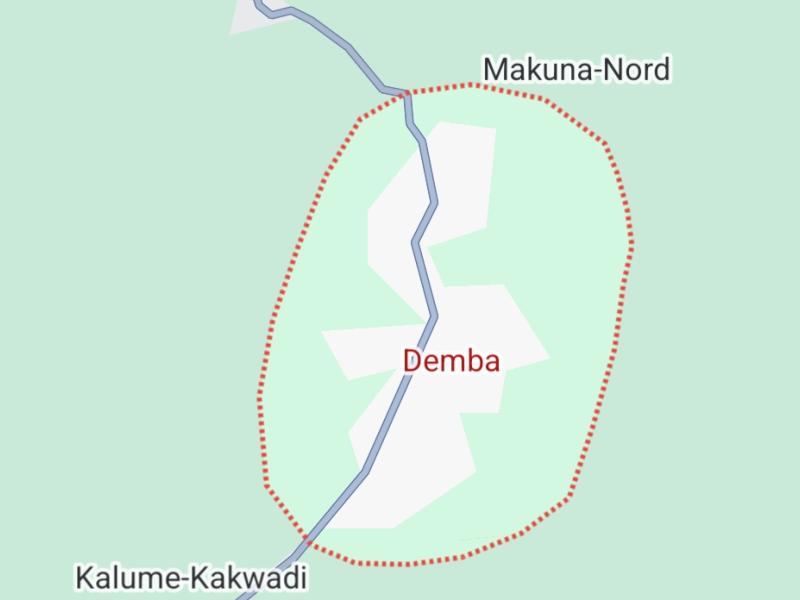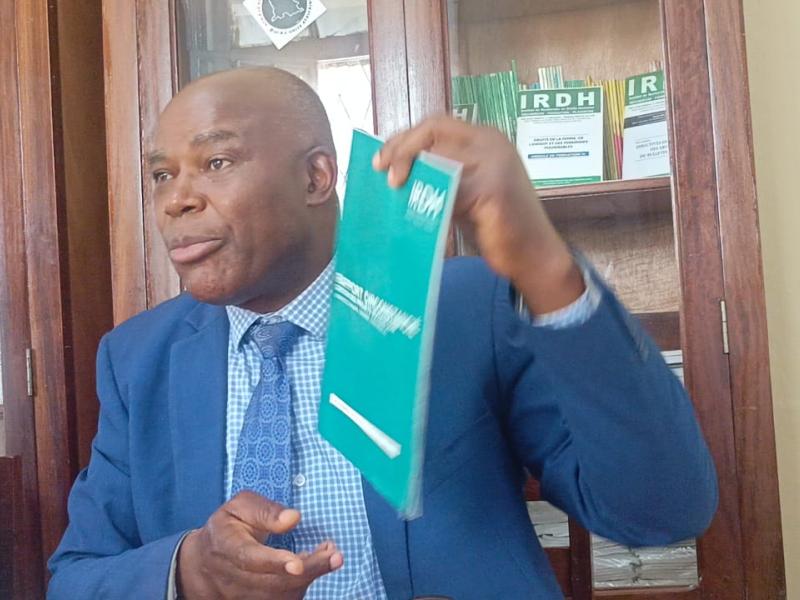En République Démocratique du Congo, la situation des femmes en détention reste peu médiatisée, bien que leur nombre augmente au fil des années. À la prison centrale de Makala, à Kinshasa, comme dans d’autres établissements pénitentiaires du pays, des préoccupations persistent sur les conditions de détention, l’accès aux soins, à une défense juridique efficace, et aux mesures spécifiques prévues pour les femmes incarcérées.
Que prévoit réellement la législation congolaise pour garantir leurs droits ?
Contacté sur le sujet, Maitre Deba Ngoma, avocate congolaise, rappelle :
« Le droit à la dignité et à un traitement humain est garanti à toute personne détenue en RDC par la Constitution (article 16) et par la Loi n°23/2002 portant Code pénal et Code de procédure pénale. La loi pénitentiaire congolaise, bien que perfectible, prévoit que les prisonniers, hommes ou femmes, doivent bénéficier de soins de santé, d’une alimentation suffisante et d’un accès à leur avocat. »
Les Règles Nelson Mandela des Nations Unies, ratifiées par la RDC, imposent aussi un traitement particulier aux femmes détenues, notamment en matière de santé reproductive et de protection contre les abus, poursuit elle.
« Une détenue enceinte, par exemple, doit avoir accès à des soins prénataux et postnataux, et ses conditions de détention doivent être adaptées », précise l’avocate .
Conditions de détention et accès aux soins
En pratique, la situation reste contrastée. Les cellules réservées aux femmes, comme à Makala, sont souvent surpeuplées et manquent d’infrastructures adaptées. Certaines ONG dénoncent le manque d’accès régulier aux soins gynécologiques ou à des produits d’hygiène de base.
« Les femmes en détention ont besoin de protections hygiéniques, de suivi médical régulier, et d’un environnement sûr. Mais dans de nombreuses prisons, ces droits sont plus théoriques que réels », déplore un membre d’une organisation de défense des droits humains.
Accès à la défense et droits procéduraux
Le droit à un avocat est garanti dès l’arrestation, mais dans la réalité, de nombreuses détenues surtout celles issues de milieux défavorisés ne bénéficient pas d’une assistance juridique effective, selon Me Deba, « le manque de moyens financiers, l’ignorance de leurs droits, et parfois l’éloignement des tribunaux retardent la tenue des procès. Certaines femmes restent en détention préventive pendant des mois, voire des années, avant d’être jugées, ce qui constitue une violation grave du droit à un procès équitable ».
Le cas particulier des mères détenues
La loi congolaise, à travers le Code pénitentiaire et certaines directives administratives, autorise les mères de nourrissons à garder leurs enfants avec elles jusqu’à un certain âge (souvent deux ans). Des dispositions prévoient un régime alimentaire adapté pour ces enfants, mais sur le terrain, leur application reste inégale.
« Ces enfants, qui n’ont commis aucun crime, vivent pourtant derrière les barreaux. Leur bien-être dépend totalement de la qualité des soins et de la nourriture que la prison peut offrir, souvent avec l’aide d’associations », explique la défenseure des droits humains.
Quels recours pour les détenues ?
Selon l’avocate, plusieurs mécanismes existent, même s’ils sont rarement mobilisés :
- Saisir le juge de l’application des peines pour dénoncer des conditions de détention contraires à la loi.
- Recours auprès du ministère public ou du ministère des Droits humains, qui disposent de pouvoirs d’inspection des établissements pénitentiaires.
- Le soutien des ONG et avocats qui peuvent introduire des requêtes en libération conditionnelle, révision de peine, ou transfert vers un établissement mieux adapté.
Des défis persistants
Malgré les textes, la mise en œuvre reste un défi majeur. Surpopulation carcérale, manque de financement, infrastructures vétustes et faible sensibilisation aux droits des détenues freinent les progrès.
Pour Maître Deba, « il ne suffit pas de garantir des droits sur papier. Il faut former le personnel pénitentiaire, assurer des budgets spécifiques pour les femmes détenues, et mettre en place des contrôles réguliers. Une prison ne doit pas être un lieu de privation de dignité ».
Nancy Clémence Tshimueneka