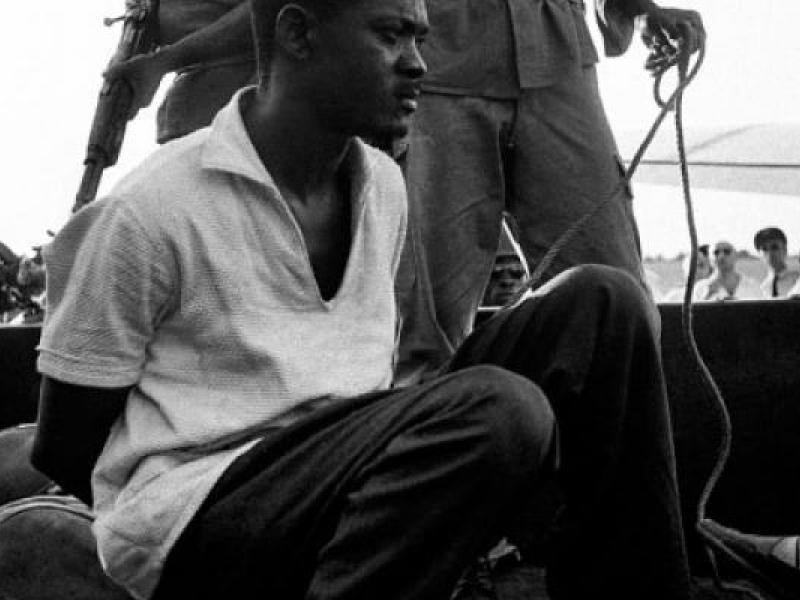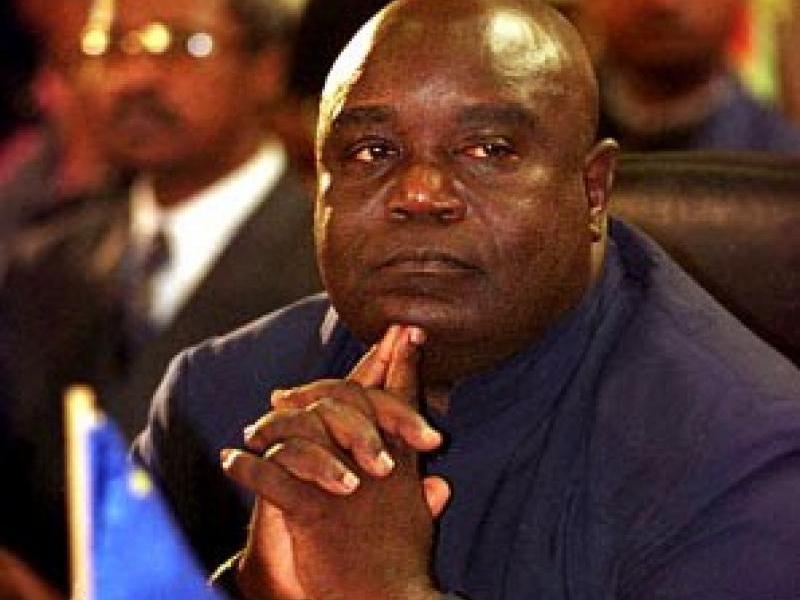Par Piaget Mpoto Balebo, Professeur en Relations Internationales à l’Université de Kinshasa et Expert en Diplomatie & Sécurité (piagetmpoto@unikin.ac.cd )
Vendredi 12 septembre 2025, le monde entier avait les yeux tournés vers New-York, toutes les radios et télévisions du monde avaient interrompu leurs programmes pour braquer leurs projecteurs vers la prestigieuse tour de verre de Manhattan. Partout on a affiché : Urgent, Edition spéciale, Latest News, Breaking News ; de CNN à France 24, de CGTN à BBC News, de Deutsche Welle à l’AFP. Un évènement en mondovision suivi par la planète entière. C’est manifestement l’évènement planétaire que tout le monde attendait : l’adoption par l’Assemblée Générale des Nations Unies d’une solution à deux Etats : l’Israël et la Palestine.
Est-ce de la curiosité ou c’est de l’intérêt pour ce conflit insoluble pour lequel plus d’un attendait de l’Organisation mondiale une solution à deux Etats ? Ce conflit meurtrier pour lequel l’ensemble de la planète s’est mobilisé depuis bientôt un centenaire, signant des pétitions de soutien sur des plates-formes en ligne et des hashtags sur des réseaux sociaux, multipliant les spectacles et marches dans les grandes capitales et mythiques lieux de culture pour exiger une chose : « la solution à deux Etats : Israël et Palestine ».
A l’issue du vote, il y aura 142 voix pour, 10 voix contre et 12 abstentions ; la RDC faisant partie des abstentionnistes ce coup-ci : Vivat. Cette position tranche singulièrement avec les récentes positions congolaises sur les grandes questions internationales impliquant des bras de fer avoués et/ou inavoués entre certaines grandes puissances. Occasion pour nous, de faire le point sur les enjeux et les dangers inhérents à la posture plutôt courageuse de la RDC.
Enjeux et dangers
En effet, loin d’être anodin, le résultat de ce vote ouvre la voie à l’une des batailles diplomatiques les plus épiques de l’histoire diplomatique contemporaine. Pour faire clair, ce texte préparé par la France et l’Arabie saoudite, fait office d’une feuille de route devant conduire à la reconnaissance de l’Etat palestinien dans ses frontières de 1967.
Cette question est d’autant plus épineuse que les Etats-Unis et Israël ont promis de poser des actes d’une radicalité inouïe. A titre exemplatif, Israël a menacé d’annexer la Cisjordanie occupée ; ce qui pourrait englober les villes et localités de Jérusalem-Est, Jéricho, Naplouse, Hébron, Jénine ou Tulkarem. Lorsqu’on associe cela au projet de prise de contrôle définitif de Gaza et le déplacement de sa population, c’est carrément la disparition de la Palestine, car sans territoire l’idée même de l’Etat perd toute sa substance.
En ce XXIe siècle, la géopolitique du monde, des régions et des sous-régions est en train de changer au gré des rivalités, des alliances, des concurrences et de plusieurs autres réalités. Ce dangereux jeu de puissance et d’équilibre de forces auquel se livrent de plus en plus les grandes puissances mondiales fait que certains États faibles deviennent de simples pions dans le grand échiquier mondial. Pions que les grandes puissances peuvent utiliser selon leurs intérêts.
La prise en compte de tous ces aspects, rend toute prise de position assez compliquée pour des pays n’ayant pas un très grand poids diplomatique, d’autant plus que ça peut provoquer l’ire d’un des camps, ce qui ne nous sera d’aucune utilité.
La RDC faisant partie du concert des nations ne pouvait que se positionner par rapport à son intérêt national et éviter tout suivisme pouvant l’entrainer dans des conflits dans lesquels elle n’aura rien à gagner.
La position neutre de la RDC a été une posture prudente et rationnel dans ce sens qu’en pesant le pour et le contre, nous parvenons à comprendre que notre avis ne saura rien changer en profondeur, sachant que ces genres de questions ont des issues qui relèvent presque exclusivement de la résultante des rapports de forces entre les grandes puissances. La RDC n’y faisant pas partie, et sachant que ladite déclaration de l’Assemblée Générale des Nations-Unies ne revêt pas un caractère contraignant, surtout pour un Etat de la trame d’Israël et des Etats-Unis, il était très judicieux de ne pas trop s’impliquer.
Tenant compte du fait qu’il y a très peu d’enthousiasme de la communauté internationale dans la situation sécuritaire et humanitaire à l’Est du pays, la RDC ne pouvait qu’adopter cette position : l’abstention. Il est temps, nous semble-t-il, que la diplomatie congolaise prenne en compte d’abord et avant tout les intérêts du Congo dans ses prises de positions. Cela devrait être le socle de toute action internationale de sa politique étrangère. Nous caressons l’espoir que loin d’être un court moment de lucidité, cette position s’inscrira dans une stratégie à long terme de non-alignement coulé dans la politique étrangère de la République Démocratique du Congo.
Bienfaits du non-alignement dans un monde en perpétuelle mutation et en croissante interdépendance
Lorsque le concept non-alignement est évoqué, d’aucuns pensent, à raison d’ailleurs, à la guerre froide et à la bipolarité qui en faisait la force. Mais en regardant les choses d’un peu plus près, nous comprenons que la visée n’était pas tant le refus de s’aligner sur la position de l’une ou l’autre superpuissance qui posait problème, mais plutôt la volonté pour ces Etats non-alignés d’affirmer leur souveraineté, à assurer leur développement et à exprimer leur opposition au néocolonialisme et à la guerre froide.
Évolution vers le multi-alignement
L’exemple des pays comme l’inde, l’Arabie Saoudite, la Turquie, l’Egypte ou le Qatar sont un parfait exemple du multi-alignement qui consiste à maintenir des liens avec différentes puissances, mêmes antagonistes, sans s’y engager complètement ; l’objectif étant de faire passer les intérêts nationaux et la coopération avant les oppositions géopolitiques et géostratégiques entre les grandes puissances. Ces pays entretiennent de bonnes relations aussi bien avec les puissances occidentales qu’avec les géants du Sud global. C’est en réalité l’essence de ce qui a été imaginé dans la conférence de Bandung d’Avril 1955 en Indonésie.
Conclusion
Nous tenons à appuyer le récent vote de la RDC à l’Assemblée Générale des Nations-Unies sur la question israélo-palestinienne, et particulièrement sur la future reconnaissance d’un Etat palestinien. La logique et l’équité voudrait que la RDC appuie cette fameuse déclaration de New-York qui garantit le droit à l’autodétermination des palestiniens, cependant cette question est tellement complexe et épineuse que toute prise de position hasardeuse peut avoir des conséquences au-delà des simples postures.
Nos dernières prises de positions dans les questions hautement sensibles telles que celle des Ouïghours en Chine (au Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies) sont des prises de risque qui pouvaient nous faire perdre plus que nous ne pouvions gagner. Ne dit-on pas « quand les éléphants se battent se sont les herbes qui en pâtissent ? » Il n’y a rien de plus dangereux que de vouloir s’impliquer dans les jeux d’influence entre grandes puissances.
Les pays en voie de développement n’ont pas vocation à s’aligner indéfectiblement, indéfiniment et systématiquement derrière une grande puissance dans toutes les questions épineuses se posant sur la scène internationale. L’abstention est souvent une position plus confortable compte tenu des intérêts en jeu. Les pressions sont souvent fortes, mais la neutralité peut être une façon d’éviter d’être la chasse gardée d’une seule puissance dans ce XXIe siècle où la diversification des partenaires est devenue une religion. Il était donc temps de n’être ni un porte-à-faux, ni un vassal. Toutefois, chaque cas peut comporter sa particularité et nécessiter telle ou telle autre posture due à la gestion des intérêts en jeu.
La guerre entre la Russie et l’Ukraine est la parfaite illustration du danger que comporte le fait de vouloir mettre son nez dans les jeux d’influence. Cette guerre est aussi la parfaite illustration du multi-alignement et de la multipolarité du monde actuel. Nous avons vu des pays réputés proches des occidentaux comme le Qatar, l’Arabie Saoudite, l’inde ou l’Egypte refuser de prendre des sanctions contre la Russie. De même, la majorité des pays du monde ont refusé de se mêler de la guerre économique que se livrent les américains et les Chinois. Ce type de position évite aux pays plus ou moins faibles de se retrouver entre deux feux, de se bruler les ailes ; alors que les deux prétendus antagonistes continuent d’entretenir des échanges économiques et des relations diplomatiques plus ou moins normales.