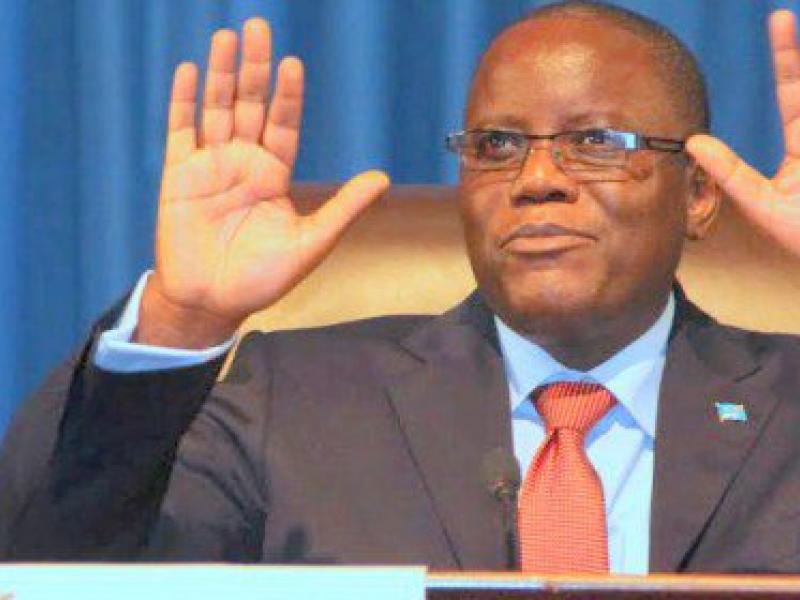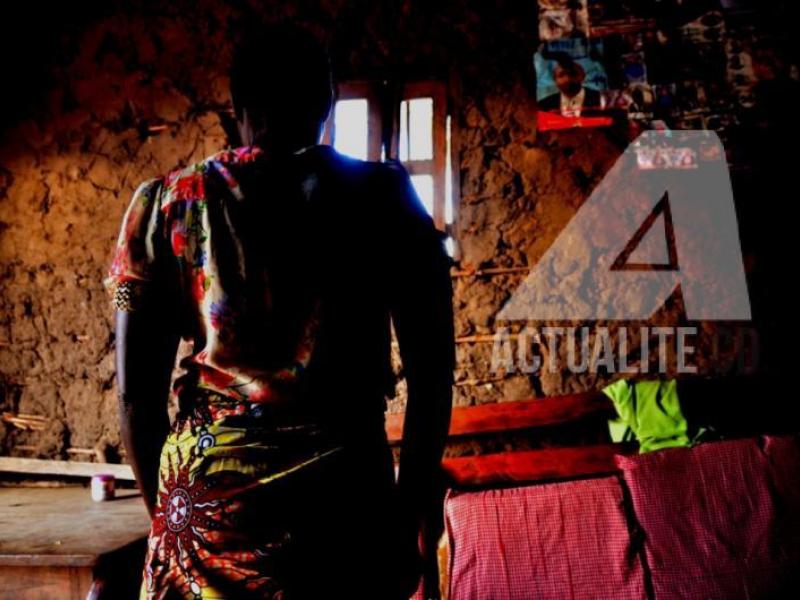À l’occasion d’une table ronde organisée le 23 juillet à Kinshasa par l’ONG Journalists for Human Rights - RDC (JHR-RDC), en collaboration avec Chari-Congo, la députée nationale congolaise Christelle Vuanga a livré une analyse sur la place des femmes dans les processus de paix, en lien avec la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies.
L’événement, réunissant des représentants des organisations de la société civile (OSC) et des acteurs étatiques, visait à évaluer l’implication des femmes dans les dynamiques de prévention et de résolution des conflits en République démocratique du Congo (RDC).
Une avancée lente mais constante
Lors de son intervention, Christelle Vuanga a reconnu des progrès réalisés dans l’inclusion des femmes, mais estime que le chemin reste long. « C’est vrai que nous avançons petit à petit, mais ce n’est pas encore le résultat escompté », a-t-elle déclaré. Si la Constitution congolaise consacre le principe de parité, sa mise en œuvre reste en deçà des attentes.
« Quand on parle de parité, on parle de 50 %. Mais même les 30 % qui sont parfois évoqués ne sont pas encore atteints », a-t-elle souligné en distinguant deux voies principales pour l’intégration des femmes dans la sphère politique.
La partitocratie : l’adhésion et l’ascension au sein d’un parti politique et la technocratie : l’accès aux responsabilités grâce à l’expertise et à la compétence professionnelle.
« Dans le premier cas, les femmes doivent non seulement s’affirmer dans les ligues féminines, mais aussi au sein même des structures de décision de leur parti », explique-t-elle, notant la difficulté d’imposer ses ambitions dans des milieux souvent masculins.
Quant à la technocratie, elle concerne des femmes qui, grâce à leurs compétences et à leur engagement dans divers partenariats étatiques ou internationaux, ont su se faire remarquer. « Que ce soit par la partitocratie ou par la technocratie, les femmes doivent se distinguer par leur manière de faire et de penser », a insisté Christelle Vuanga.
La députée a cependant alerté sur une réalité préoccupante : en politique, la désignation de femmes pour représenter des partis ou entités lors de négociations se fait parfois au détriment de la méritocratie. « Il arrive qu’on choisisse certaines femmes non pas pour leur compétence, mais parce qu’elles sont “la fille de” ou “l’épouse de” », a-t-elle déploré. Ce travers contraste, selon elle, avec les pratiques de la société civile, où l’ascension est généralement fondée sur la capacité à convaincre et à agir.
La question de la création de partis politiques par des femmes a également été abordée. Christelle Vuanga a reconnu que peu de femmes dirigent leurs propres formations, en partie en raison des ressources financières limitées. « Les hommes ont commencé plus tôt et ont accumulé des moyens. Les femmes, souvent, ne veulent pas créer des partis “mallettes” qui ne correspondent pas à leurs ambitions. »
Elle appelle donc les femmes à s’impliquer activement dans les partis existants, à gravir les échelons et à devenir des figures incontournables dans les processus de désignation aux postes décisionnels.
Elle a par ailleurs salué l’appel à la formation lancé par une autre intervenante, Annie Matundu. « On ne peut pas participer à une table de négociation et faire piètre figure. Il faut être préparée, savoir ce qu’on va dire, comment le dire, et en quoi cela sert notre cause », a-t-elle affirmé. Elle rappelle également les succès passés des femmes congolaises, notamment dans l’obtention de la parité inscrite dans la Constitution.
Christelle Vuanga a également insisté sur la pertinence d’un outil souvent sous-estimé : la diplomatie féminine, et appelé à une mobilisation de toutes les femmes, au-delà des appartenances politiques.
« Dans les contextes de conflit, la manière dont les femmes négocient, dialoguent, propose une vraie valeur ajoutée. C’est une diplomatie efficace, qu’il faut institutionnaliser et intégrer dans toutes les sphères. Que nous soyons de gauche ou de droite, les idéaux sont les mêmes : les femmes doivent avancer », a-t-elle martelé.
Cette table ronde a été organisée dans le cadre du projet « Canada-Monde : La voix des femmes et jeunes filles » et s’inscrit dans une série d’initiatives visant à renforcer la participation féminine dans les processus décisionnels, conformément aux objectifs de la Résolution 1325, qui reconnaît le rôle central des femmes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la reconstruction post-conflit.
Nancy Clémence Tshimueneka