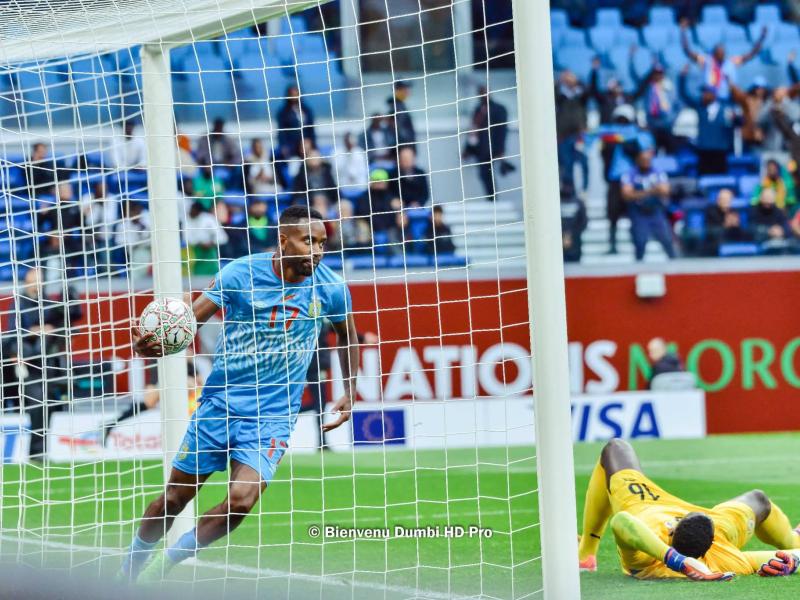La réalisation de cette promesse était fortement attendue dans les rangs de l'armée et de la police. La soirée du jeudi 27 mars 2025, le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé, à travers un communiqué du ministère des Finances, le doublement de la solde des militaires et des policiers. La mesure est effective à partir du vendredi 28 mars. Elle suscite des interrogations sur l'origine de ces fonds et la transparence dans un contexte de guerre dans l'Est du pays, alors qu'aucun collectif budgétaire n'a été voté par le Parlement.
Valéry Madianga, coordonnateur du Centre des recherches en finances publiques et développement local (Crefdl), craint des détournements massifs de deniers publics dans l'exécution de ces dépenses de rémunération, dans la mesure où elles se font « hors budget ».
« C'est grave parce que personne ne pourra contrôler les effectifs et les salaires réels des militaires à rémunérer. Ça peut favoriser le détournement car personne ne contrôle les dépenses exceptionnelles de sécurité, même pas le Parlement », a-t-il confié à ACTUALITE.CD.
Explosion des dépenses de rémunération
D’après cet expert, cette nouvelle mesure pourrait faire exploser les dépenses de rémunération de l’armée, souvent exécutées en mode d’urgence. Ces dépenses sont pourtant toujours supérieures aux dépenses en capital, celles liées aux investissements, comme le démontrent plusieurs rapports, notamment ceux de la Cour des comptes.
« Fin décembre 2024, l'enveloppe globale des rémunérations des FARDC se chiffrait à 391,5 millions $, selon les données de la Banque centrale du Congo. Avec cette mesure, elle passera à 783 millions $ d'ici décembre 2025 », souligne Valéry Madianga.
Et d’ajouter :
« Aujourd'hui officiellement, en termes de prévisions, on est déjà à 22,9 % mais comme on l'observe à chaque reddition des comptes, dans la réalité, on a déjà dépassé la limite. En 2022-2023, par exemple, presque 50 % des dépenses étaient dédiées à la rémunération. Avec ces augmentations, en 2025, on pourrait avoisiner 55 % à 60 % ».
Le programme conclu entre la RDC et le FMI en danger?
D'après la norme internationale, les dépenses de rémunération ne peuvent dépasser 35 % des recettes propres du budget de l'État. Le FMI tient à ce principe et suggère la prudence dans le paiement des dépenses de rémunération. Depuis 2020, ce principe est souvent rappelé au gouvernement par la Banque centrale du Congo (BCC).
Dans une analyse sur les dépenses publiques au premier semestre de 2024, le Crefdl regrettait que même les dépenses de rémunération soient exécutées en mode d'urgence, sans respecter le circuit informatisé de la dépense publique. Ne pas respecter la procédure normale de la dépense publique « soulève des problèmes de transparence et d'efficacité », estimait pour sa part le FMI lors des négociations pour le nouveau programme de Facilité élargie de crédit approuvé en janvier 2025.
Pourtant, à la conclusion du premier programme pluriannuel en juillet 2024, Gabriel Leost, alors représentant résident du FMI dans le pays, avait indiqué que le gouvernement de la RDC s'était engagé à mettre en place un système de contrôle rigoureux pour empêcher toute dépense hors budget, ainsi qu'à l'adoption d'une loi de finances rectificative pour faire face aux nouveaux défis budgétaires, comme c'est le cas actuellement. Cette disposition visait également à réduire sensiblement les dépenses exceptionnelles et de rémunération.
Les dépenses à l'insu de l'autorité budgétaire
En RDC, le Parlement, principalement l'Assemblée nationale, vote le budget de l'État et veille au respect de son exécution. Pourtant, le doublement de la solde des militaires et policiers, annoncé par le gouvernement, se fait à l'insu de cet organe, réputé être « l'autorité budgétaire », surtout sans le vote préalable d'une loi de finances rectificative.
« Nous attendons le collectif budgétaire la semaine prochaine. C'est à travers ce document que nous saurons où le gouvernement a trouvé l'argent pour doubler la solde des militaires et policiers », a confié à ACTUALITE.CD Guy Mafuta Kabongo, président de la commission économique et financière (Ecofin) à l'Assemblée nationale.
L'élu de Tshikapa, dans la province du Kasaï, promet par ailleurs un contrôle pour évaluer l'exécution des dépenses publiques pour le premier trimestre 2025, pour éventuellement identifier des dépenses extra-budgétaires. « Nous allons demander des comptes. C'est après l'examen des documents de suivi budgétaire que nous jugerons. Nous avons déjà demandé les éléments au gouvernement et attendons sa réaction », a-t-il déclaré.
Pas de contrôle parlementaire, impunité, opposition condamnée au silence
De l'autre côté, l'opposition parlementaire fustige l'acte du gouvernement de doubler les soldes sans avoir au préalable un collectif budgétaire. Cet acte est qualifié d'« aventure pure et simple » par Christian Mwando, du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi.
Il dénonce l'incapacité de l'Assemblée nationale à sanctionner les membres du gouvernement qui violent les normes, évoquant le cas du ministre des Infrastructures, accusé de détournement de fonds publics et « sauvé par le bureau » de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, l'opposition n'a pas voix au chapitre au Parlement.
« Le Parlement ne fonctionne pas. Le gouvernement est protégé. Nous n'avons ni le contrôle des salaires, ni le contrôle des gens au front. Il y a une incapacité générale à gérer l'armée. On a réduit tout le monde au silence. Même quand nous envoyons des questions écrites ou orales, le bureau estime que ça ne l'intéresse pas et ne les programme pas », regrette l'élu de Moba, dans la province du Tanganyika.
Depuis le début d'année, le gouvernement avait évoqué la nécessité de réduire le train de vie des institutions pour améliorer les conditions des militaires au front et de leurs dépendants. Le 28 février dernier, lors de la 33e réunion du Conseil des ministres, il avait adopté le dossier relatif aux modalités opérationnelles d'augmentation de solde et de prime des militaires et policiers, ainsi que d'amélioration de leur sécurité sociale et des conditions de vie de leurs dépendants.
Bruno Nsaka