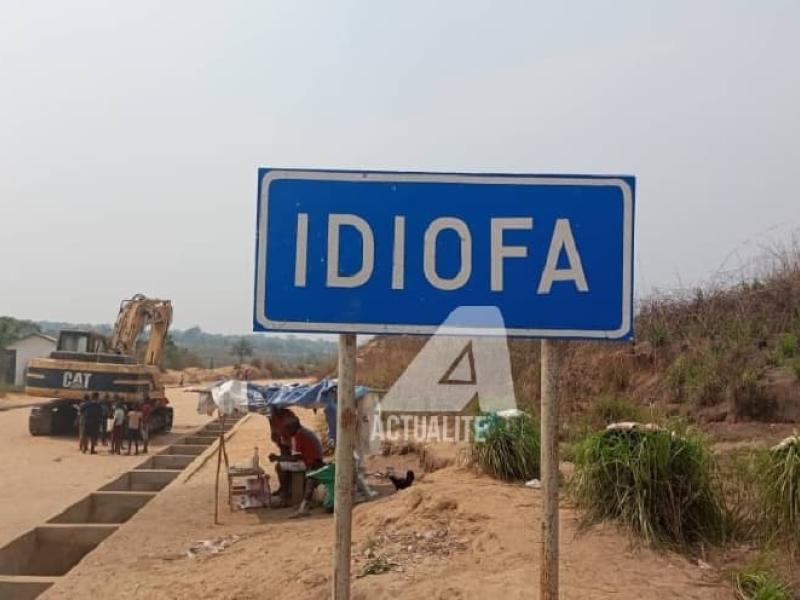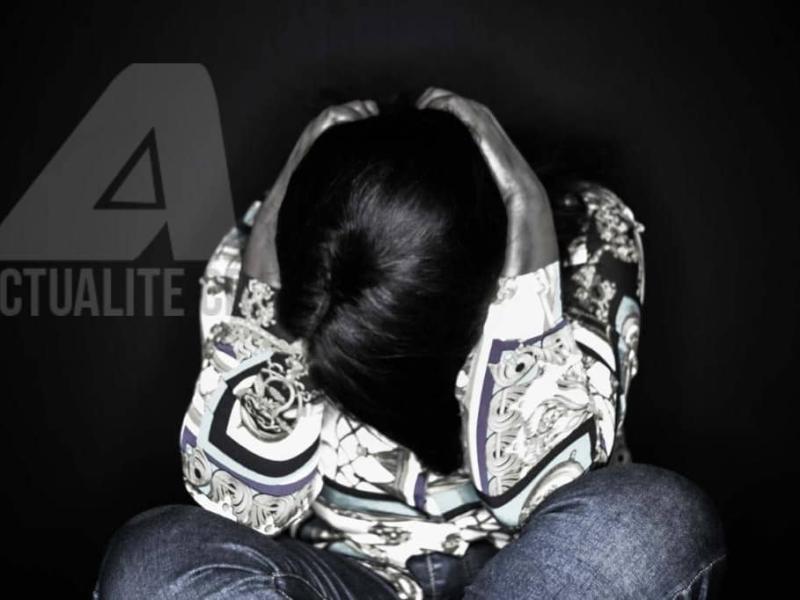Né le 26 novembre 1936, Paul Malembe Tamandiak s’est imposé comme l’un des fondateurs de l’enseignement du journalisme en République démocratique du Congo. Professeur ordinaire à l’Université de Kinshasa, il a marqué plusieurs générations d’étudiants par son exigence et son engagement en faveur d’une information conçue comme un instrument de citoyenneté.
Lire aussi: RDC : Paul Malembe Tamandiak, patriarche du journalisme, s’éteint à 88 ans
Issu d’un milieu modeste, il effectue ses études primaires et secondaires dans sa région natale avant d’intégrer, dans les années 1950, l’école d’assistants médicaux du Bandundu. Cinq années de formation, auxquelles s’ajoute une année préparatoire, lui permettent d’obtenir un diplôme en 1959. Destiné à une carrière médicale, il renonce pourtant à cette orientation. Le journalisme, qu’il avait commencé à pratiquer dès la fin des années 1950, l’attire davantage.
Envoyé en France pour poursuivre la médecine, il se heurte aux équivalences complexes entre diplômes coloniaux belges et formations françaises. Refusant de reprendre un cycle complet, il choisit de s’inscrire à l’Université catholique de Louvain. Il y obtient une maîtrise en journalisme, une licence en ethnologie – aujourd’hui anthropologie sociale et culturelle – ainsi qu’une spécialisation en sciences politiques et sociales, option relations internationales. Il poursuit ensuite un doctorat en sociologie à la Sorbonne, convaincu que la carrière académique lui permettrait de conjuguer l’ensemble de ses compétences.
Son arrivée en Europe, à la veille de l’indépendance congolaise, le place aux portes de l’histoire. Installé en France en septembre 1960, il assiste en observateur à la table ronde de Bruxelles. Refusé à l’entrée, comme d’autres jeunes intellectuels congolais dont Joseph-Désiré Mobutu, il suit de près les négociations qui scellent l’accession du pays à l’indépendance. C’est également en Europe qu’il s’engage dans des associations étudiantes et intellectuelles africaines, telles que la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France, les mouvements catholiques africains et le Congrès pour la liberté de la culture. Ces expériences renforcent sa conviction que l’indépendance ne peut être réduite à une rupture politique, mais doit aussi s’accompagner d’une émancipation culturelle et intellectuelle.
En 1965, il est recruté comme assistant à l’Université de Louvain, devenant l’un des premiers Congolais à occuper une telle fonction dans l’enseignement supérieur belge. Sollicité par le gouvernement congolais, il rentre au pays pour contribuer à la modernisation du secteur médiatique. À la fin des années 1960, il participe à l’installation de la télévision congolaise et devient, en 1966, le premier rédacteur en chef du journal télévisé. Il démissionne cependant quelques mois plus tard, refusant de transformer l’information en outil de propagande politique.
Son rôle le plus décisif intervient en 1973, lorsqu’il fonde l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTI, aujourd’hui UNISIC). Inspiré de son expérience européenne, il y impose une logique de qualité : promotions réduites, sélection rigoureuse et forte dimension pratique. « Il fallait former peu de gens, mais de très haut niveau », expliquait-il. L’institut devient rapidement une référence en Afrique centrale, attirant des étudiants venus de plusieurs pays voisins.
L’ISTI offre également une spécialisation rare à l’époque : journalisme politique, international, économique, ou encore formation pratique avec des professionnels congolais associés à l’enseignement. Cette approche intégrée contribue à faire de l’institut « la plus grande école de journalisme en Afrique centrale » selon ses pairs.
Professeur ordinaire à l’Université de Kinshasa, Malembe Tamandiak s’impose comme l’un des pionniers de l’enseignement de la communication en RDC. Son engagement dépasse cependant le cadre académique. En 1971, il est arrêté et détenu durant six mois, accusé par les services de sécurité d’inspirer les mouvements étudiants de Lovanium.
Dans ses analyses, il adopte un regard critique sur l’indépendance congolaise, estimant que le pays n’avait pas été préparé à assumer cette rupture. Pour lui, les élites de l’époque, issues pour l’essentiel de l’administration coloniale, n’avaient ni l’expérience démocratique ni la formation culturelle suffisante pour transformer l’indépendance politique en véritable autonomie économique et sociale.
Malembe Tamandiak a toujours défendu une conception exigeante du rôle des médias. À ses yeux, ils constituent des interfaces entre gouvernants et gouvernés, des outils de formation de la conscience nationale et des instruments indispensables au processus démocratique. Mais il soulignait aussi les limites d’un journalisme pratiqué dans un contexte de précarité économique, où la dépendance aux financements extérieurs fragilise l’indépendance éditoriale.
À travers ses étudiants, devenus journalistes, responsables publics ou cadres d’entreprise, le professeur a laissé une empreinte durable. « La carrière la plus noble, c’est l’éducation, parce que c’est elle qui permet le développement du pays », affirmait-il.