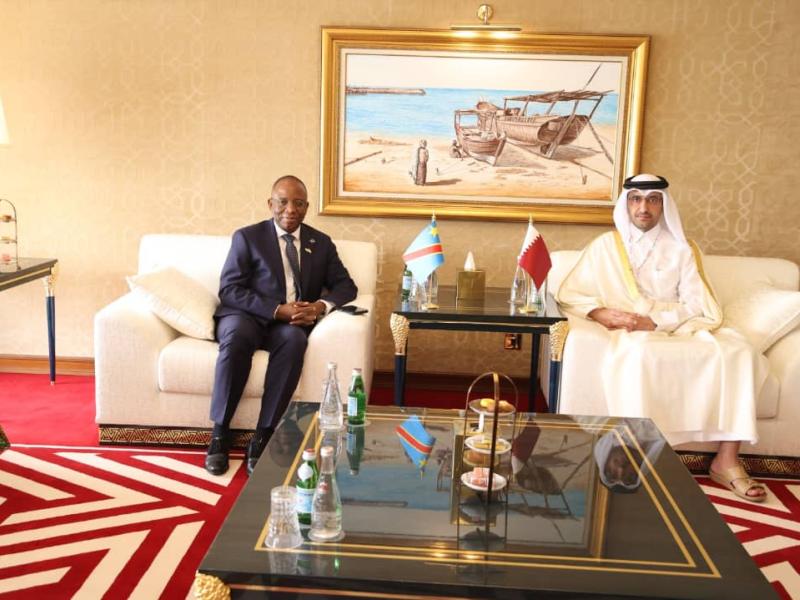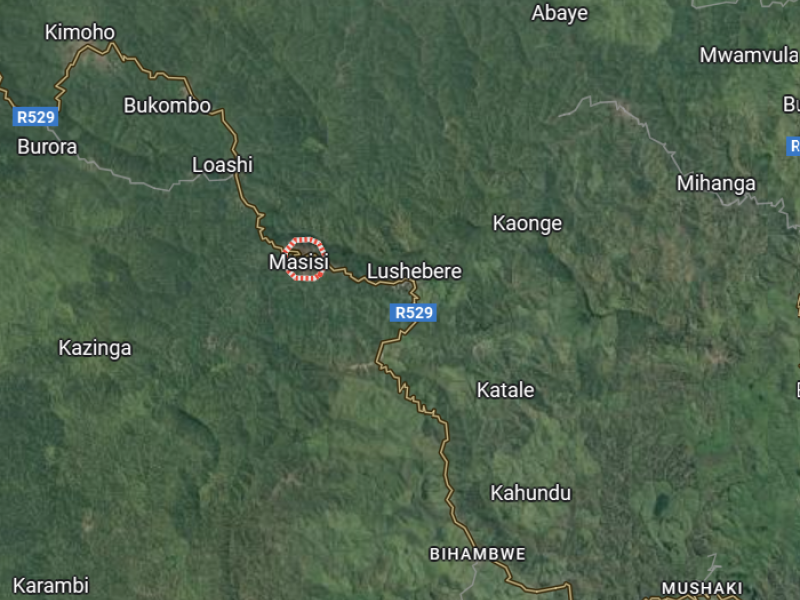Le Palais du Peuple à Kinshasa a accueilli, ce mardi 20 mai, l’atelier national de présentation du cadre de concertation multi-acteurs pour la mise en œuvre de la loi n°22/030 du 15 juillet 2022, relative à la protection et à la promotion des droits des peuples autochtones pygmées. La cérémonie officielle a été présidée par le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemain Shabani.
Dans son allocution d’ouverture, le ministre Shabani a salué un moment qualifié de « concrétisation d’un engagement national profond » en faveur des peuples autochtones.
« Il ne suffit pas d’avoir un texte juridique, il faut aussi créer les instruments efficaces et inclusifs de sa mise en œuvre », a-t-il affirmé.
Institué par un arrêté ministériel en date du 2 avril 2025, le Cadre de concertation multi-acteurs se présente comme un espace de dialogue structuré, réunissant les différentes parties prenantes engagées dans la mise en œuvre de la loi, a-t-il souligné.
Il repose sur trois structures : une assemblée plénière, un comité de pilotage et un secrétariat, chacune dotée de rôles spécifiques visant à garantir la cohérence, la transparence et l'efficacité du dispositif.
Le ministre a également réaffirmé la volonté du gouvernement, sous l’autorité du président Félix Antoine Tshisekedi, de garantir une application pleine et entière de la loi.
Patrick Saidi, coordonnateur de la Dynamique des groupes des peuples autochtones a, quant à lui, salué ce moment comme une avancée historique et un tournant majeur dans la lutte pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones pygmées.
« Nous participons aujourd’hui à une étape cruciale, celle de la vulgarisation et de la mise en œuvre concrète de la loi. C’est un moment d’espoir, mais aussi de responsabilité collective », a-t-il déclaré en mettant en lumière les attentes des communautés autochtones, et en insistant sur l’urgence de traduire les principes de la loi en actions concrètes.
Selon lui, cela passe par l’élaboration rapide et participative des décrets d’application, notamment celui instituant la commission interministérielle en charge de cette tâche, ainsi que la mise en place du fonds national de développement des peuples autochtones. Ces outils, a-t-il souligné, sont indispensables pour rendre la loi réellement opérationnelle.
Patrick Saidi a également insisté sur l’importance de la coordination entre les multiples acteurs impliqués: autorités nationales, administrations provinciales, organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers afin d’éviter les chevauchements, les malentendus et les conflits d’interprétation.
Il a notamment évoqué le cas du Tanganyika, où une mauvaise compréhension des enjeux autochtones a conduit à des tensions.
« Ce cadre de concertation est une réponse concrète à ce défi. Il permettra d’harmoniser les approches, de mutualiser les ressources et d’assurer que chaque acteur œuvre dans le même sens », a-t-il expliqué.
Il a également rappelé que la loi est d’application nationale, et que sa vulgarisation doit se faire sur tout le territoire, y compris dans les provinces où il n’y a pas de populations autochtones identifiées, afin de promouvoir une culture de respect, de tolérance et d’égalité.
Le coordonnateur de la Dynamique des groupes des peuples autochtones (DGPA ) a exprimé sa satisfaction de constater que les peuples autochtones ne sont plus considérés comme des populations marginalisées, mais comme des citoyens à part entière, appelés à participer activement à la vie publique et au développement du pays.
« Il ne s’agit pas de créer une société parallèle pour les peuples autochtones, mais de garantir leur pleine intégration dans la société congolaise, dans le respect de leur identité, de leur culture et de leur dignité », a-t-il conclu.
Les prochaines étapes de ce processus incluront notamment une campagne de vulgarisation à l’échelle nationale de la loi pour la protection et la promotion des peuples autochtones pygmées , la rédaction de mesures d’application concrètes, la création d’une commission interministérielle, l’instauration d’un fonds national de développement pour les peuples autochtones, ainsi que la mise en place d’un cadre réglementaire sur le consentement libre, préalable et éclairé.
Les participants à cet atelier ont salué l’engagement des autorités congolaises ainsi que la mobilisation des partenaires techniques et financiers, considérant cette initiative comme un jalon déterminant pour l’inclusion, la cohésion nationale et le respect des droits fondamentaux des peuples autochtones en République démocratique du Congo.
Nancy Clémence Tshimueneka