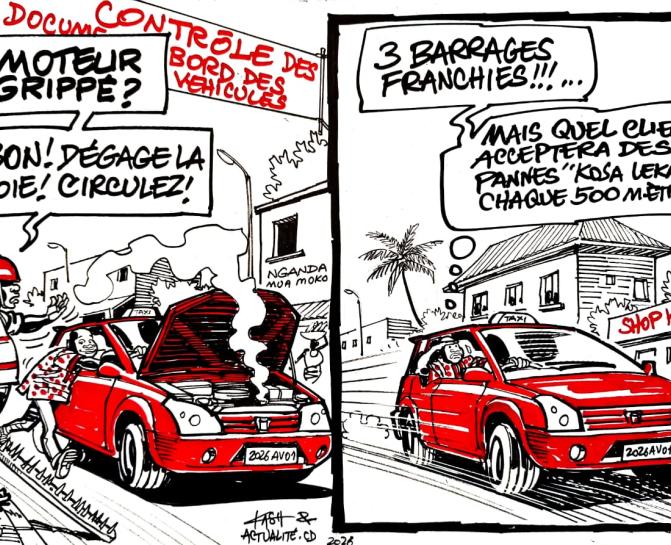Malgré la publication officielle du Protocole de Maputo en République démocratique du Congo en 2018, son application effective reste limitée, notamment en ce qui concerne l’accès des femmes à un avortement sécurisé tel que prévu à l’article 14.2.C du texte. Ce dernier autorise l’avortement dans certaines conditions, notamment en cas de viol, d’inceste ou lorsque la grossesse met en danger la santé mentale ou physique de la femme.
Face aux nombreux blocages, qu’ils soient juridiques, culturels ou liés à une méconnaissance du cadre légal, l’ONG internationale Ipas a engagé une collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice. Leur objectif : renforcer les compétences des professionnels du droit et les amener à intégrer pleinement les dispositions du Protocole de Maputo dans leur pratique.
Dans ce cadre, une session de Clarification des valeurs et transformation des attitudes (CVTA) a été organisée du 13 au 14 mai 2025 à Kinshasa, à l’intention des membres du Secrétariat technique de la Commission permanente de réforme du droit congolais (CPRDC). Quinze membres ont été formés durant deux jours, au Cercle Elaïs, sur les enjeux liés à l’avortement sécurisé et la nécessité d’adapter le code pénal congolais à la lumière des engagements internationaux.
Le Dr Mboma Michael, médecin à l’hôpital général de référence de Makala et consultant pour Ipas, était l’un des facilitateurs de cette session. Il revient sur les enjeux de cet atelier :
« Nous étions dans un atelier de clarification des valeurs pour la transformation des attitudes des membres de la CPRDC, parce qu'ils sont en train de faire un grand travail : celui de la réforme du code pénal congolais. Vous savez comme moi que, dans sa version actuelle, l’avortement est considéré comme un crime. Or, avec le Protocole de Maputo, certaines formes d’avortement sont reconnues comme un droit fondamental pour les femmes, lorsqu'elles répondent à des critères bien définis. »
Pour le Dr Mboma, cette contradiction entre la loi nationale et les engagements internationaux crée une insécurité juridique aussi bien pour les femmes que pour les professionnels de santé :
« Le problème, c’est qu’au niveau des cours et tribunaux, ou même chez les officiers de police judiciaire (OPJ), on ne prend souvent en compte que le code pénal. Le Protocole de Maputo est ignoré ou mis de côté. Cela place les prestataires et les bénéficiaires dans une zone grise où ils peuvent être poursuivis, même s’ils ont agi dans le respect des droits de la femme. »
L’objectif de la formation était donc d’amener les membres de la CPRDC à une compréhension approfondie de ces enjeux :
« Nous leur avons expliqué ce que recouvre exactement l'avortement sécurisé : dans quelles situations il est permis, qui peut en bénéficier et pourquoi il est crucial de transposer ces dispositions dans le code pénal. Car tant que cela ne sera pas fait, même les actes conformes au Protocole de Maputo resteront vulnérables à des poursuites judiciaires. »
L’atelier a également permis de présenter le Guide de facilitation sur le Protocole de Maputo, un outil pédagogique conçu pour accompagner les professionnels du droit dans l’interprétation et l’application des normes liées à la santé sexuelle et reproductive.
« Nous ne pouvions pas simplement leur dire : “inscrivez tel article dans le code pénal”. Il fallait d'abord un travail de fond sur leurs représentations, sur les valeurs. Nous avons donc travaillé à transformer leur regard sur l’avortement. Qu’ils comprennent que, dans certaines circonstances, c’est un droit, et non un crime. »
Ce travail de clarification et de sensibilisation est indispensable, selon le Dr. Mboma, pour une réforme juridique durable et cohérente avec les obligations internationales de la RDC.
Avec cette initiative, Ipas et ses partenaires espèrent que la réforme en cours du code pénal congolais intégrera enfin les dispositions du Protocole de Maputo, afin que les droits des femmes à un avortement sécurisé, dans les conditions prévues par la loi, soient pleinement reconnus et respectés.