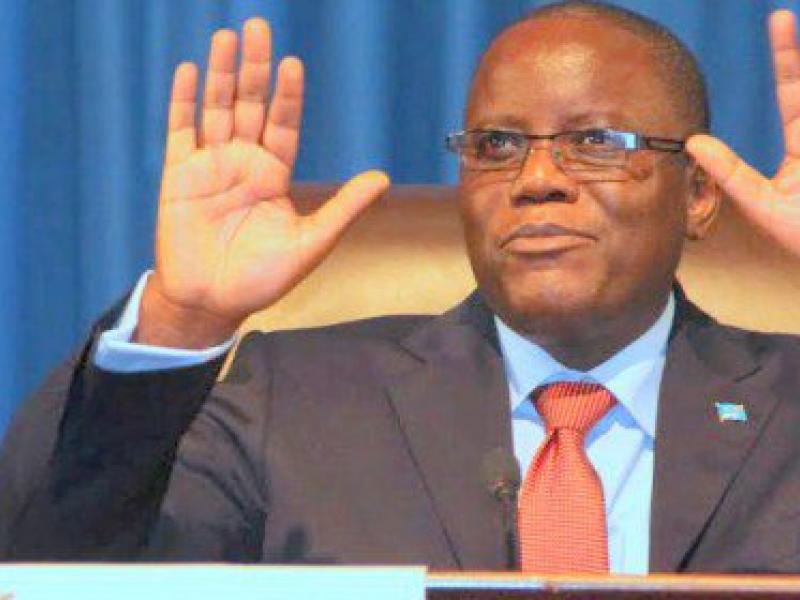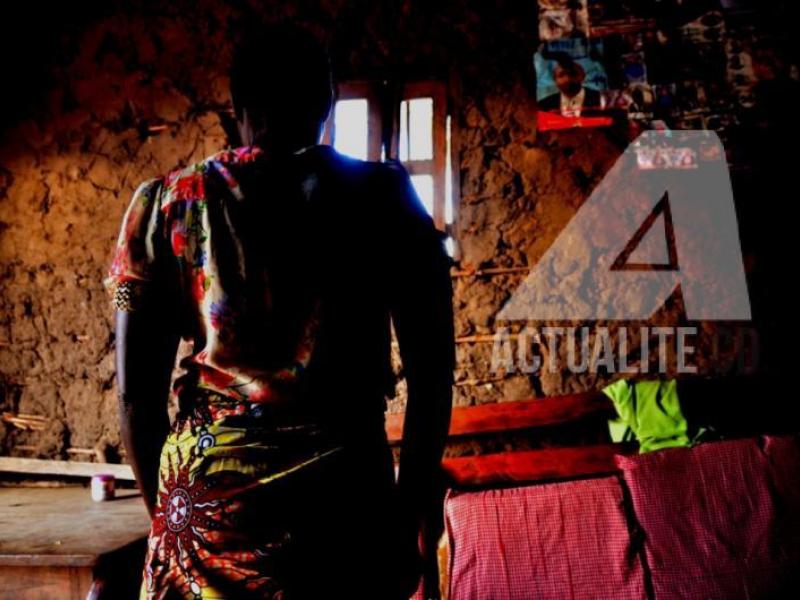Elles sont nombreuses mais invisibles. Les femmes handicapées en République démocratique du Congo font face à une double marginalisation : être femme dans une société encore inégalitaire et être porteuse de handicap dans un pays où l’accessibilité reste un défi majeur. Pourtant, le cadre légal congolais reconnaît leurs droits. Mais qu’en est-il réellement dans la pratique ?
Une protection prévue par la loi
La RDC a ratifié en 2015 la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) des Nations unies, s’engageant ainsi à garantir l’égalité et l’inclusion. Sur le plan national, la Loi n° 22/003 du 3 mai 2022 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes vivant avec handicap constitue une avancée majeure. Elle prévoit l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et à la participation à la vie publique.
Cependant, comme le souligne Me Richard Righo, avocat spécialisé en droits sociaux, la difficulté n’est pas dans l’existence des textes, mais dans leur application effective.
"Beaucoup d’écoles, d’hôpitaux et même d’institutions publiques ne respectent pas les normes d’accessibilité prévues par la loi", a-t-il souligné.
Malgré ces garanties, les femmes handicapées restent confrontées à des discriminations structurelles, poursuit l'avocat.
"Dans le domaine de l’emploi, elles sont souvent écartées sous prétexte d’incapacité. Dans le domaine de la santé, l’absence de services adaptés limite leur accès aux soins, notamment en santé sexuelle et reproductive. Certaines femmes se voient refuser la consultation gynécologique faute d’équipements adaptés. Cela constitue une violation claire de leur droit à la santé garanti par la loi congolaise et par la Constitution".
Par ailleurs, la loi congolaise garantit l’accès de tous à l’enseignement. Mais dans les faits, les jeunes filles handicapées sont les plus exposées à l’exclusion scolaire, rappelle Me Richard.
"L’absence d’aménagements raisonnables (rampe, manuels adaptés, accompagnement spécialisé) empêche beaucoup d’entre elles de poursuivre leurs études. L’État a l’obligation légale de mettre en place des mesures d’adaptation pour permettre l’éducation inclusive. Le non-respect de cette obligation constitue une discrimination", précise Me Richard.
L’urgence d’une mise en œuvre réelle
Si le cadre normatif existe, son application reste embryonnaire. Faute de moyens, mais aussi de volonté politique, les dispositions légales ne se traduisent pas encore par des changements tangibles dans la vie quotidienne des femmes handicapées.
Pour l'avocat, la clé réside dans la justiciabilité des droits : "Tant que les victimes ne peuvent pas saisir facilement les tribunaux pour faire valoir leurs droits, les lois resteront lettre morte. Il faut un mécanisme de recours effectif et des sanctions dissuasives pour les institutions qui ne respectent pas la loi."
En RDC, la reconnaissance légale des droits des femmes handicapées est un premier pas. Mais pour que ces droits deviennent effectifs, il faut aller au-delà des textes : appliquer la loi, former les agents publics, adapter les infrastructures et sensibiliser la société, souligne Me Righo.
"La lutte des femmes handicapées est celle de toutes les femmes congolaises : transformer les promesses juridiques en une réalité d’égalité et de dignité".
Nancy Clémence Tshimueneka