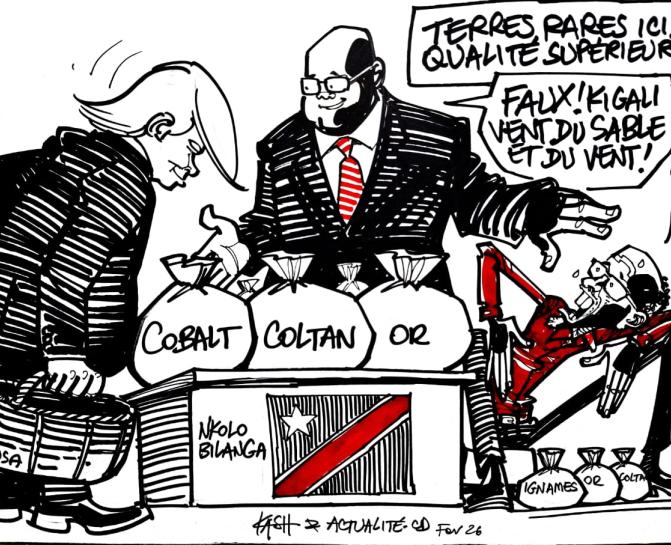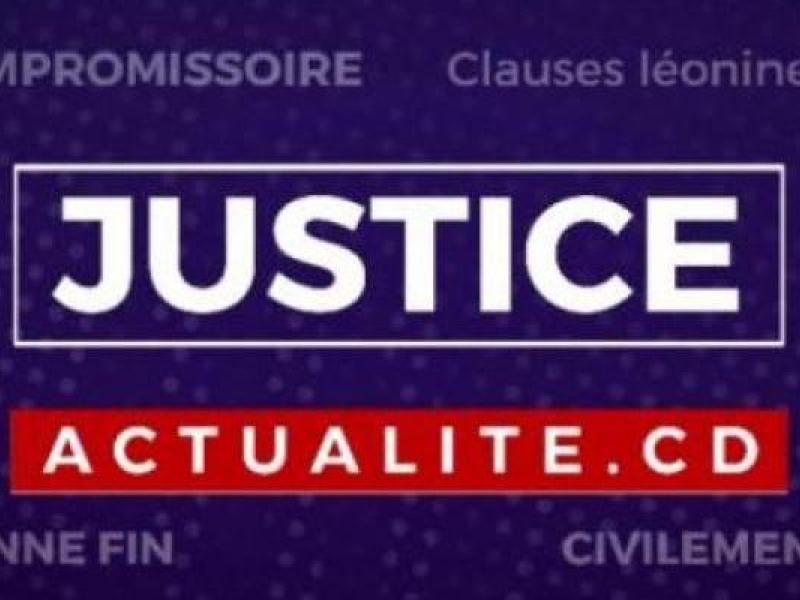Depuis plusieurs mois, la situation dans l’Est de la République Démocratique du Congo est marquée par l’intensification des offensives des groupes rebelles, en particulier dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. À Kinshasa, les Kinoises expriment leur frustration, leur inquiétude et leur scepticisme face à la gestion de cette crise.
Pour Merveille Ingesemani, une commerçante de 36 ans, l’évolution de la situation à l’Est est d’abord une source d’inquiétude personnelle : "Nous avons l’impression que le gouvernement n’agit pas avec la fermeté nécessaire. Tous les jours, on entend parler de villages attaqués, de milliers de déplacés… mais que fait réellement l’armée ?". Cette préoccupation est partagée par Armelle Abadie, étudiante en médecine, qui redoute la propagation du conflit à d’autres régions, à mesure que les groupes armés étendent leur influence. "Les rebelles sont entrés dans le Sud-Kivu sans aucune résistance de l’armée congolaise. Je me demande bien ce qui se passe à l’intérieur. À chaque fois que les rebelles lancent un assaut sur une ville ou un village, ils remportent la victoire en moins de 24 heures. On est vraiment aussi faibles à ce point ?", s’interroge-t-elle.
De son côté, Ortance Fuzi, étudiante en droit, exprime sa frustration face à la lenteur des interventions gouvernementales et des opérations militaires. "Cela fait des années que les mêmes groupes armés sévissent. Pourquoi n’avons-nous pas une armée mieux équipée, mieux formée ?", déplore-t-elle. Pour elle, la réponse du gouvernement est largement insuffisante et semble marquer une distance entre les autorités et les réalités du terrain.
Mais au-delà de l’inefficacité perçue de l’État, certaines Kinoises s’interrogent également sur le comportement des populations locales dans les zones affectées.
Amina Engbolo, étudiante en sciences sociales, souligne que "certaines personnes se sentent poussées à collaborer, parfois par peur, parfois pour des raisons économiques. Dans des régions où la pauvreté est extrême, certains groupes armés offrent des promesses de protection, voire des moyens de subsistance. Dans ce contexte, il est difficile de juger la population locale qui peut être prise en étau entre ses besoins immédiats et la nécessité de survivre."
Cependant, ce phénomène de collaboration est vu d’un mauvais œil par Marcelline Nkwadi, infirmière, qui dénonce ce qu’elle considère comme une forme de trahison : "on doit tous soutenir les efforts des autorités pour sauver le pays. On doit faire face et résister à la menace de l’ennemi de toutes les manières possibles. Dire non à tout et rester catégorique." Pour elle, toute forme de collaboration avec les rebelles constitue une menace supplémentaire pour la stabilité du pays.
Malgré l’ampleur du désastre à l’Est, les congolais se montrent néanmoins solidaires. Les associations humanitaires, bien que souvent limitées par les obstacles logistiques et sécuritaires, continuent d’organiser des collectes de fonds et des envois d’aides pour les déplacés. Cependant, la question de l’efficacité de ces aides est fréquemment soulevée : "on envoie de l’aide, mais où va-t-elle vraiment ? Il y a un manque de transparence dans la gestion de ces fonds", indique une militante de la société civile.
Elle appelle cependant à une réforme en profondeur de la gestion de la crise. "Il faut un plan de paix durable, pas des solutions temporaires. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l’incertitude, à regarder ce carnage sans espérer un changement réel."
Nancy Clémence Tshimueneka