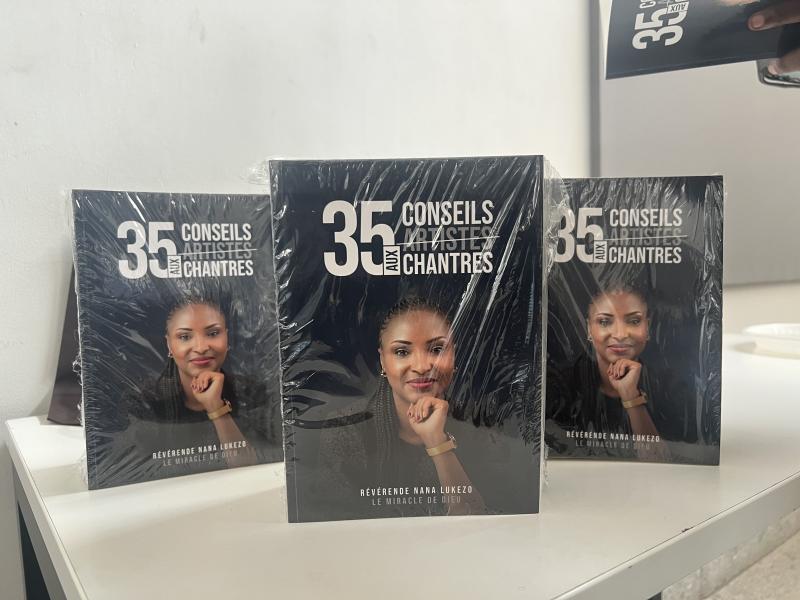À l’issue d’un conclave de deux jours, tenu les 14 et 15 octobre derniers dans la capitale kenyane, un groupe d’opposants congolais réunis autour de l’ancien président Joseph Kabila a signé une déclaration commune entérinant la création d’une nouvelle plateforme politique baptisée « Sauvons la RDC ». Selon ses initiateurs, cette coalition vise à « mettre un terme à la tyrannie, restaurer la démocratie et promouvoir la réconciliation nationale ».
En l’espace de deux semaines, Joseph Kabila est passé du statut de condamné à mort en RDC à celui de chef de file d’une nouvelle opposition politique. Condamné par contumace par la justice militaire pour une présumée complicité avec les rebelles de l’AFC/M23, l’ancien président — qui a dirigé le pays pendant dix-huit ans — affiche désormais sa volonté de rester un acteur influent de la scène politique congolaise.
Dans les rues de Kinshasa, la naissance du mouvement « Sauvons la RDC » suscite des réactions contrastées. Entre scepticisme et lueurs d’espoir, les avis sont partagés.
« Ce sont des gens qui ont eu tout le temps à changer les choses, mais ils n’ont rien fait. Aujourd’hui, ils reviennent sous une nouvelle bannière, mais avec les mêmes méthodes. On ne sauve pas un pays avec des slogans », estime Serge, enseignant dans une école à Lemba, qui se montre très dubitatif. Pour lui, ce projet ressemble davantage à une manœuvre politique qu’à un véritable sursaut patriotique .
Pour beaucoup de Congolais, cette initiative soulève davantage de questions que d’espoirs. « Ils ont eu le pouvoir pendant vingt ans, qu’ont-ils fait pour sauver le pays ? », s’interroge Paul. « On pensait plutôt avec des nouvelles têtes, mais c’est toujours les mêmes visages avec les mêmes promesses ».
« Quand ils disent vouloir sauver la RDC, de quoi parlent-ils exactement ? De la sauver de ce qu’ils ont eux-mêmes contribué à détruire ? », s’interroge, à son tour, Aline, licenciée en sciences politiques. Pour elle, cette nouvelle plateforme illustre « l’amnésie politique, où les anciens dirigeants tentent un retour en force sans bilan ni remise en question ».
Joseph Kabila, condamné par contumace à la peine capitale pour « trahison » et « crimes de guerre », reste une figure clivante de la scène politique congolaise. Si certains voient en lui un homme d’État expérimenté capable de rassembler, d’autres estiment qu’il n’a plus de légitimité pour parler au nom du peuple.
Patrick, étudiant en sciences politiques, juge son retour "malvenu" : « Kabila a eu le temps de démontrer ce qu’il valait. Aujourd’hui, il revient parce que le contexte politique lui est favorable, pas parce qu’il a changé. »
Cependant, certaines voix appellent à ne pas rejeter cette initiative trop rapidement. Dieudonné, agent de l’État, estime que « le pays a besoin de toutes les forces ». Selon lui, « même si Kabila a commis des erreurs, il connaît les failles du système et peut contribuer à une réconciliation nationale ».
« C’est vrai qu’on ne l’aime pas, c’est vrai qu’il a fait beaucoup de mal à ce pays, mais Kabila reste toujours un acteur incontournable. Il connaît les rouages de l’État et peut jouer un rôle d’équilibre. Ce pays a besoin de dialogue, pas d’exclusion », poursuit-il.
Une position que partage également Michel : « Je ne suis pas non plus fan de lui, mais si cette plateforme peut vraiment favoriser la paix et le vivre-ensemble, alors pourquoi pas ? On a tout essayé. Peut-être que ça peut marcher si les intentions sont bonnes. »
L’émergence de « Sauvons la RDC » intervient dans un climat où la confiance envers les institutions est au plus bas. Les Congolais, confrontés à la crise économique, à l’insécurité persistante à l’Est et à la précarité sociale, peinent à croire en un véritable changement issu du monde politique.
Pour Heritier Diavova, politologue et assistant d’enseignement à l’université de Kinshasa, « la défiance vis-à-vis de la classe politique est telle qu’aucune initiative ne peut susciter un véritable engouement sans des actes concrets ». Il souligne que « la population n’attend plus des discours, mais des résultats tangibles ». « cette énième coalition politique ne sera jugée qu’à l’aune des actes », conclut il.
« Dresser le front et résister à la dictature »
Le mouvement « Sauvons la RDC », lancé une dizaine de jours plus tôt à Nairobi, a été présenté officiellement le 24 octobre dernier à Kinshasa lors d’une conférence de presse. Cette nouvelle plateforme regroupe plusieurs figures de l’opposition, parmi lesquels l’ancien Premier ministre, Augustin Matata Ponyo, condamné en mai à dix ans de travaux forcés, et Bienvenu Matumo, militant du mouvement Lutte pour le changement (Lucha), plusieurs fois arrêté sous la présidence de Kabila.
Les initiateurs appellent la population congolaise à « dresser un front commun contre la dictature », et à exiger le retrait de « toutes les forces étrangères et mercenaires du territoire », sans pour autant les citer nommément. Ils ont également dénoncé la « détention arbitraire des leaders politiques », les « jugements iniques » rendus par la justice contre des opposants, et à « l’incapacité » du président Félix Tshisekedi à faire face aux crises multiples que traverse le pays.
Du côté du gouvernement, la réaction ne s’est pas fait attendre. Les autorités ont vivement critiqué cette initiative, accusant Nairobi de devenir « une capitale de complot contre la RDC ». Depuis Washington, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a fustigé cette rencontre qualifiée de « prétexte à la paix », y voyant plutôt l’expression d’une « nostalgie des privilèges perdus » chez ses participants, dont plusieurs sont selon lui des « fugitifs, des condamnés ». Il a également dénoncé la « complicité avec les agresseurs de la RDC » de certains participants à ce conclave.
James Mutuba