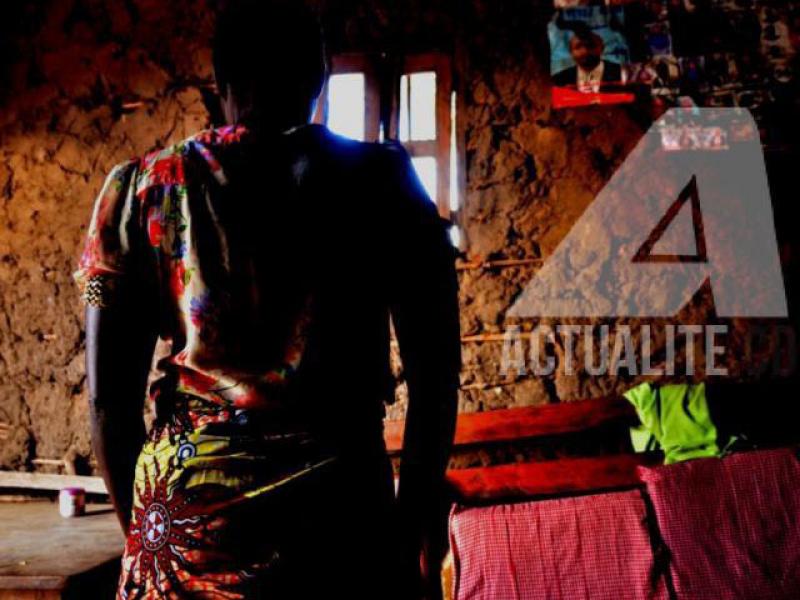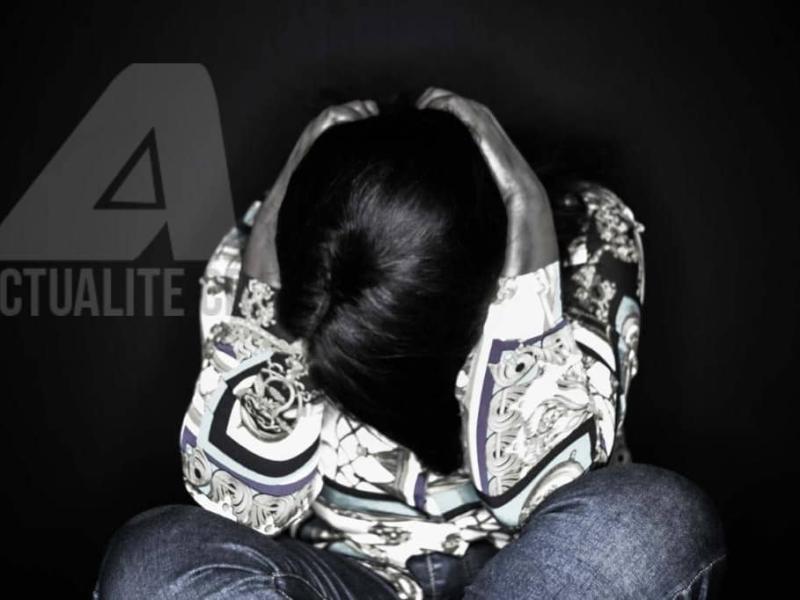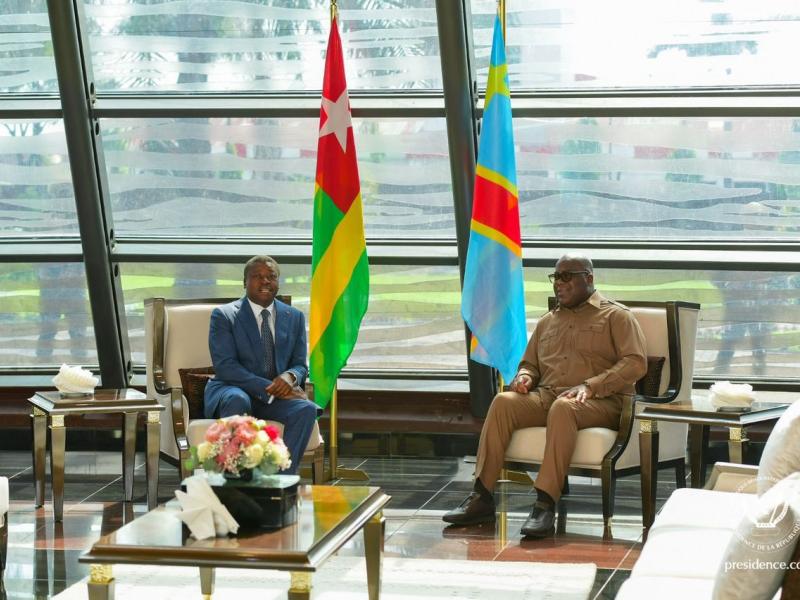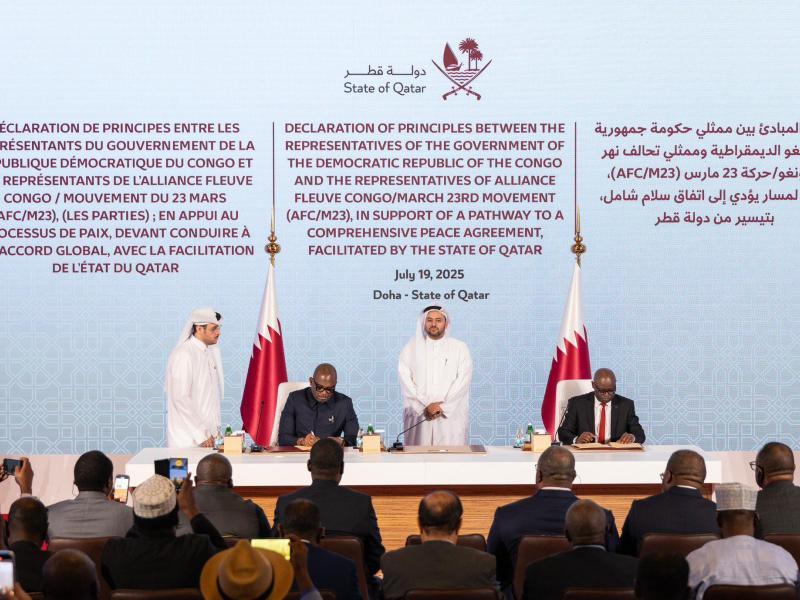L’ONG congolaise Journaliste en danger (JED) a publié samedi à Kinshasa un bilan de 2 670 cas de journalistes tués, portés disparus, détenus ou de médias détruits en République démocratique du Congo depuis 1994, selon son rapport annuel.
JED affirme que « le métier d’informer constitue l’un des métiers les plus périlleux pour ceux qui l’exercent en RDC », dénonçant des pressions « politiques, économiques, juridiques et judiciaires ».
L’organisation rappelle tirer « la sonnette d’alarme » depuis des années sur les « assassinats de journalistes », les « menaces », « intimidations » et « agressions », ainsi que les suspensions de médias. JED affirme aussi défendre la « reconnaissance de la Nation » pour les journalistes morts dans l’exercice de leur métier.
Selon le rapport, près d’une trentaine de journalistes assassinés figurent toujours sur une liste « qui reste ouverte », les responsables « continuant à courir » « sans qu’il n’y ait aucune enquête menée par la police ou la justice ».
« À ce jour, ils sont près d’une trentaine sur une liste qui reste ouverte, tant que ceux qui les ont tués ou commandité leurs assassinats continueront à courir… et qu’il n’y a aucune enquête menée par la police ou la justice », indique JED.
D’une manière générale, la RDC coche toutes les cases des neuf catégories d’atteintes à la liberté de la presse telles que répertoriées par JED et RSF : les assassinats de journalistes, les arrestations ou privations de liberté, les violences physiques et la censure, explique l’organisation.
La catégorie la plus fréquente reste celle des arrestations et emprisonnements de journalistes pour des durées variables. Vient ensuite la censure, qui englobe la fermeture des médias, l’interdiction d’émissions ou encore la destruction d’installations dans le but de réduire les médias au silence. Enfin, les violences physiques arrivent en troisième position, certaines ayant abouti à des assassinats, souvent précédés de menaces directes ou indirectes.