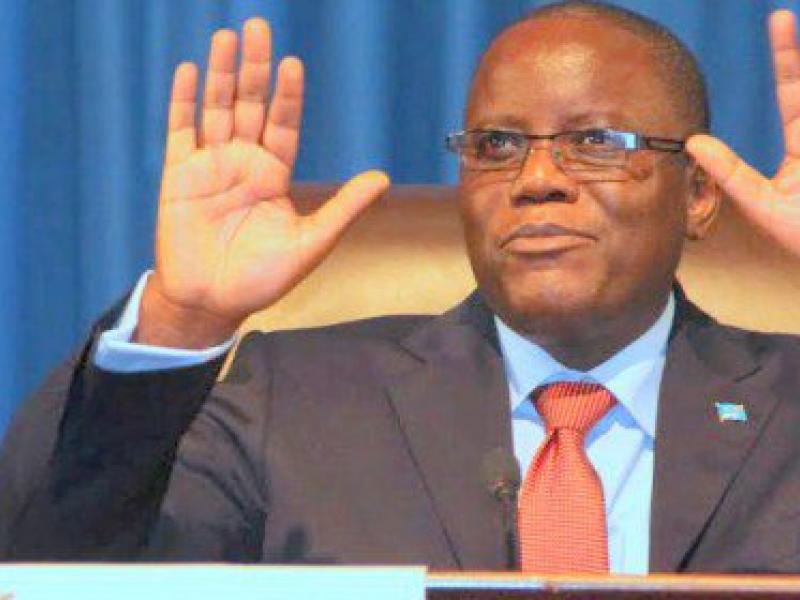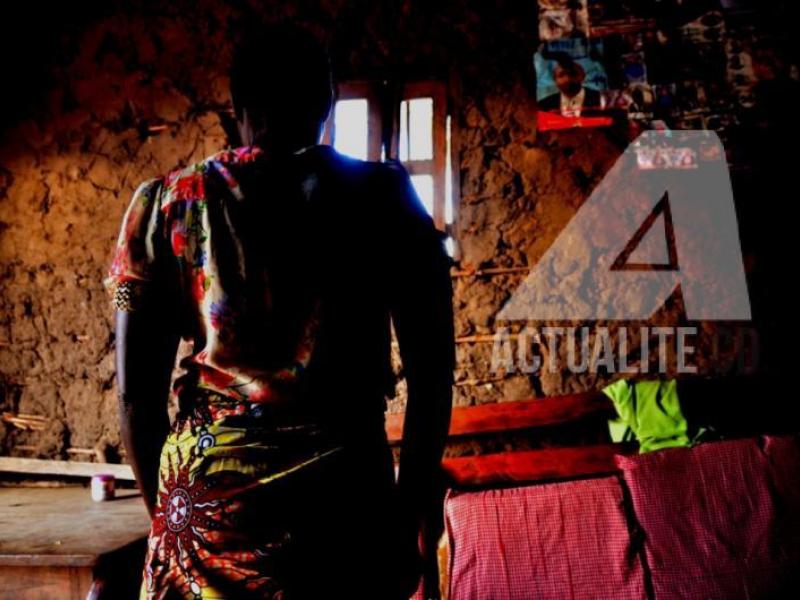Cette semaine, la chronique droits des femmes se penche sur le droit à l’avortement en RDC, entre interdictions légales, exceptions prévues par la loi, et réalités sur le terrain.
Un cadre légal restrictif, mais pas absolu
Pour mieux comprendre ce que dit concrètement la loi congolaise sur l’interruption volontaire de grossesse, nous avons interrogé Me Gisèle Nakuto, avocate spécialisée en droit de la santé et défenseure des droits des femmes.
Elle rappelle d’emblée que l’avortement est, en principe, interdit par le Code pénal congolais. L’article 165 punit toute femme qui se fait avorter, tout comme les personnes qui l’assistent, de cinq à quinze ans de servitude pénale, sauf dans un cas bien précis : lorsque la vie de la mère est en danger.
« Ce que beaucoup ignorent, c’est qu’une exception existe en droit congolais depuis très longtemps : si la grossesse met en péril la vie de la femme enceinte, l’interruption est légalement autorisée, sous supervision médicale », précise Me Nakuto.
Cependant, cette disposition reste floue, peu appliquée et très rarement invoquée, en raison d’une méconnaissance généralisée, tant par les professionnels de santé que par les magistrats et les femmes concernées elles-mêmes, a-t-elle indiqué.
Le Protocole de Maputo : un texte ratifié, mais ignoré
Depuis 2018, la RDC est également partie au Protocole de Maputo, un instrument juridique africain qui garantit, à son article 14, le droit des femmes à un avortement médicalisé dans plusieurs cas : viol, inceste, mise en danger de la santé physique ou mentale de la femme, ou malformation grave du fœtus.
« La ratification du Protocole de Maputo a élargi le cadre légal, mais sur le terrain, ce protocole n’est toujours pas intégré dans la législation nationale. Il n’a ni loi d’application, ni mécanisme effectif d’implémentation. En théorie, toute femme victime de viol ou porteuse d’une grossesse non viable devrait pouvoir bénéficier d’un avortement sécurisé. En pratique, les hôpitaux hésitent à le pratiquer, craignant des poursuites judiciaires », déplore l’avocate.
Malgré ces ouvertures légales, Gisèle Nakuto alerte sur un paradoxe inquiétant : des femmes sont encore poursuivies, voire emprisonnées, pour avoir mis fin à une grossesse non désirée, même dans des contextes extrêmes comme le viol ou la pauvreté.
« Les poursuites sont rares, mais elles existent. Et les sanctions sont lourdes, aussi bien pour les femmes que pour les médecins ou les sages-femmes qui les assistent, même quand l’intervention est justifiée médicalement. Face à ce flou juridique, de nombreuses femmes se tournent vers des avortements clandestins, souvent pratiqués dans des conditions sanitaires déplorables, au péril de leur santé et de leur vie », dit-elle.
Un silence médical et judiciaire qui coûte des vies
Les conséquences de ces avortements clandestins sont dramatiques : selon les estimations de l’OMS, plus de 50 % des avortements en Afrique subsaharienne sont considérés comme à risque, causant des milliers de décès chaque année. En RDC, les données précises manquent, mais les ONG signalent une hausse des complications liées à des avortements non médicalisés.
« Tant que la loi nationale ne clarifie pas les conditions d’application du Protocole de Maputo, les femmes continueront de souffrir en silence, parfois au prix de leur vie », alerte l’avocate.
Ainsi, pour faire évoluer la situation, Me Nakuto plaide pour une réforme de la législation congolaise sur l’avortement, incluant notamment :
- L’adoption d’une loi claire intégrant les dispositions du Protocole de Maputo ;
- La formation des agents de santé et des magistrats sur les exceptions légales existantes ;
- La création d’un cadre de dialogue entre juristes, médecins et société civile ;
- La dé-stigmatisation du recours à l’avortement médicalisé, notamment dans les cas de violences sexuelles.
Mais elle reconnaît que ces réformes se heurtent à de fortes résistances sociales et religieuses.
« Dans notre société, la femme est encore perçue comme un réceptacle, jamais comme un sujet de droit. Parler d’avortement, même dans les cas les plus graves, reste tabou ».
Au-delà des lois, l’avocate insiste sur l’importance de sensibiliser les communautés, les leaders d’opinion et les jeunes générations.
« Il ne s’agit pas de promouvoir l’avortement, mais de garantir le droit à la vie, à la santé, à la dignité. Ce sont ces droits que protège le Protocole de Maputo. Il est temps que la RDC passe de la parole à l’action ».
Nancy Clémence Tshimueneka