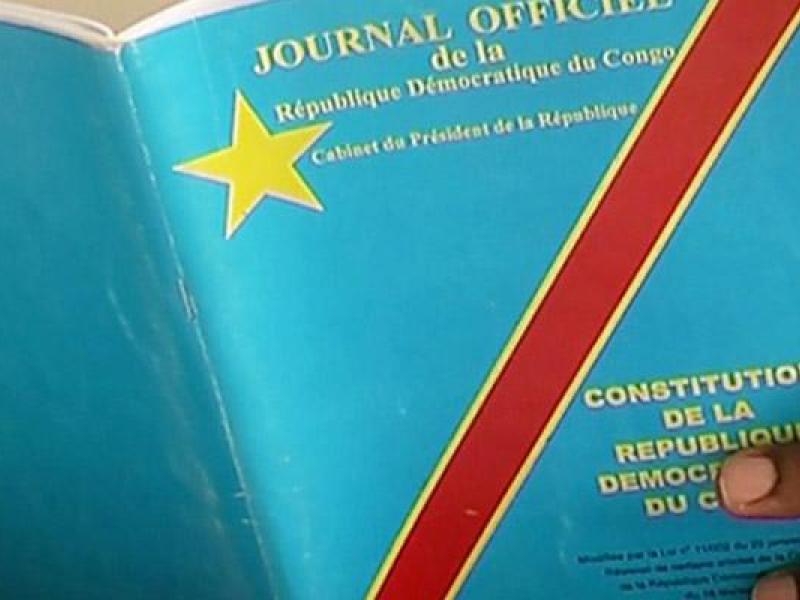Antoine Vumilia fait partie des jeunes qui se sont très vite engagés aux côtés de l'Alliance des forces pour la libération du Congo (AFDL), en 1996. Consumé par l'art et la poésie, le jeune homme est de la garde rapprochée du Mzee Laurent Désiré Kabila. A son décès, il est emprisonné avec plusieurs de ses camarades. A la prison de Makala, il passe ses nuits à écrire. Ses textes sont joués dans les plus grands théâtres au monde. Aujourd'hui, plus d'une vingtaine d'année plus tard, il est libre, deux documentaires lui ont été consacrés. Actuellement, il vit en Suède avec sa famille, dispense des cours de théâtre à l'Université de Stockholm, tout en essayant de décoloniser les espaces scéniques. Dans cet entretien, il revient sur son parcours et nous parle de sa passion pour l'art et la politique qu'il ne dissocie jamais.
Antoine Vumilia, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Il s’est passé de nombreuses années depuis « Qui a tué Laurent désiré Kabila ? » et « Adieu l’enfer ». Que devient Antoine Vumilia aujourd’hui ?
Ce que je deviens... Je deviens quelqu'un qui, sorti de l’enfer, se rend compte que le paradis est encore à construire. Je tente de marcher à rebours-chemin de mon histoire pour rassembler les bouts de moi, éparpillés ça et là, réapprendre à être un père pour mes enfants, un citoyen utile pour mes deux pays, la Suède et le Congo, mettre les bouchées doubles ... J'ai repris l'écriture, je suis remonté sur la scène, j'enseigne le théâtre aux jeunes franco-suédois, à Stockholm. Je suis devenu l’homme pressé de Paul Morand.
Vous avez été formé en dramaturgie des arts du spectacle à l’Université de Stockholm. Parlez nous de ce parcours.
J’ai obtenu cette licence en dramaturgie, en me spécialisant dans ce que j'appelle les esthétiques post-coloniales en plus de cela, j’ai étudié le cinéma documentaire à l'université de Linköping. Il était question pour moi tout d'abord de structurer et d'enrichir mes connaissances théoriques de ces arts dont j'avais acquis la pratique depuis l’adolescence. Ensuite il a été question d’interroger les pratiques scéniques non-européennes ou mixtes, ou plus précisément ce qu'on appelle le théâtre syncrétique. C ́est le coeur de ma démarche : décoloniser la scène, ou déconstruire le paradigme eurocentriste qui aujourd'hui empêche aux arts de pouvoir agir, ou comme dirait Dieudonné Niangouna, d ́être couillus. Tous les plus grands historiens du théâtre vous feront remonter les origines du théâtre à l’antiquité grecque. On a défini les canons de cet art d'une manière qui exclut de son champ les dramaturgies de l ́Égypte pharaonique, de l’Afrique subsaharienne précoloniale, de l’Inde précoloniale, etc. alors qu'une analyse postcoloniale à l'oeuvre de Brecht, de Shakespeare, peut révéler que les stratégies de communication de l'esthétique épique ou du théâtre élisabéthain ont préexisté ailleurs qu'en Europe. En se privant d ́accueillir franchement les dramaturgies impures et bâtardes des anciens colonisés, le théâtre européen est en train de devenir une vieille chose poussiéreuse, bonne à flatter le snobisme des milieux bourgeois et réveiller la nostalgie des vieux.
Des studios Kabako, à Kisangani, en passant par votre parcours artistique à Goma, on a l’impression que l’art est omniprésent dans votre vie...
L’art m'a toujours accompagné. J’ai du mal à le dissocier de la vie, ou encore de mon autre passion qu'est la politique: j ́ai été viré du petit séminaire parce que les prêtres ont trouvé dans mon casier un cahier rempli de poèmes érotiques. A l’époque, j’avais 14 ans. J ́ai repris une année du secondaire parce que je préférais écrire des poèmes pendant le cours des maths. Durant la période du maquis en 1996, je quittais la brousse pour monter des spectacles à Goma, et même quand j’ai commencé à travailler à la présidence sous Laurent-Désiré Kabila, je n’ai jamais arrêté. Le poétique est politique et dans sa meilleure forme le politique devient poétique : Césaire, Hugo, Taubira, Vaclav Havel, Brecht... peuvent en témoigner.
Dans les années 90, le Zaïre a besoin de changement. L’AFDL incarne ce changement. Vous vous enrôlez à l’époque. Plus de 20 ans plus tard quel regard avez-vous de cette époque ?
A l’époque, j’avais 20 ans, j’étais étudiant. Quand l'Afdl est arrivée, j'étais déjà marxisé comme pas possible. Et aujourd'hui en regardant cette époque, je me sens un peu comme un amant désabusé. Nous étions une génération dont la conscience politique s'est réveillée au début des années 90 dans la mouvance de l 'UDPS. C ́est cela qui nous a fait rentrer dans l’Afdl. Notre enthousiasme ne nous a pas laissé le temps de voir les dessous des cartes qu'étaient la vengeance aveugle et les manoeuvres stratégiques de contrôle de marchés de la part de ceux qui prétendaient nous accompagner. L'Afdl a inauguré une ère de domination sans complexe du Rwanda et de l ́Ouganda sur le Congo, de l'aggravation du pillage des ressources du pays par les multinationales, de la culture du viol comme arme de guerre...la liste est longue. C ́est vrai que nous nous sommes débarrassés de Mobutu et que notre niveau de culture politique est plus élevé en tant que peuple, mais je me demande s ́il fallait traverser toute cette vallée de larmes pour cela, et nous infliger encore 18 ans de médiocrité avec Joseph Kabila.
J’ai pu lire que vous avez continué à écrire en étant en prison peu de temps après l’assassinat de Laurent Désiré Kabila. Parlez nous de ces textes.
En prison, j’ai d’abord tenu un journal les trois premières années. Le but était pour moi de faire le tour de la douleur que je vivais et d’essayer de comprendre tout en entretenant la foi en ma propre humanité. Ensuite, j’ai écrit des textes pour les studios Kabako de Faustin Linyekula : un premier texte : « Un monologue de chien », en 2006, pour le spectacle Dinozord, qui a été donné à Avignon et dont la nouvelle version tourne encore, puis les textes de More, more,more... Future en 2009, c’est une sorte d’opéra ndombolo-punk qui a remporté un Bessie Award aux USA. Mais il y a aussi des tonnes de poèmes et l’ébauche d’un roman. J'écrivais comme si ma vie en dépendait, mais j’ai aussi lu comme jamais.
Ces textes qui vous ont valu quelques soucis en milieu carcéral ?
Il faut savoir qu’écrire en prison, c’est dangereux, surtout quand on est un détenu politique. Souvent j'attendais la nuit avant de commencer à écrire et j'avais aménager des cachettes pour dissimuler mes manuscrits. Parfois les gardiens tombaient dessus et ils n'avaient pas besoin de comprendre ce que j'écrivais pour se convaincre que je cherchais à renverser le gouvernement. J'ai enchaîné les punitions parce que j'écrivais. Mais je crois que j’ai vraiment frôlé la mort, le jour où un certain major Christian Ngoy, le même qui sera cité plus tard dans l'assassinat du défenseur des droits de l ‘homme, Floribert Chebeya, est venu m'interroger et me menacer de disparition en prison. C'était à l'époque où je filmais pour "Meurtre à Kinshasa".
Aujourd’hui vous êtes un artiste de renommée internationale. On vous a vu dans « Das Kongo tribunal » de Milo Rau ou encore « Une saison au Congo » qu’est-ce qui vous guide dans le choix de vos collaborations artistiques ?
N'ayant pas un cerveau calculateur, je n'ai pas de “ plan de carrière” artistique. Du coup, je prends les projets qui répondent le plus à ce que me disent mes tripes. Je crois en la puissance de la poésie, j'aime remettre en question les dogmes (surtout ceux du néolibéralisme) et j'aime me mettre en danger et sentir la montée d'adrénaline. Que ce soit auprès de Milo Rau, Faustin Linyekula ou Christian Schiaretti avec qui j’ai travaillé, j ́ai retrouvé la poésie, le doute et la folie.
Parlez nous de votre pièce « Odyssée d’un fantôme »
L’"Odyssée d ́un fantôme" est une performance que j'avais d'abord conçue comme un seul en scène, en 2012, quand David Van Reybrouck m’a reçu en résidence à Anvers, à la maison des auteurs de l’association Pen International. Après une création en 2015 avec l’aide d’un théâtre suédois, le Blekinge Regionteatern, aujourd'hui c'est un fait artistique qui tient beaucoup plus de la performance que du théâtre. Je suis sur scène avec Ornella Mamba qui m’assiste également à la mise en scène. Mais on travaille également et, pour la première fois, avec ma fille Flora. Elle a étudié le théâtre pendant trois ans et pratique la danse hip hop. Nous racontons comment nous avons vécu dans nos chairs l’histoire récente et trouble de la région des Grands Lacs africains. Comment a-t-elle vécu mes années de prison ? Qu’est-ce qui arrive lorsque la trajectoire d ́un individu entre en collision avec l’Histoire ? Flora danse beaucoup, mais on improvise aussi pas mal au milieu de la performance, et c'est à chaque fois différent. Personne ne sait à l'avance quelle question va jaillir. Le public aussi discute avec nous.
Pouvez-vous nous parler de votre travail actuel « La guerre du café n’aura pas lieu »
Le pitch tiendrait en une phrase : imaginez que vous-vous levez un matin, et personne ne peut trouver la moindre tasse de café, nulle part en Europe ! C'est l'histoire d'une jeune chanteuse suédoise accro au café qui se retrouve (sans café, puis sans internet, puis sans électricité...) seule avec son piano et les démons de sa famille dans le sous- sol d'une maison perdue au milieu d'une tempête de neige qui n’en finit pas. Elle réclame son droit au café, à la banane, au cacao et sombre dans la folie. C’est un spectacle qui a un pied dans l'absurde et l'autre dans le surréalisme. Je le développe avec Yasmine Modestine, qui est à la fois chanteuse, compositrice et actrice. C’est plein de chansons jouées live par Yasmine, de vidéos oniriques, d’odeur de café, de débats avec le public, bref un sacré chaos.
Propos recueillis par Kujirakwinja Nabintu