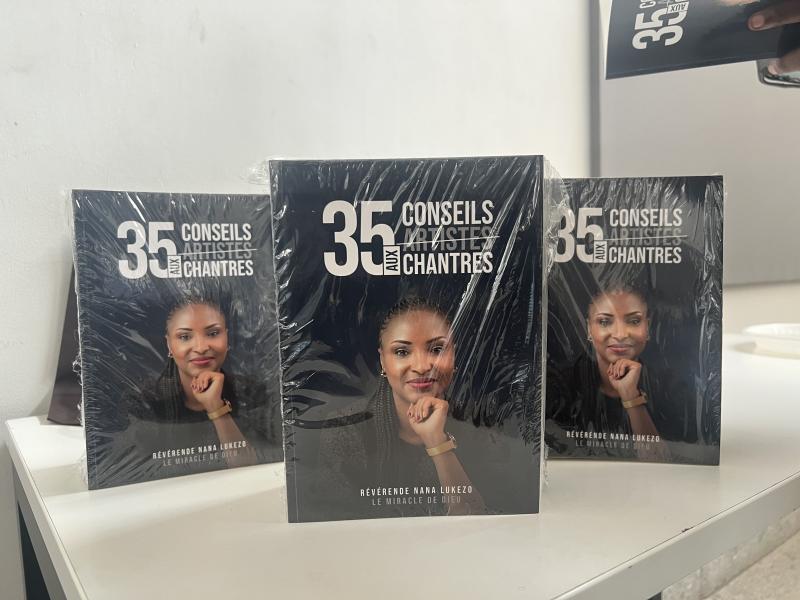La route nationale 1 entre Kinshasa et Matadi, un axe crucial mais en mauvais état, dissimule sous ses nids-de-poule des montages financiers opaques entre un ministre du gouvernement Tshisekedi et un businessman chinois. Mais aussi des soupçons de surfacturation soigneusement enterrés. Au-delà de ces problèmes techniques, la RN1 cache un lourd secret, sur fond de conflit d’intérêts potentiel dans le chef d’un ministre du gouvernement Tshisekedi et de soupçons de surfacturations. C’est ce que révèle l'enquête d'Actualite.cd avec ses partenaires de la Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique (PPLAAF https://www.pplaaf.org/fr/ ), Le Soir, De Standaard et de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP https://www.occrp.org/en ).
Enquête
Les eaux sont montées en quelques heures, charriant boue, détritus et fragments de tôle arrachés à des habitations précaires. A Kinshasa, mégalopole de plus de 15 millions d'habitants, les pluies d'avril 2025 ont une nouvelle fois transformé des quartiers entiers en zones sinistrées. Plus de 70 personnes ont perdu la vie.
En cause: d’abondantes pluies locales, combinées au ruissellement des précipitations torrentielles provenant de la province voisine du Kongo central, ont rapidement fait déborder les petits affluents urbains de la ville. Cela arrive presque tous les ans. Quand les quartiers populaires de la bouillonnante capitale congolaise ne sont pas ravagés, c'est une partie de la route nationale numéro 1 (RN1) qui est emportée. Cette route à péage stratégique relie Kinshasa aux ports du Kongo central, Matadi, Boma, Muanda, et à la courte façade maritime du pays, elle est cruciale pour son approvisionnement et l'économie du pays.
Depuis novembre 2008, un consortium représenté par un puissant homme d'affaires chinois est chargé de moderniser cet axe vital, avec un budget qui dépasse désormais le demi-milliard de dollars. Ces travaux visent non seulement à son entretien, mais également à la réalisation de travaux anti-érosion via la construction de canaux et caniveaux censés permettre l'évacuation des eaux de pluies.
Malheureusement, selon l'un des experts travaillant pour le ministère congolais des infrastructures, ces caniveaux sont souvent "sous-dimensionnés", avec une "mauvaise finition au niveau du remblais". D'où un problème récurrent d'ensablement qui, combiné aux effets du changement climatique et à une urbanisation anarchique, condamne les Kinois et les usagers de la RN1 à voir ces catastrophes se répéter.
Une facture qui explose
L'exploitation et l'entretien de la RN1 s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de concession de type Build-Operate-Transfer (BOT), un partenariat public-privé dans lequel l'acteur privé préfinance des travaux publics et récupère son investissement par des paiements de l’État ou d'autres recettes, comme ici celles issues de l’exploitation de péages.
C’était bien le projet initial pour la RN1. A en croire l’une des multiples versions du contrat de concession, datée de 2015, l’objectif initial était bien d’élargir certains tronçons de la route. L’une des filiales de la puissante société chinoise d’État China Railway Engineering Corporation (Crec) avait exprimé sa volonté de préfinancer ces travaux par ce biais. Ce document mentionne aussi que sa filiale, Crec7, a fait une “association momentanée“ avec une autre entreprise de droit congolais, la Société des péages du Congo (Sopeco), bombardée leader du consortium et concessionnaire.
De nouveaux contrats en avenants, la durée de la concession s’allonge et la liste des travaux aussi. Résultat : leur montant a explosé, passant de 138 millions de dollars en 2010 à 378 millions en 2018, jusqu'à atteindre les 514 millions en 2016.
Selon des documents officiels consultés par Le Soir et ses partenaires, son apport reste très limité puisque sur ces 514 millions de dollars officiellement dépensés, "l'association" Sopeco / Crec7 n'a participé qu’à hauteur de 16,4 %, soit 84,2 millions de dollars. Le reste est sorti des caisses de l’État.
En échange de ce maigre prêt, rémunéré avec un taux d'intérêt de 6% par an, le concessionnaire obtient en plus, au moins depuis 2015, 10% de l'ensemble des recettes de ces péages comme frais de gestion, ce qui représente sur la même période un minimum de 40 millions de dollars en 2023.
Mais au final, les recettes ne dépassent jamais les dépenses. Résultat : l'Etat congolais est le seul qui ne touche rien ou presque sur l'exploitation de ces péages.
Le roi chinois des péages congolais
Pour le politologue Tim Zajontz, maître de conférences à l’université de Fribourg et spécialiste des partenariats public-privé sino-africains, ce genre de contrat donne généralement « une marge de manœuvre importante » au partenaire privé pour choisir ses exécutants. Il précise toutefois que pour éviter les abus, les États doivent s’assurer d’un encadrement strict, avec des études de faisabilité indépendantes. Faute de contrôle, les engagements contractuels — investissements, normes de qualité, entretien — risquent de ne pas être respectés.
Or, en RDC, ce travail est censé être assuré par l’Agence congolaise des grands travaux (ACGT) qui est désignée comme le maître d’œuvre délégué du ministère des infrastructures.
Cette agence créée en 2008 a un objet très spécifique : la coordination, la supervision et le contrôle de l’exécution des projets d’infrastructures spécifiés dans les Conventions et Accords de Collaboration signés par les partenaires Chinois. Plus surprenant, le décret l'instituant précise qu'elle assure son fonctionnement grâce à des fonds "de partenaires chinois" comme des "dotations budgétaires". En d'autres termes, elle a la particularité d'être en partie financée par ceux qu'elle doit contrôler.
L'un des principaux bénéficiaires de contrats de l'ACGT, c'est le patron de Sopeco, "Simon" Cong Maohuai. Surnommé "Monsieur Simon" ou "Simon le Chinois", cet homme d'affaires est devenu - depuis son arrivée dans le pays à la fin des années 90 et en particulier sous l'ancien président Joseph Kabila - un acteur économique incontournable avec des investissements dans les secteurs de l'exploitation minière, de la production d'électricité, de la construction ou même à travers son hôtel cinq étoiles à Kinshasa, Fleuve Congo.
La Sopeco, concessionnaire d’un millier de kilomètres de routes parmi les plus rentables du pays, a obtenu à elle seule pour près d'un milliard de dollars de contrats de l'ACGT.
Un ministre lié à un sous-traitant
Le dernier avenant au contrat de concession Kinshasa - Matadi date d'avril 2019. Joseph Kabila contrôlait toujours le parlement et son successeur Félix Tshisekedi essayait de mettre en œuvre son programme des 100 jours qui prévoyait la rénovation de plusieurs tronçons de la RN1. La Sopeco obtint une prolongation de son contrat jusqu'en 2029. Simon le Chinois aura passé 20 ans de sa vie à profiter des principales routes commerciales du Congo.
La société de “Simon” Cong ne va pas opter pour Crec7, filiale d'une des plus grandes sociétés de construction au monde, pour certains de ces travaux et notamment le volet anti-érosion; La Sopeco va se choisir un nouveau partenaire, la Société d’ingénierie et de construction (SIC), créée le 22 mai de cette même année à en croire ses statuts. Elle venait à peine d'être lancée quand elle obtint en juin 2019 son premier contrat de sous-traitance de réhabilitation de 25 millions de dollars.
Dans son actionnariat, on retrouve deux hommes d'affaires chinois avec une certaine expérience dans le domaine de la construction de routes. Ils détiennent à eux deux 65%. Le troisième actionnaire, avec 35%, s'appelle Widal Investment, contrôlée par un proche de Monsieur Simon : Guy Loando. Il est alors sénateur de la coalition de l'ancien chef d'Etat et va devenir deux ans plus tard ministre d’État à l’Aménagement du territoire de son successeur Félix Tshisekedi, un poste qu'il n'a plus quitté depuis, malgré plusieurs scandales.
Cet ancien avocat d'affaires ne l’a jamais caché, il considère Cong Maohuai comme son “mentor”. « M. Simon est humble, sage et plein de vision », peut-on lire sur le site web de sa fondation caritative, également appelé Widal.
Homme de paille?
Widal Investment est une société familiale. Sa femme Déborah et lui détiennent collectivement 10% de ses parts, le reste est réparti entre les trois jeunes enfants du couple, dont l'aîné qui avait à l’époque 14 ans. Guy Loando est identifié dans les documents comme leur représentant légal. Sa femme est présentée comme celui de la société, rebaptisée depuis L-Investment.
En juillet 2019, ou bout d’un mois d’existence, les parts de Widal Investment au sein de SIC sont transférées à un certain Baby Mambo Kapaye. Notre enquête a révélé que cet inconnu est lié à l'épouse du ministre par alliance et qu'il occupait déjà à l'époque des fonctions dans deux des filiales de Widal Investment et une organisation dirigée par le couple Loando, dont la fameuse fondation Widal.
Contactés, M. Loando et Mambo Kapaye ont reconnu leurs liens familiaux, mais ils ont refusé de confirmer que Mambo agit en tant que mandataire du ministre et de sa famille dans SIC.
Guy Loando a même déclaré qu'il n'a "reçu aucun avantage personnel" de cette société, puisqu'il n'en était pas actionnaire. Interrogé sur sa signature qui figure sur les statuts de SIC, Loando a déclaré qu'il s'agissait « d'informations privées et confidentielles ». Baby Mambo a quant à lui refusé de répondre à des questions sur SIC par téléphone.
Après ce premier contrat de 25 millions de dollars, SIC s'est vu attribuer en 2019, 2020 et 2021 plusieurs contrats supplémentaires d'un montant cumulé de 45 millions dollars.
Un rapport accablant enterré
En octobre 2020, une enquête sur la Sopeco et le contrat de concession de la RN1 est ordonnée. L’Inspection générale des finances (IGF), un gendarme financier qui dépend de la Présidence, est mandatée pour contrôler les recettes perçues et les travaux réalisés de 2009 à 2020.
A cette époque, Félix Tshisekedi va lancer des consultations présidentielles, il cherche à renverser la majorité de Joseph Kabila au parlement et à lancer l’Union sacrée de la Nation, sa propre coalition.
Guy Loando assure qu’il n’était pas au courant de cette enquête et qu’il n’a jamais été inquiété dans le cadre de ce dossier. Il va être parmi les sénateurs de Kabila l’un des plus actifs dans la mise en place de la coalition présidentielle. D’anciens collègues au Parlement assurent même qu’il a contribué à son financement. “Guy Loando a ses propres affaires, mais il n'est pas si riche”, explique un sénateur. “Tout le monde sait que son argent et son pouvoir, ça vient de Monsieur Simon”. Une source à la présidence explique même que “c'est lui qui a servi à introduire Monsieur Simon dans le cercle du président”.
Les faits relevés par l’IGF sont pourtant accablants, d’après ce rapport confidentiel obtenu par Le Soir et ses partenaires. Après avoir examiné les relevés de compte des péages à la Rawbank, les inspecteurs accusent la Sopeco de ne pas avoir déclaré plus de 193 millions de dollars de recettes entre 2015 et 2019. Ils rejettent aussi pour plus de 35 millions de dépenses qui n’étaient pas prévues dans les différents contrats. L’affectation de 57 millions de recettes en 2020 n’aurait pas non plus pu être justifiée.
Mais ce n’est pas tout. L’IGF découvre surtout qu’en l’absence d’études préalables réalisées par l’ACGT, des marchés ont été surévalués par rapport aux coûts réels des travaux réalisés. C’est patent à l’examen des factures fournies par Sopeco: la société de Monsieur Simon parvient rarement à justifier plus de 40% des dépenses effectuées. Parmi les projets incriminés, il y en a deux de SIC.
Pour tous ces faits, les inspecteurs recommandent des poursuites judiciaires contre “Simon” Cong Maohuai et plus de deux douzaines de fonctionnaires pour "détournement de fonds publics".
Leur rapport est remis le 23 avril 2021, une dizaine de jours à peine après la formation du gouvernement. Le nom de SIC et de Loando n’est jamais mentionné. L'IGF, la Sopeco et Cong n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les suites données à ce rapport. Apparemment inexistantes.
Sonia Rolley (Actualité.cd)