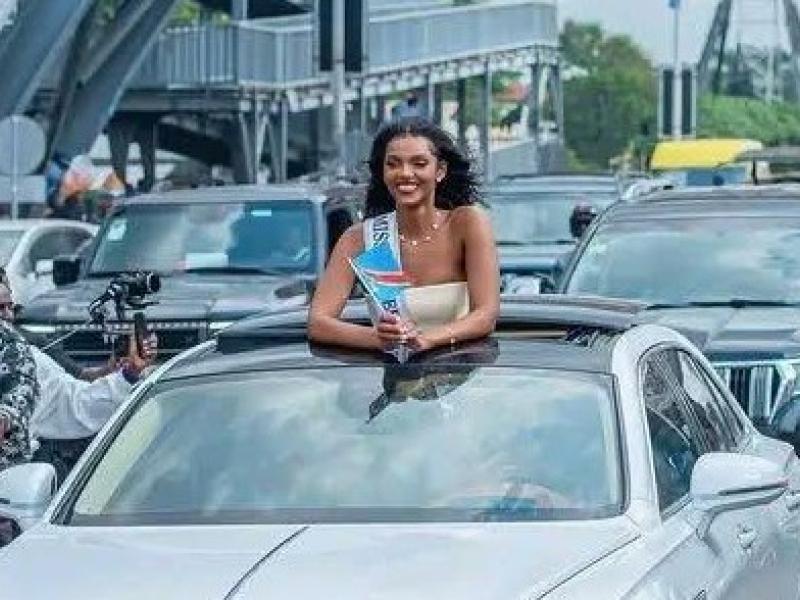En République Démocratique du Congo, le débat sur l’égalité entre hommes et femmes ne peut être complet sans évoquer la question de l’accès à la terre et à la propriété. Alors que la législation reconnaît en principe ce droit à tous les citoyens, dans les faits, les femmes continuent de se heurter à des obstacles juridiques, administratifs et surtout sociaux qui en limitent l’exercice.
Que dit réellement la loi congolaise ?
Selon Maître Roger Mumbiyi, avocat spécialisé en droit foncier, la Constitution congolaise (article 34) garantit le droit à la propriété privée à tous, sans distinction de sexe.
« En matière foncière, la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, telle que modifiée, reste le texte de référence. Elle ne contient aucune disposition discriminatoire à l’égard des femmes : toute personne peut acquérir, posséder et transmettre des terres. En théorie donc, une femme congolaise a les mêmes droits qu’un homme pour acheter une parcelle, hériter d’une concession ou gérer un patrimoine foncier », explique-t-il.
Mais il souligne qu’il existe un écart entre la théorie et la réalité.
« Sur le terrain, la situation est plus complexe. Les obstacles ne viennent pas toujours de la loi, mais de la pratique. Dans plusieurs provinces, la tradition continue d’imposer que les terres familiales soient attribuées uniquement aux héritiers masculins. Les femmes sont souvent invitées à se contenter d’un droit d’usage limité, par exemple cultiver, mais pas vendre ni hypothéquer ».
Dans certaines chefferies coutumières, la délivrance d’un certificat d’enregistrement à une femme célibataire est encore perçue comme une exception, poursuit-il.
« Les mariées doivent parfois présenter une autorisation de leur conjoint pour valider une transaction, alors que cette exigence n’existe pas dans la loi ».
Au-delà des coutumes, les lenteurs administratives compliquent aussi l’accès des femmes à la propriété. « Les services fonciers sont souvent saturés, les frais de dossiers exorbitants, et les risques de double attribution de titres découragent de nombreuses femmes », note Me Mumbiyi.
Ce contexte favorise les abus : certaines veuves, par exemple, voient leurs terres confisquées par la belle-famille, avec la complicité de fonctionnaires locaux, malgré leurs droits légaux.
Le droit à l’héritage, un champ de bataille
L’héritage constitue un autre terrain où l’écart entre textes et pratiques est flagrant. Selon le Code de la famille (révisé en 2016), la fille et le fils sont censés hériter à parts égales. Mais dans la réalité, dans de nombreuses communautés, les filles héritent peu ou pas de terres, selon l’avocat.
« Lorsqu’une femme revendique son droit successoral, elle est parfois accusée d’aller contre la coutume, voire de menacer l’unité familiale ».
Quels recours pour les femmes ?
En théorie, plusieurs mécanismes existent pour protéger les droits fonciers des femmes, selon l’avocat :
- Saisir les tribunaux pour contester une spoliation ou une exclusion de succession.
- Demander l’appui des ONG et associations de femmes juristes, qui accompagnent de plus en plus de dossiers fonciers.
- Mobiliser les inspections foncières pour dénoncer les abus administratifs.
« Mais ces recours nécessitent du temps, des moyens financiers et une certaine connaissance des lois; trois conditions qui ne sont pas toujours réunies pour les femmes, surtout en milieu rural », déclare l’avocat.
Pour lui, au-delà des textes, c’est donc un véritable changement culturel et institutionnel qui est nécessaire.
« il faut une vulgarisation plus large des lois, la formation des chefs coutumiers et des fonctionnaires, mais aussi un accompagnement spécifique pour les femmes dans les procédures foncières. Sinon, leurs droits resteront théoriques. Car posséder une terre, ce n’est pas seulement une question économique : c’est aussi une question de dignité, de sécurité et d’autonomie ».
Nancy Clémence Tshimueneka