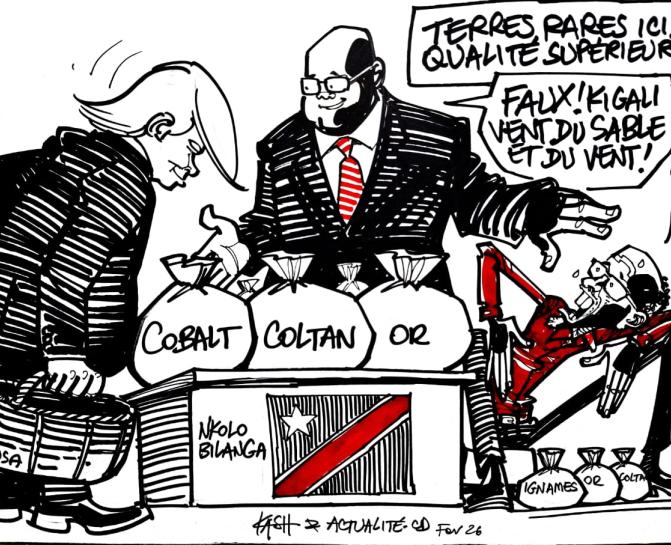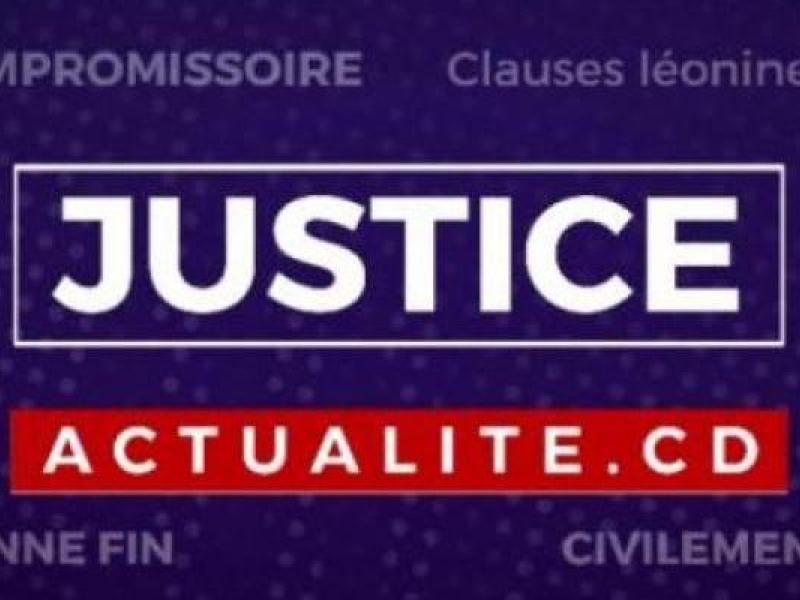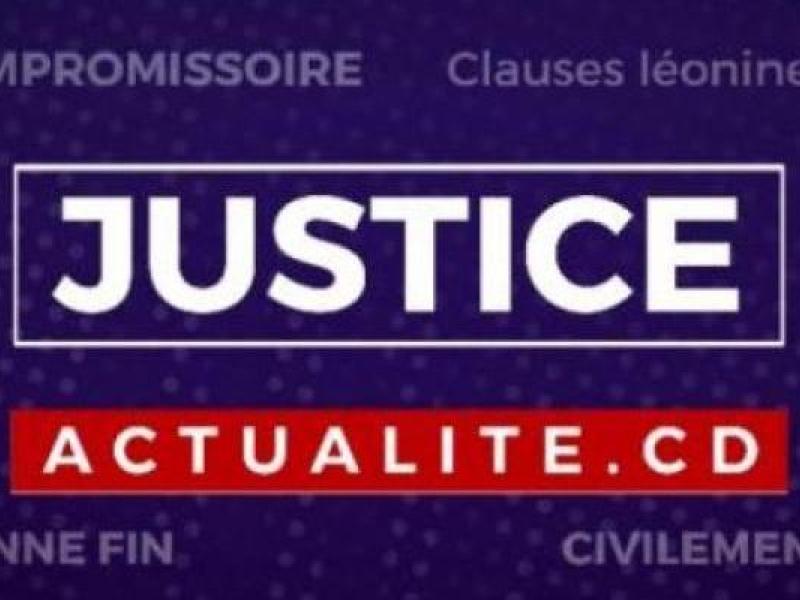En droit pénal, la responsabilité ne s’érige qu’à partir d’une base : l’imputabilité. Elle est cette capacité juridique de répondre de ses actes, parce qu’on les a compris, voulus et décidés. Or, lorsque l’auteur est atteint de démence, c’est-à-dire d’un trouble mental suffisamment grave pour altérer son discernement, ce fondement vacille. La démence vient rompre le lien entre la conscience et l’action, entre la volonté libre et le geste accompli. Car punir suppose un choix. Or, le dément n’a pas choisi : il a été emporté.
Le droit pénal congolais, à l’instar de nombreux systèmes de droit, consacre le principe selon lequel « nul ne peut être tenu pénalement responsable d’un acte accompli alors qu’il était en état de démence ». L’acte subsiste matériellement, parfois avec gravité. Mais sur le plan juridique, il est vidé de son intention, et l’auteur devient inapte à porter la faute.
Toutefois, cette cause d’irresponsabilité ne s’invoque pas à la légère. Elle requiert une preuve rigoureuse : un diagnostic médical circonstancié, et surtout, un lien direct entre l’état de démence et le moment de la commission de l’infraction. La justice ne se contente pas d’un trouble mental déclaré : elle exige qu’il ait annihilé, au moment des faits, toute capacité de discernement. Ce qui a été le cas avec Honorine Porsche.
Ainsi, en posant la question de la démence, le droit pénal ne nie pas l’acte : il interroge la conscience de l’acteur. Il ne cherche pas seulement à punir, mais à comprendre. Car en dernière instance, le droit pénal n’est pas seulement la main de la sanction ; il est aussi le regard de la raison, et parfois, de la compassion.
Desk Justice/ ACTUALITE.CD