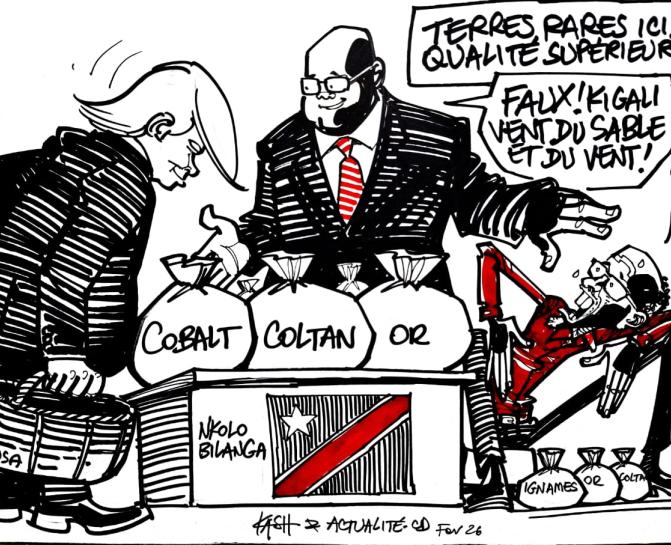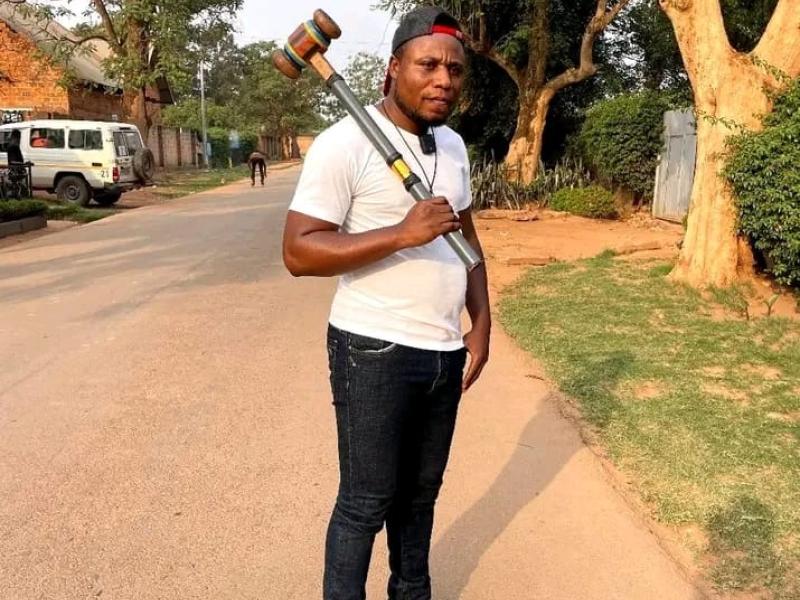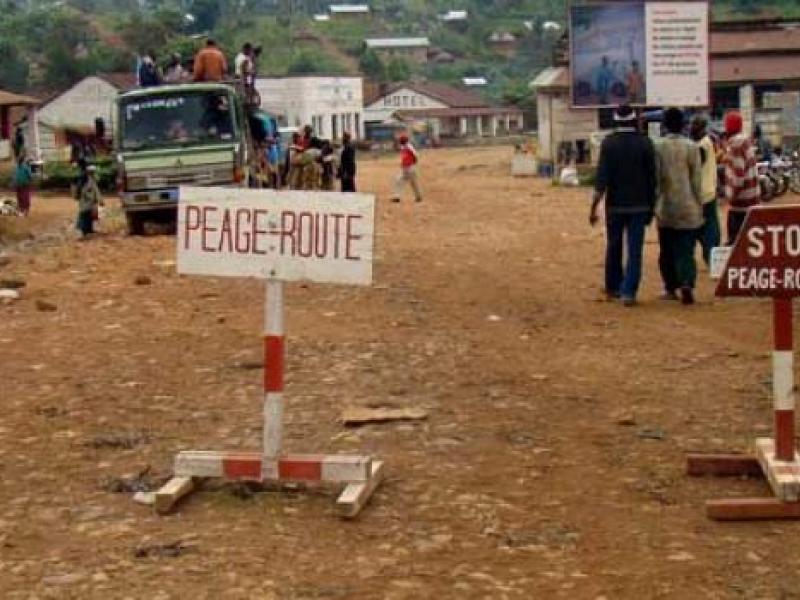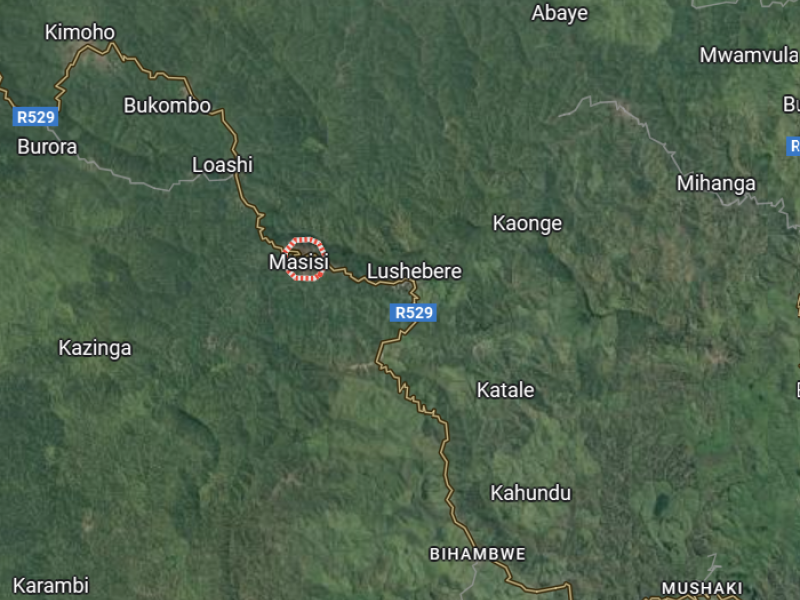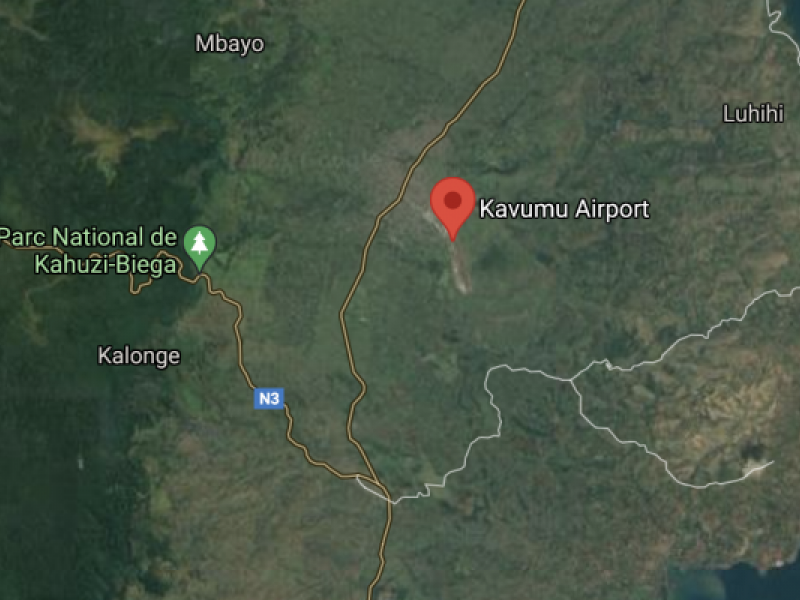Le mot “Liboke” a officiellement fait son entrée dans l’édition 2026 du Petit Larousse de la langue. Originaire du lingala, une langue bantoue largement parlée en République Démocratique du Congo et dans plusieurs régions d’Afrique centrale, Liboke désigne un plat traditionnel emblématique, généralement préparé dans des feuilles de bananier.
Ce geste marquant n’est pas passé inaperçu. Interrogé à ce sujet, Yann Kheme, assistant au Département de français à l’ISP/Gombe et ancien enseignant à l’école Cartésien y voit une reconnaissance d’un mot vivant, assumé et diffusé au-delà des frontières du Congo, que ce soit à travers la littérature, la musique ou les réseaux sociaux.
« S’ils ont jugé pertinent de l’intégrer aujourd’hui, c’est qu’ils ont constaté une fréquence élevée de son usage, aussi bien dans les conversations quotidiennes que dans les écrits », explique Kheme.
De son côté, Edimo Lumbidi, animateur culturel et enseignant de lingala, considère cette entrée comme un droit plutôt qu’une reconnaissance.
« C’est dans l’ordre des choses. Dans toutes les langues, il y a des emprunts : le français prend à l’anglais et inversement. Il est donc tout à fait normal qu’une langue aussi riche que le lingala soit également source », dit-il.
Bien plus qu’un simple ajout, cette intégration illustre une évolution de la langue française elle-même, influencée par ses locuteurs non natifs, notamment en Afrique francophone.
« Nous avons le français en partage avec cette grande nation mais ce partage est souvent à sens unique. Voir un mot comme "liboke "franchir les murs parfois hermétiques de la norme lexicale est une petite victoire. Un clin d’œil à ceux qui, dans les textes ou les rues de Kinshasa, ont fait vivre ce mot bien avant qu’il ne reçoive la bénédiction des dictionnaires », rappelle Yann Kheme.
Mais cette démarche, rare, ne fait pas l’unanimité. Edimo met en garde contre une possible mauvaise interprétation des mots en lingala par les linguistes francophones.
« Ils ne peuvent pas les analyser scientifiquement sans collaborer avec nous, les linguistes congolais, qui avons une vraie proximité avec les locuteurs natifs », estime-t-il.
Et de rappeler la richesse sémantique du mot :
« À l’origine, liboke signifie “petit groupe”, et son pluriel maboke désigne les petits groupes, souvent associés aux troupes de théâtre congolaises. Il ne faut donc pas réduire ce mot à sa seule dimension culinaire ».
Yann Kheme s’interroge sur le choix des mots au détriment d’autres. « Pourquoi des expressions comme “la Congolexicomatisation” d’Eddy Malou, devenue virale sur Internet, ne figurent-elles pas également dans les dictionnaires ? », se demande-t-il. Une façon de pointer du doigt les critères parfois flous qui régissent l’acceptation des mots, surtout ceux issus d’Afrique.
« Peut-on imaginer que cela ouvre une nouvelle audience à la culture congolaise portée par sa gastronomie, sa musique, son style ? J’en suis convaincu », conclut M. Kheme.
Le “Liboké” est un plat emblématique congolais préparé en enveloppant du poisson ou de la viande, marinés et épicés, dans des feuilles de bananier avant d’être cuits à l’étouffée. Présent aussi bien sur les tables familiales que lors des festivités, il s’est également imposé comme une street food très appréciée, faisant du “Liboké” un incontournable de la cuisine congolaise, à la fois populaire, accessible et porteur d’identité.
Son entrée dans l’édition 2026 du Petit Larousse illustré salue ce savoir-faire culinaire unique et contribue à faire rayonner la richesse gastronomique congolaise à l’international. Chaque année, le célèbre dictionnaire accueille des mots issus de langues et cultures diverses. Le “Liboké”, en tant que plat et méthode de cuisson originaire du bassin du fleuve Congo, notamment en RDC et en République du Congo, s’inscrit ainsi dans le processus des emprunts linguistiques, à travers lequel un mot étranger intègre une nouvelle langue d’usage.
Rachel Mulowayi, stagiaire UCC