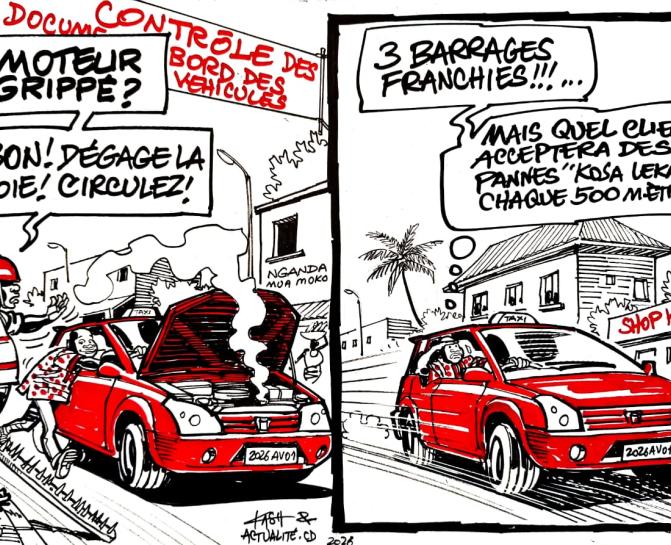La situation sécuritaire dans l'Est de la République Démocratique du Congo demeure préoccupante.
Face à cette situation, la question du dialogue comme solution pour sortir de la crise demeure inexploitée. Mais faut-il vraiment engager ce dialogue ? À ce sujet, le Desk Femme d'Actualité.cd a rencontré quelques Kinoises pour recueillir leur opinion sur l’option du dialogue et savoir si elles croient qu’il peut réellement offrir une issue au retour de la paix durable.
Pour Jolie Nkuna, mère de famille résidant à Ngaba, le dialogue est une nécessité, mais il doit être encadré par des conditions strictes. "Le dialogue est la seule solution pour mettre fin à la guerre dans l’Est. Les violences ne cesseront que si les différentes parties se retrouvent autour de la table pour discuter de leurs différends et de leurs intérêts. Chaque jour, des innocents meurent dans des combats inutiles", a-t-elle déclaré, en plaidant pour une initiative de paix soutenue par la communauté internationale.
Cependant, Lycresse Ebour, licenciée en sciences sociales, souligne qu’un dialogue sans garanties de mise en œuvre serait voué à l’échec. "Les dialogues passés ont échoué parce qu’il n’y avait pas de mécanismes de contrôle et de sanctions. Si l’on veut vraiment que cette fois cela fonctionne, il faut que les responsables de la violence soient tenus responsables et que des conditions strictes soient imposées", a-t-elle précisé.
De son côté, Laetitia Ndaya, commerçante, insiste sur l’importance d’inclure les victimes directes de la guerre, notamment les déplacés, dans les discussions. "Les accords de paix ne serviront à rien si ceux qui souffrent directement de la guerre ne sont pas impliqués. Les groupes armés doivent certes être mis à table, mais les voix des femmes, des enfants et des jeunes, qui vivent dans l’insécurité permanente, doivent aussi être entendues", a-t-elle souligné.
Certaines Kinoises, en revanche, expriment des doutes quant à l’efficacité d’un tel dialogue. Solange Rafiki, une ancienne réfugiée du Kivu, n’est pas convaincue que les négociations puissent apporter une paix durable. "On a vu trop de dialogues qui n’ont rien donné. Des promesses de cessez-le-feu ont été faites à plusieurs reprises, mais rien n’a changé. Les groupes armés continuent d’agir en toute impunité, et les populations souffrent", constate-t-elle. Selon elle, la RDC a besoin de réformes profondes de son système de sécurité et d’une plus grande volonté politique pour que la paix devienne une réalité.
Jeanine Elolo, une actrice socio-politique, partage ce scepticisme. "Les dialogues n’ont jamais résolu le problème de fond, qui est la mauvaise gestion des ressources naturelles et le manque de contrôle de l’État sur tout le territoire", a-t-elle affirmé. Elle estime qu’en l’absence d’une véritable réforme de la gouvernance et des institutions, tout dialogue ne serait qu’un pansement sur une plaie béante.
Pour Alice Ndombe, licenciée en informatique, un dialogue ne pourra réussir que si des médiateurs internationaux et des garants étrangers (comme l’Union africaine, l’ONU, ou des puissances régionales) sont impliqués. " Les dialogues réussis dans le passé, notamment en Afrique du Sud, ont montré que l’implication de la communauté internationale était déterminante pour garantir la bonne foi des parties prenantes. L'absence de médiateurs sérieux dans la crise congolaise a toujours permis à certains acteurs de gagner du temps sans respecter leurs engagements", a-t-elle précisé.
Andrea Kiabu, étudiante en droit, considère pour sa part, que le dialogue ne peut se limiter à des discussions formelles entre belligérants, mais doit être accompagné d’actions concrètes.
"Il faut viser la réforme de l’armée et de la police. L’État doit reprendre en main la sécurité de ses citoyens, au lieu de laisser des groupes armés semer la terreur. Il est également essentiel de décentraliser et de revoir la gestion des ressources minières, car c’est ce qui alimente la violence. L’argent des minerais ne profite pas aux communautés locales, et cette situation doit changer. Enfin, il faut réformer l’éducation et la réinsertion des jeunes. Ceux qui sont recrutés par les groupes armés le font souvent par désespoir. Si nous voulons réellement en finir avec la violence, il faut offrir à ces jeunes des alternatives : éducation, emploi et opportunités", a-t-elle expliqué.
Nancy Clémence Tshimueneka