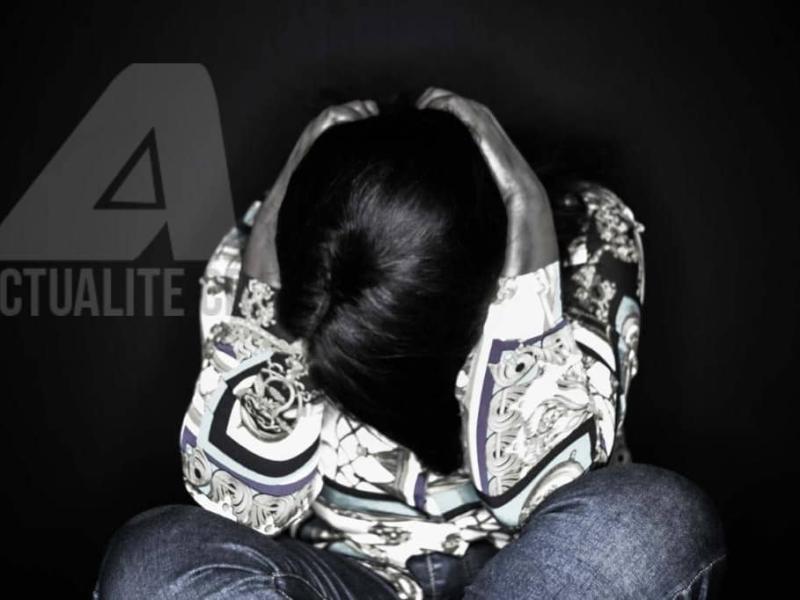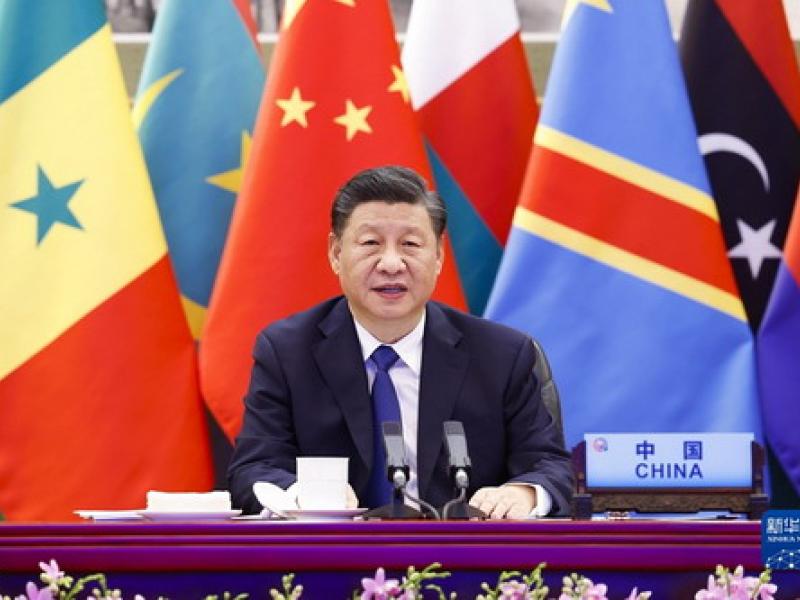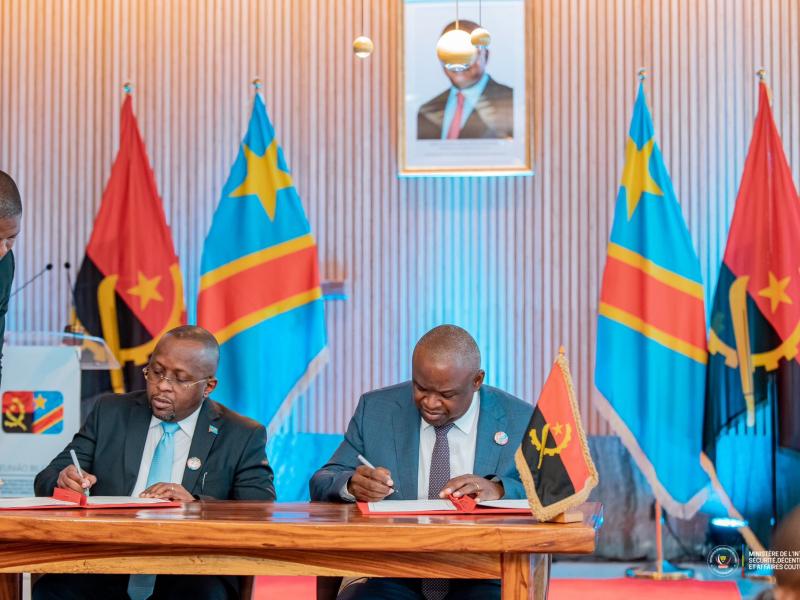Tribune de Roger-Claude Liwanga
Professeur de droit et de négociations internationales avancées à Emory University (Atlanta, USA)
Un mois après la signature de l’Accord de paix de Washington, l’évaluation révèle que seulement 26,6 % des tâches prévues (soit 8 sur 30) ont connu un début d’exécution. Le score cumulé de ces 8 tâches partiellement mises en œuvre s’élève à 27,5 points sur un total possible de 80, soit un taux d’exécution d’environ 34 %.
Le 27 juin 2025, la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda signaient à Washington un Accord de Paix historique, sous l’impulsion diplomatique des États-Unis. Ce texte ambitieux (dont le Concept d’opérations du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces/levée des mesures défensives par le Rwanda, « CONOPS », du 31 octobre 2024 fait partie intégrante) est censé mettre fin à un conflit prolongé dans l’Est de la RDC. Il repose sur plusieurs piliers majeurs : respect de l’intégrité territoriale, cessation des hostilités, désarmement et réintégration des groupes armés, coopération économique régionale, protection des civils, respect du droit international humanitaire, et mise en place d’un mécanisme conjoint de sécurité.
Un mois après sa signature, un rapport officiel publié ce 30 juillet dresse un premier état des lieux de sa mise en œuvre. Cette évaluation, qui couvre la période du 27 juin au 27 juillet 2025, repose sur un instrument analytique conçu à cet effet : l’Outil de Mesure de la Mise en Œuvre de l’Accord de Paix (OMMAP). Proposé initialement dans une note de réflexion publiée en juin 2025, alors que l’accord était encore en négociation, cet outil vise à mesurer, de manière rigoureuse et structurée, l’avancement de la mise en œuvre des engagements pris.
Un démarrage lent, mais encourageant
Les premiers résultats de l’analyse montrent que seulement 26,6 % des tâches prévues par l’accord ont connu un début d’exécution — soit 8 sur les 30 engagements identifiés. Parmi elles, certaines ont été engagées de manière limitée ou intermédiaire. Le score d’exécution réalisée cumulé de ces tâches s’élève à 27,5 points sur un total possible de 80, soit un taux d’exécution global d’environ 34 %. Certes, ce chiffre peut sembler modeste, mais il illustre néanmoins une volonté initiale d’action concrète, dans un contexte encore fragile. Il s’agit d’un signal positif qui peut servir de tremplin pour les prochaines étapes du processus de paix.
L’analyse met également en lumière un aspect crucial du processus : l’interdépendance entre les tâches. En effet, la majorité des 22 tâches restantes et non exécutées ne pouvait être mise en œuvre de manière autonome. Leur réalisation dépend directement de l'accomplissement préalable de certaines tâches principales. Ce constat appelle à une approche stratégique, séquencée et coordonnée si l’on veut éviter un blocage progressif du mécanisme.
Des signaux positifs
Sur le terrain, les premiers effets de l’Accord se font sentir. Trois éléments positifs ressortent de cette première phase: D’abord, une baisse significative de la rhétorique belliqueuse dans les discours publics des autorités congolaises et rwandaises, témoignant d’une preuve de retenue dans leurs communications officielles malgré la persistance de certaines accusations réciproques. Ensuite, une diminution notable des hostilités a été observée sur le terrain depuis la signature de l’Accord, malgré quelques affrontements isolés entre le M23 et les milices pro-gouvernementales Wazalendo à Nyamilima et Kisharo (Rutshuru, Nord-Kivu), ainsi qu'une alerte du gouvernement congolais sur un renforcement des lignes de front par l’AFC/M23 en direction d’Uvira (Sud-Kivu), aucune offensive majeure n’ayant toutefois été enregistrée à ce jour, ce qui suggère un début de respect du cessez-le-feu par les parties signataires. Enfin, un regain d’engagement diplomatique renouvelé à travers des contacts bilatéraux entre les gouvernements congolais et rwandais.
Des ajustements nécessaires pour éviter l’essoufflement
Cependant, ces progrès ne doivent pas masquer les faiblesses structurelles qui risquent de ralentir, voire de compromettre, la suite du processus. Le rapport pointe :
D’abord l’absence d’un calendrier complet, détaillé et contraignant pour l’exécution de nombreuses tâches : Si certaines dispositions de l’accord comportent des échéances précises (telle que la mise en œuvre du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces ou la levée des mesures défensives du Rwanda), d’autres tâches pourtant essentielles sont formulées sans mention d’un délai clair de mise en œuvre (telles que le retour des réfugiés ou des personnes déplacées). Ensuite, l’absence d’un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité opérationnel : Bien que des discussions aient été engagées en vue de la mise en place d’un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la RDC et le Rwanda, celui-ci n’est, à ce jour, toujours pas fonctionnel.
Par ailleurs, l’inadéquation entre certaines clauses de l’Accord et la réalité du terrain : Entre l’adoption du CONOPS en octobre 2024 et la signature de l’Accord de Washington en juin 2025, la configuration sécuritaire sur le terrain a profondément changé puisque des zones initialement ciblées pour les opérations de neutralisation des FDLR sont désormais passées sous le contrôle de l’AFC-M23 (soutenu par le Rwanda). Ce renversement de contrôle territorial priverait de facto le gouvernement congolais de la capacité d’exécuter directement une tâche sous sa responsabilité, comme le prévoit pourtant l’Accord.
Enfin, le faible rythme de mise en œuvre des organes de suivi : Le comité de surveillance conjointe n’est pas encore en place ; sa réunion inaugurale est seulement prévue pour le 11 août 2025, soit près de deux mois après la signature de l’accord.
Pour éviter l’enlisement, les signataires doivent corriger le cap dès maintenant. Un suivi renforcé, des engagements coordonnés et une volonté politique constante seront indispensables pour que la dynamique enclenchée ne perde pas de son élan.
Un premier jalon sur un long chemin
La publication de ce rapport d’évaluation préliminaire, en se fondant sur l’OMMAP, ne prétend pas offrir un bilan définitif, mais un outil de navigation dans les eaux complexes de la mise en œuvre de la paix. Un mois après la signature de l’Accord de Washington, le processus est certes encore en gestation, mais les bases sont posées. Il appartient désormais aux parties prenantes (y compris les États signataires, facilitateurs, société civile et partenaires régionaux) de transformer cet élan initial en un processus de paix durable.