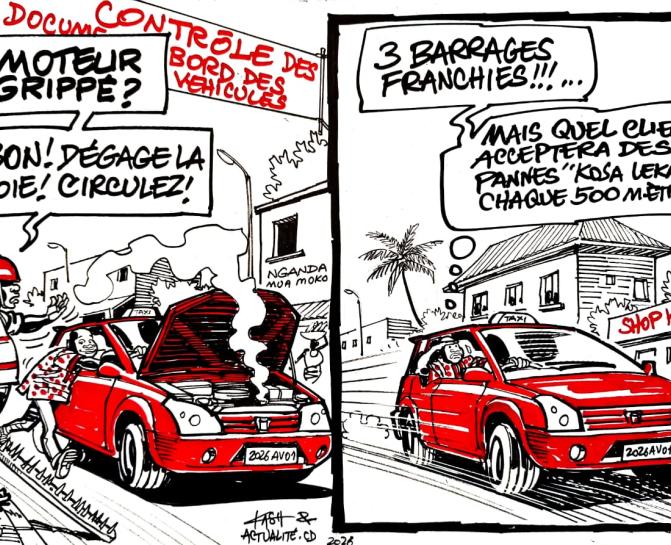Le 25 avril, la République Démocratique du Congo et le Rwanda ont signé à Washington une déclaration de principes, censée poser les bases d’un futur accord de paix durable entre les deux pays, longtemps opposés sur la scène régionale.
Cependant, à Kinshasa, la signature de cette déclaration ne semble pas avoir provoqué l’enthousiasme espéré. Rencontrées ce lundi 28 Avril dans les rues, nombre de Kinoises sont sceptiques quant aux véritables intentions de cette déclaration, se demandant s'il aboutira réellement à une paix durable.
Elisabeth Madimba, étudiante en droit, résume bien ce sentiment général : « Je ne crois pas que cet accord va vraiment changer quoi que ce soit. Les grandes puissances font toujours ce qu’elles veulent, et nous, les Congolais, nous restons là, dans l'attente de solutions qui n’arrivent jamais. On parle de la paix, mais sur le terrain, c’est encore nous qui souffrons le plus. Ce que je vois, c’est que le Rwanda continue de jouer son jeu, et les États-Unis ne vont pas arrêter de soutenir leur allié, le Rwanda, peu importe ce qui se passe ici. Moi, j’espère juste que ça ne va pas empirer la situation. Mais franchement, je n’ai pas beaucoup d’espoir. »
Si Elisabeth doute de l'impact réel de cet accord, d'autres voix s'élèvent également pour exprimer des préoccupations similaires. Amina Mbenza, quant à elle, admet une certaine confusion quant aux intentions de ce processus : « Cet accord, je ne sais pas trop quoi en penser. D’un côté, c’est bien qu’il y ait des discussions pour la paix. Mais d’un autre côté, ces accords sont souvent signés sans que la population ne soit réellement impliquée. Nous, les femmes ici, avons été les premières victimes des conflits dans l’Est du pays. Ce qui compte pour nous, c’est que l’accord mène à des actions concrètes, qu’il y ait un réel désarmement, une vraie protection des civils. Je veux voir des résultats, pas seulement des promesses. »
Dans la même veine, Hélène Mwadi, étudiante en sciences politiques, se montre encore plus ferme : « Je ne sais même pas pourquoi ils signent ces accords entre eux. Les gouvernements étrangers se mêlent toujours de nos affaires. Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que nous, les femmes, nous sommes les premières à porter le poids des guerres. Si cet accord ne change pas la situation des enfants et des femmes dans l’Est, ce sera juste du vent. Je veux des actions, pas des discours. Nous avons besoin de vivre en paix, sans avoir peur d'être attaquées chaque jour. »
Ces propos font écho à ceux de Sylvie Ngoie, une employée dans une ONG, qui s'interroge également sur les motivations profondes de ce processus : « L’accord a l’air d’être une tentative de calmer les tensions entre le Rwanda et la RDC, mais qu’en est-il des préoccupations de la population ? Les femmes, les enfants, et les communautés de l’Est ont besoin de plus que de simples paroles. Ils parlent de diplomatie, mais il faut aussi une vraie aide sur le terrain. Les autorités doivent se concentrer sur des solutions qui protègent réellement la population, et pas seulement sur des accords politiques. »
Une autre voix, celle d’une militante pour les droits des femmes, rappelle l'urgence d'une prise en compte véritable des besoins sur le terrain : « Je trouve que c’est une bonne chose que les États-Unis et le Rwanda parlent de la situation en RDC, mais je ne peux m’empêcher de penser qu’ils sont plus intéressés par leurs propres intérêts géopolitiques que par le bien-être des Congolais. Nous, les femmes, nous vivons dans des conditions extrêmement difficiles et souvent invisibles. J’espère que cet accord ne sera pas qu’une façade. Les femmes doivent être au cœur de la reconstruction du pays, et leurs voix doivent être entendues dans ces négociations. »
La déclaration signée à Washington, par la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, et son homologue rwandais, Olivier Nduhungirehe, en présence du Secrétaire d’État américain Marco Rubio, s’articule autour de six engagements majeurs :
- Reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l’intégrité territoriale,
- Prise en compte des préoccupations sécuritaires,
- Promotion de l’intégration économique régionale,
- Facilitation du retour des personnes déplacées,
- Soutien à la MONUSCO,
- Élaboration d’un accord de paix.
Washington, qui a accueilli cette rencontre, affirme vouloir accompagner ce processus et renforcer ses partenariats avec les deux pays.
Nancy Clémence Tshimueneka