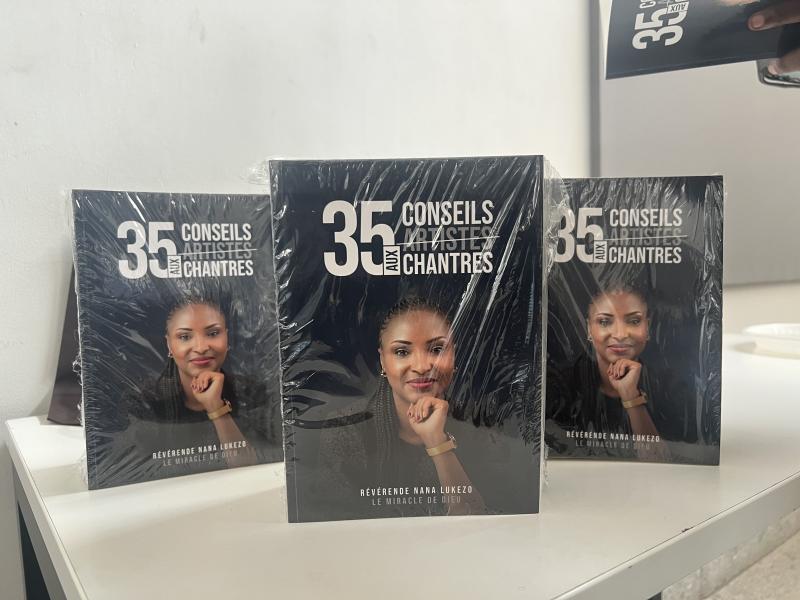L'absence de saisine préalable de l'Assemblée nationale dans une affaire impliquant un élu relance le débat sur l'équilibre des pouvoirs.
Une crise silencieuse mais croissante se profile entre l’Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, exacerbée par l’affaire Bukanga Lonzo, qui ne se limite plus à une simple accusation de corruption, mais devient un test majeur pour l’interprétation de la Constitution et le respect des procédures instituées pour protéger les élus du peuple.
Au centre de ce conflit, l’immunité parlementaire, pierre angulaire du fonctionnement démocratique, est remise en question, mettant en lumière une tension institutionnelle qui pourrait avoir des conséquences profondes sur l’équilibre des pouvoirs en RDC.
Conformément à l’article 107 de la Constitution de la RDC, un député national, comme Matata Ponyo, l’ancien Premier ministre aujourd’hui accusé dans le cadre du dossier Bukanga Lonzo, ne peut être poursuivi ou arrêté qu’avec l’autorisation préalable de l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit. Ce principe fondamental, conçu pour protéger l’indépendance du pouvoir législatif, est cependant mis en péril par l’absence de demande formelle de levée de l’immunité adressée à l’Assemblée par la Cour constitutionnelle, en dépit des poursuites judiciaires en cours. Ce manquement crée un vide juridique, qui met en question le respect des procédures constitutionnelles et alimente une ambiguïté sur le rôle respectif des institutions dans la gestion de ce type de dossier.
L’Assemblée nationale, en tant qu’institution législative souveraine, incarne la voix du peuple et détient des prérogatives constitutionnelles qu’aucune autre institution, y compris la Cour constitutionnelle, ne saurait outrepasser sans compromettre la stabilité du système politique Étatique. La Cour constitutionnelle, bien qu’investie de la mission de garantir l’application des lois, semble, dans cette affaire, empiéter sur un domaine réservé au législatif, celui de la levée de l’immunité parlementaire.
Ce conflit latent pose la question de la portée des prérogatives de chaque institution et de leur capacité à maintenir l’équilibre des pouvoirs dans un système démocratique.
Si cette omission dans la procédure judiciaire n’est pas rapidement rectifiée, elle pourrait installer un dangereux précédent où les principes de séparation des pouvoirs seraient compromis. En effet, une poursuite judiciaire sans la levée préalable de l’immunité parlementaire saperait l’intégrité de l’indépendance du pouvoir législatif et ouvrirait la voie à des pratiques potentiellement autoritaires, menaçant la solidité de l’État de droit. Cette dérive pourrait, à terme, affecter la crédibilité du système politique congolais et porter atteinte à la confiance des citoyens dans la capacité de leurs institutions à agir de manière transparente et respectueuse des textes fondateurs.
Le dossier Matata Ponyo pourrait, par conséquent, devenir un révélateur non seulement de la lutte contre la corruption, mais aussi de la solidité du système institutionnel congolais. Si la Cour constitutionnelle décide de poursuivre sans respecter les procédures formelles prévues par la Constitution, cela enverrait un message alarmant sur la flexibilité des normes constitutionnelles en RDC et sur le risque d’une concentration excessive des pouvoirs entre les mains de l'exécutif et du judiciaire. Une telle évolution remettrait en cause la légitimité de l'Assemblée nationale et l’autonomie des parlementaires, au moment même où le pays aspire à plus de transparence et de responsabilité politique.
Actuellement, la Cour constitutionnelle n’a pas pris de position officielle sur cette situation et n’a pas communiqué sur une éventuelle régularisation de la procédure, renforçant l’incertitude qui plane sur l’affaire. Cette absence de prise de position institutionnelle nourrit une tension croissante entre les deux entités, sans pour autant dégénérer en confrontation directe. Toutefois, les observateurs avertis soulignent que cette ambiguïté met à mal la cohérence du système politique, interrogeant la capacité de la RDC à garantir le respect de sa Constitution et à assurer un équilibre sain entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
L’enjeu de cette affaire dépasse largement le seul cadre de la lutte contre la corruption. En effet, elle cristallise un véritable défi pour l’avenir institutionnel de la RDC, car elle interroge non seulement la gestion des affaires judiciaires mais aussi la capacité des institutions à respecter les principes de séparation des pouvoirs et à maintenir un contrôle législatif effectif sur les actions judiciaires, notamment concernant les parlementaires. Cette affaire pourrait donc être le catalyseur d’un débat profond sur l’adaptation des mécanismes institutionnels et constitutionnels aux défis modernes du pays.
Si les institutions échouent à régler cette crise dans le respect des procédures constitutionnelles, cela pourrait marquer un tournant décisif pour la RDC, ébranlant la stabilité de ses institutions et sapant la confiance du peuple dans son système politique. Le fait qu’aucune des institutions n’ait encore pris position de manière explicite et officielle pourrait bien faire naître un sentiment d’incertitude et de frustration parmi la population, qui attend de ses dirigeants qu’ils respectent et appliquent scrupuleusement la loi.
Ainsi, l’affaire Bukanga Lonzo devient un point de bascule crucial pour l’équilibre institutionnel de la RDC et pour la capacité du pays à garantir la primauté du droit. Si la Cour constitutionnelle persiste dans sa démarche sans la levée préalable de l’immunité parlementaire, elle fragiliserait encore davantage le principe d’indépendance du pouvoir législatif et ouvrirait la voie à une ingérence judiciaire qui pourrait mettre à mal l’équilibre fragile des pouvoirs en place. Il en va désormais de la préservation de la crédibilité de la République et du respect de ses institutions face aux pressions internes et externes. Le respect des normes constitutionnelles et des prérogatives de chaque institution devient alors une condition sine qua non pour assurer la stabilité politique du pays et la confiance des Congolais dans leur système démocratique, mais aussi pour garantir l’avenir de l’État de droit en RDC.
Gerard Musuamba
Membre du Cercle des Juristes Indépendants du Congo (CJIC)