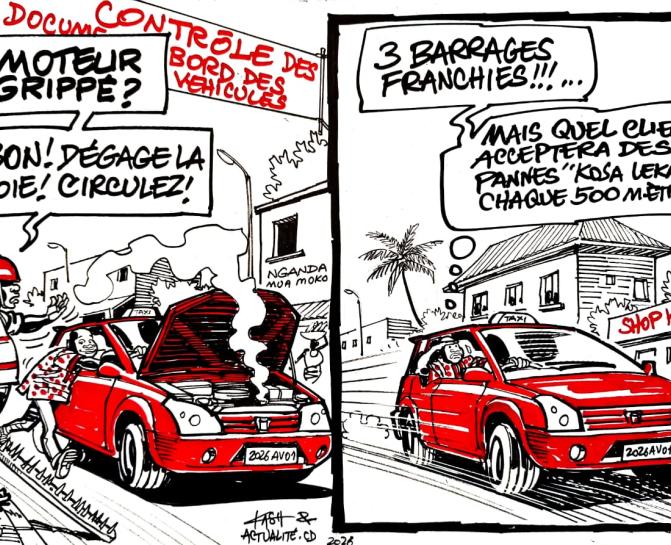En République Démocratique du Congo, la Constitution proclame l’égalité de tous devant la loi. Pourtant, lorsqu’il s’agit d’accès à la terre et à la propriété, les femmes continuent de se heurter à des barrières invisibles mais bien réelles. Entre textes juridiques modernes et pratiques coutumières persistantes, le droit des femmes à posséder une terre reste souvent davantage théorique que concret.
Que disent les textes de loi ?
La Constitution congolaise de 2006, en son article 34, stipule : « La propriété privée est sacrée. L’État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective, acquise conformément à la loi. » Aucune distinction n’est faite entre hommes et femmes.
De plus, la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, foncier et immobilier, telle que modifiée en 1980, précise que toute personne physique ou morale peut acquérir et transmettre une terre. Juridiquement, rien n’empêche donc une Congolaise d’acheter une parcelle, d’hériter d’un domaine ou de céder une concession.
Le Code de la famille révisé en 2016 est venu renforcer cette égalité, notamment en matière successorale. Désormais, filles et garçons héritent à parts égales, et la femme mariée n’est plus juridiquement considérée comme mineure sous tutelle de son mari pour les actes de gestion patrimoniale.
En théorie, tout semble réglé. Mais la pratique raconte une autre histoire.
La coutume, un frein majeur
Selon Maître Stéphany Bofae, dans la plupart des provinces, les règles coutumières continuent de primer sur les textes légaux. « Selon la tradition, les terres appartiennent au lignage masculin. Une femme, même héritière légitime, est souvent invitée à laisser la terre aux garçons pour préserver l’unité familiale. Dans certaines chefferies, une femme célibataire qui veut acquérir une parcelle doit obtenir l’aval du chef coutumier, ce qui reste exceptionnel », explique-t-elle.
Et de poursuivre :
« Quant aux femmes mariées, elles se voient encore imposer la présentation d’une autorisation de leur mari pour finaliser une transaction, alors que cette exigence n’existe plus dans la loi ».
Ces pratiques coutumières créent un paradoxe : le droit moderne proclame l’égalité, mais le poids des traditions prive les femmes de leurs droits concrets.
L’héritage, terrain de conflits
La succession constitue un champ de bataille récurrent. Bien que le Code de la famille reconnaisse l’égalité successorale, de nombreuses veuves ou filles héritières sont écartées des biens fonciers. Dans certains cas, les terres d’une veuve sont confisquées par la belle-famille, parfois avec la complicité de fonctionnaires locaux.
« Lorsqu’une femme revendique ses droits successoraux, elle est accusée de rompre la coutume ou de menacer la paix familiale. Beaucoup finissent par abandonner par peur d’être rejetées », souligne l’avocate.
Des obstacles administratifs et financiers
Au-delà de la coutume, l’administration foncière elle-même est un labyrinthe, souligne Maître Bofae. Procédures complexes, lenteurs bureaucratiques, frais de dossiers prohibitifs, risques de double immatriculation… ces obstacles dissuadent de nombreuses femmes, surtout celles vivant en milieu rural et disposant de peu de moyens.
Les discriminations indirectes apparaissent ici : même si la loi ne fait pas de distinction entre homme et femme, les contraintes administratives touchent davantage les femmes, souvent moins informées et moins solvables que les hommes.
Quels recours pour les femmes ?
Plusieurs mécanismes existent en théorie pour protéger les droits fonciers des femmes :
- saisir les tribunaux pour contester une spoliation ;
- solliciter l’appui des ONG et associations de femmes juristes ;
- alerter les inspections foncières en cas d’abus.
Mais ces recours, selon l’avocate, nécessitent du temps, de l’argent et une bonne connaissance des textes, trois conditions rarement réunies dans les zones rurales.
Vers un véritable changement ?
Pour Me Stephany Bofae, l’égalité foncière des femmes en RDC ne pourra devenir une réalité qu’à travers une double stratégie : la vulgarisation massive des textes juridiques et une réforme des pratiques coutumières.
« Posséder une terre ne relève pas seulement de l’économie, c’est une question de dignité, de sécurité et d’autonomie pour la femme congolaise », conclut-t-elle.
Tant que persistera ce fossé entre la loi et la pratique, l’accès des femmes à la terre restera un droit proclamé, mais non pleinement exercé.
Nancy Clémence Tshimueneka