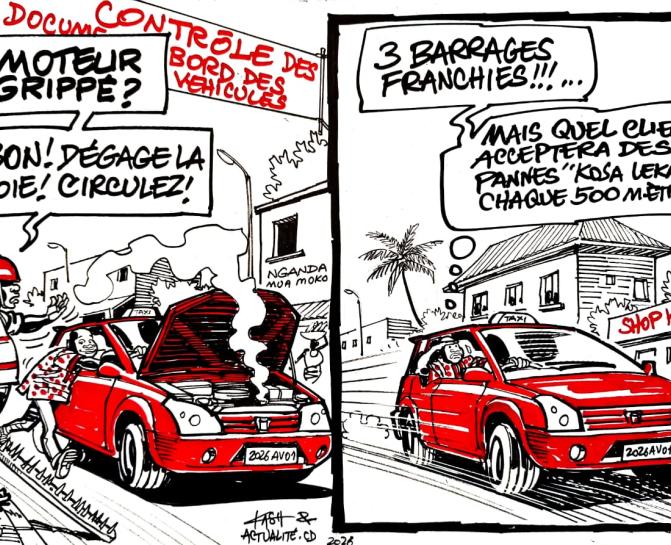En République Démocratique du Congo, certaines pratiques traditionnelles et pressions sociales continuent d’influencer les décisions liées au mariage, notamment chez les jeunes filles. Des cas de mariages impliquant des mineures ou contractés sans consentement libre sont encore signalés dans plusieurs régions du pays, suscitant des inquiétudes quant au respect des droits fondamentaux des filles et des jeunes femmes.
Face à cette situation, plusieurs questions se posent : que prévoit la législation congolaise en matière de mariage ? Quel est l’âge légal requis ? Quelles sont les conditions de validité d’un mariage ? Et surtout, quels recours existent pour les personnes mariées précocement ou contre leur gré ?
Que dit la loi congolaise ?
Contactée à ce sujet, Me Sylvie Mawana, avocate, précise :
« En République Démocratique du Congo, l’article 352 du Code de la famille, modifié par la Loi n°16/008 du 15 juillet 2016, fixe l’âge légal du mariage à 18 ans révolus pour les deux sexes. Il s’agit d’une mesure conforme aux conventions internationales ratifiées par la RDC, telles que la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant », déclare-t-elle, en soulignant que le consentement libre et éclairé des futurs époux est une condition essentielle de validité du mariage, selon l’article 353 du même Code.
« Toute union célébrée sans ce consentement, ou sous contrainte, est juridiquement contestable. De plus, l’article 363 impose que le mariage soit célébré devant l’officier de l’état civil. À défaut, il ne produit aucun effet légal, même s’il est reconnu coutumièrement ou religieusement. »
Mariage précoce ou forcé : quelles infractions ?
Selon l’avocate, lorsqu’un des époux est âgé de moins de 18 ans ou si le mariage a été contracté sous la contrainte, la loi congolaise considère qu’il s’agit d’une violation grave :
« Le mariage d’une mineure constitue une infraction qui peut être poursuivie, notamment lorsqu’il s’accompagne de rapports sexuels assimilables à une atteinte aux mœurs ou à une exploitation sexuelle, au sens du Code pénal congolais (articles 170 à 178). Le mariage forcé, quant à lui, est puni par l’article 175 bis du Code pénal, introduit par la Loi n°06/018 du 20 juillet 2006. Il expose les auteurs (parents, tuteurs ou toute personne impliquée) à des peines d’emprisonnement et à des amendes. »
Quels recours pour les victimes ?
D’après Me Sylvie Mawana, les victimes de mariage précoce ou forcé peuvent agir à plusieurs niveaux, même si ces mécanismes restent souvent peu accessibles en raison de l’ignorance de la loi, de la pression sociale ou de la peur de représailles :
1. Saisie du tribunal pour annulation du mariage : Conformément aux articles 398 à 402 du Code de la famille, une victime (ou un tiers agissant dans son intérêt, comme un avocat ou une ONG) peut saisir le tribunal de grande instance pour faire annuler un mariage célébré en violation des conditions légales, notamment en cas de minorité ou de vice de consentement.
2. Plainte au parquet ou auprès de la police : Lorsqu’il y a des preuves de violence, de coercition ou d’exploitation sexuelle, la victime peut porter plainte auprès du parquet. La police judiciaire, notamment via la brigade de protection des mineurs, peut intervenir, y compris en cas de mariage coutumier illégal impliquant une mineure.
3. Accompagnement par des structures spécialisées : Plusieurs organisations de défense des droits des femmes ou ONG juridiques proposent une assistance gratuite : conseils, accompagnement judiciaire, médiation, et parfois hébergement d’urgence.
4. Protection des mineures par les services sociaux : Les services nationaux de protection de l’enfant peuvent également intervenir pour retirer une mineure d’un foyer où elle est soumise à une union illégale et organiser sa prise en charge.
Des obstacles persistants
Même si les textes sont clairs, leur application reste difficile dans de nombreuses zones. Plusieurs facteurs entravent l’accès à la justice pour les victimes, notamment la méconnaissance de la loi, la pression communautaire ou encore l’absence de structures judiciaires accessibles, selon Me Mawana.
« L’État doit renforcer les mécanismes de prévention, de signalement et de prise en charge des cas. Tant que les communautés n’auront pas compris que le mariage d’une enfant est une forme de violence, la loi seule ne suffira pas. Il faut éduquer, sensibiliser, et surtout écouter les filles elles-mêmes. Un mariage sans consentement est une forme de violence. Il faut renforcer l’accès à la justice pour les filles, former les chefs coutumiers et les officiers d’état civil, et surtout éduquer les familles. Protéger les filles, c’est protéger l’avenir du pays. »
Nancy Clémence Tshimueneka