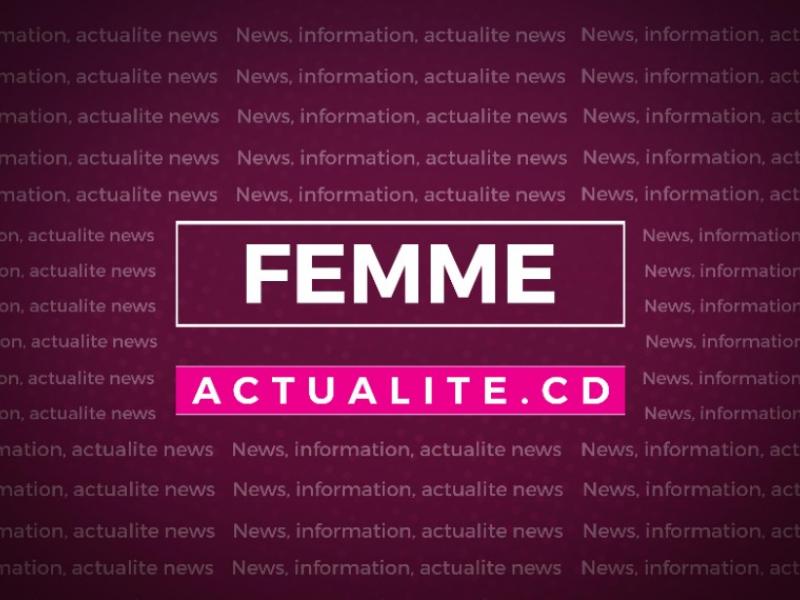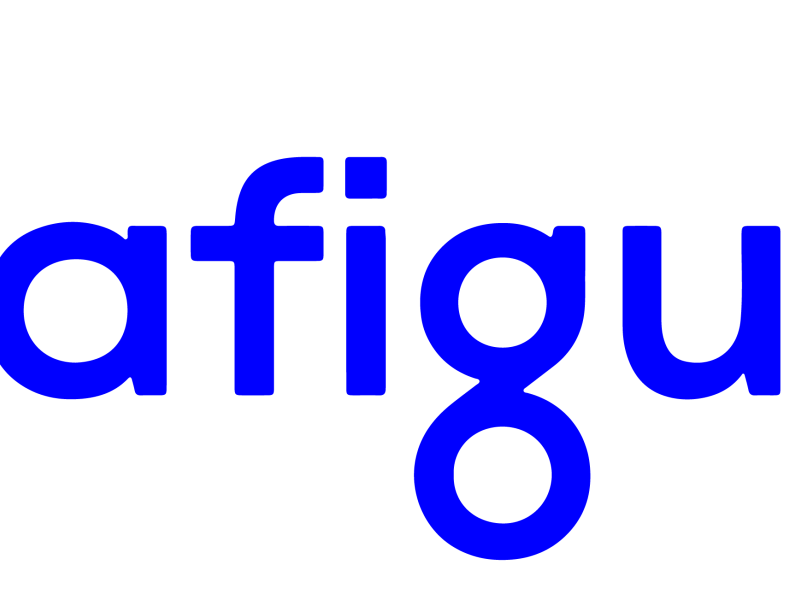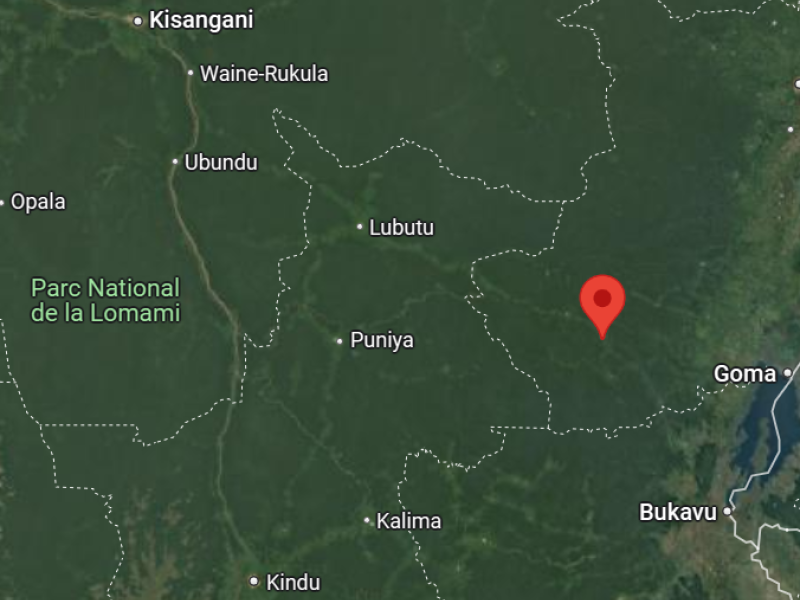S’unir tous pour mettre fin aux violences à l’égard de toutes les filles, tel est notamment l’objectif de la campagne des 16 jours d’activisme contre les VBG en 2022. Immersion dans le quotidien de Fatou, Sarah, Justine, Jolie, Tabitha et Dorcas, des adolescentes vivant dans les rues de Kinshasa. Comment vivent-elles les violences basées sur le genre ?
« Vous avez dit violences quoi ? basées sur le genre ? VBG ? Non, je ne connais rien de ces termes. Peut-être le "viol", parce que c'est un phénomène très courant ici », réagit Fatou Bahati, pantacourt et tee-shirt noirs délavés et une peau poussiéreuse, vers le cimetière de la Gombe.
Agée de 15 ans, Fatou passe généralement ses journées en compagnie d'un groupe d’enfants de la rue aux abords de l'école Révérend Kim à Lingwala. « Les autres filles n’ont pas pu vivre avec nous. Fatou seule a résisté », ont-ils avoué au Desk Femme.
Les alentours des toilettes publiques installées sur la place des évolués à Gombe hébergent aussi une vingtaine des shégués. Là se trouvent aussi Jolie Umba et des jumelles Tabitha Nsimba et Dorcas Nzuzi. Si la première a quitté la maison, « par simple influence des amies », les deux autres « ont trouvé dans l’influence des amies, une bonne raison pour se libérer du comportement odieux de leur parâtre depuis deux années et demie », disent-elles, originaires de la Commune de Kinshasa.
Cigarettes, chanvre et whisky sont des éléments qui accompagnent leur quotidien de rue. A propos d’une sensibilisation sur les VBG, elles répondent à l'unisson, « Personne ne nous a parlé des violences depuis que nous sommes ici. Même lorsque nous marchons dans les rues pour choquer (quémander auprès des passants) ».
Longeant le boulevard du 30 juin, Sarah (12 ans) et Justine (8ans), sont issues d’une famille de 4 enfants qui vivent tous dans la rue depuis 2019, « à se débrouiller pour apporter des revenus à leur mère, habitante du Camp Lufungula ».
User de la force pour survivre
Sur les bras, les cuisses, les cous, les dos et le visages, d’énormes cicatrices sont perceptibles. Certaines portent en même temps des plaies profondes et visiblement infectes. Les causes sont les mêmes ; une violence sexuelle ratée, une situation de viol ou une résistance face aux ordres « des plus ainés ».
«C'est très dur de vivre dans la rue. Quand la nuit tombe, il n’y aucune sécurité pour nous. Ces vieux que vous voyez-en face- nous prennent par la force, nous obligent à contracter des relations sexuelles (...) C’est déjà un viol n’est-ce pas ? », s’interroge d’une voix triste, Jolie Umba, 16 ans, appuyée par les jumelles « Personne n'intervient. Si vous ne réussissez pas seule à vous libérer, ils vont atteindre leur but ».
« Je devais avoir 13 ans lorsque j’ai rencontré un vieux (comme Yaya, termes qui désignent des hommes shégués expérimentés). Il m’a obligée à coucher avec lui. Je n’ai pas voulu. Il a insisté et n’arrêtait pas de me brutaliser. Il a pris un morceau de fer et m’a enfoncé dans l’avant-bras. Je me suis battue jusqu’à me libérer. Dans un hôpital à Barumbu, les personnels de santé ont fait une suture de 40 épingles pour deux blessures. Ils avaient demandé 30.000 FC comme frais des soins. J’ai payé en partie », se rappelle Fatou Bahati, dans la rue depuis ses 3 ans.
Sarah paraît fébrile. Sur son avant-bras droit, une plaie profonde et visiblement infectée. « Il était 21 heures passées la semaine dernière. On avait seulement gagné 1500 FC. Nous avons rencontré des Yayas vers Rond-point Mandela qui nous ont demandé de l’argent. On leur a dit qu’on n’avait rien, ils ont attrapé Sarah et l’ont coupé à l’aide d’une lame de rasoir. Maman y a juste mis de l’huile de palme », raconte Justine, complétée par sa sœur.
Ne jamais oser obtenir justice
Pour toutes ces filles, bien qu’elles connaissent les auteurs des violences qu’elles ont subies, aucune n’a osé porter l’affaire auprès des instances de justice. Elles n’envisagent pas de le faire.
« Si seulement ils apprennent que tu t’es rendue auprès de la police, c’est ta mort que tu as signée. Ils nous font publiquement des menaces et promettent de nous faire disparaître », dit Tabitha Nsimba.
« Non, je ne vais pas le faire. La justice c’est l’argent. Comment vais-je faire pour payer tous les frais qui seront demandés ? », s’interroge Fatou Bahati.
Par ailleurs, lorsque ces jeunes filles ont leurs menstrues, elles utilisent des papiers mouchoirs ou des morceaux de tissus. Elles n’ont aucune notion d’hygiène menstruelle et se battent quotidiennement contre des infections sexuelles. Elles ont toutes interrompu les études quand elles ont commencé à vivre dans la rue et espèrent toutes reprendre le chemin de l’école et devenir pour les unes, des hautes personnalités congolaises, politiciennes et femmes d’affaires pour les autres.
Il faut également souligner qu’en dehors de la campagne des 16 jours contre les VBG, la RDC mène depuis le 19 juin 2021 une autre campagne au niveau national dénommée « Tolérance zéro contre les crimes des violences sexuelles et basées sur le genre et l’impunité ».
Prisca Lokale