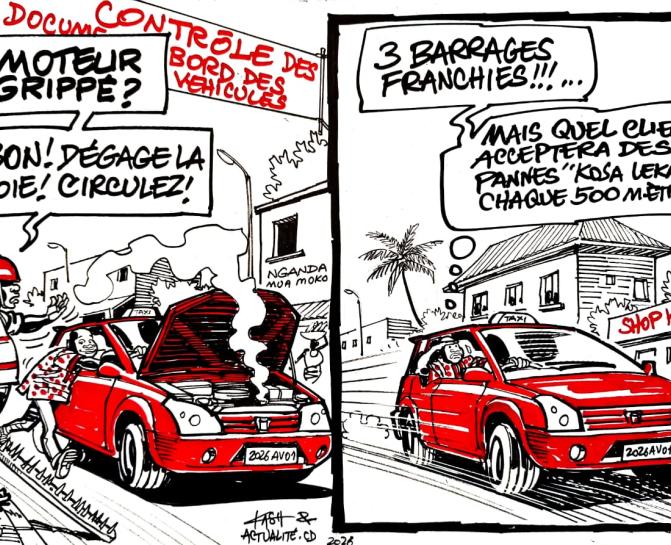En République démocratique du Congo, la question de l’héritage soulève d’importants enjeux juridiques et sociaux, particulièrement en ce qui concerne les droits des femmes et des filles.
(Re) Lire : En matière d'héritage, les filles et les garçons sont loin d'être logés à la même enseigne (baladeur)
Absence de testament, poids des traditions, manque de sensibilisation : pourquoi les femmes congolaises sont-elles encore si souvent lésées ?
Sur le plan juridique, la législation congolaise, à travers le Code de la famille tel que modifié en 2016, garantit aux filles le droit à une part égale dans la succession de leurs parents, au même titre que leurs frères. En son article 758, le Code précise que : « Les enfants succèdent à parts égales, sans distinction de sexe ni de statut. »
Ce principe d’égalité est également renforcé par la Constitution congolaise de 2006, en son article 14, qui impose à l’État de « veiller à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme » et de « garantir la protection de ses droits dans tous les domaines, notamment ceux de l’accès à l’héritage ».
Toutefois, malgré ce socle juridique, les pratiques coutumières continuent de prévaloir dans de nombreuses régions, au détriment des filles, qui se retrouvent souvent exclues de l’héritage, en particulier en ce qui concerne les biens fonciers ou les terres, explique Sylvain Mwela, avocat à Kinshasa
« Dans de nombreuses communautés congolaises, notamment dans les milieux ruraux, la coutume considère que seules les lignées masculines ont vocation à hériter des terres et des maisons familiales, les filles étant réputées quitter leur famille d’origine pour rejoindre celle de leur mari. Dans certaines familles, une fille qui revendique ses droits héréditaires est perçue comme une source de conflit, voire comme irrespectueuse des traditions. Ainsi, l’héritage est fréquemment transmis de père en fils, marginalisant de fait les filles, malgré les garanties prévues par le droit écrit ».
L’absence de testament : une vulnérabilité supplémentaire
L’un des facteurs aggravants dans les situations conflictuelles est l’absence de testament. Peu de Congolais établissent un testament avant leur décès, que ce soit par manque d’information, méfiance envers la formalisation ou simplement négligence. Or, poursuit Sylvain Mwela, sans testament clair, les successions sont souvent ouvertes à interprétation, laissant le champ libre à des pratiques discriminatoires, surtout dans les familles divisées.
« Lorsqu’aucun document n’encadre la volonté du défunt, la famille élargie intervient souvent pour gérer la succession, ce qui finit par léser les ayants droit légitimes, notamment les filles ou la veuve », déplore-t-il.
Une justice difficilement accessible aux femmes
Selon un baladeur réalisé avec quelques filles aînées vivant à Kinshasa, l’accès à la justice reste un défi pour de nombreuses femmes qui souhaitent faire valoir leurs droits successoraux. Outre les coûts et les lenteurs de la procédure judiciaire, la peur de stigmatisation ou de représailles sociales dissuade plusieurs d’entre elles d’engager des démarches. De plus, les juridictions elles-mêmes peuvent se montrer réticentes à appliquer strictement le droit écrit lorsque les faits relèvent de contextes coutumiers.
« Il arrive que des juges, influencés par la culture locale ou pour éviter un conflit communautaire, valident des arrangements qui vont à l’encontre du Code de la famille », confie un magistrat sous anonymat.
Quelques avancées timides mais significatives
Depuis la réforme du Code de la famille, plusieurs organisations de la société civile et associations féminines multiplient les actions de sensibilisation. Des campagnes éducatives tentent de faire connaître aux femmes leurs droits successoraux, notamment dans les zones rurales. En parallèle, certains tribunaux commencent à prendre des décisions en faveur de l’égalité, rappelant le caractère contraignant du droit écrit sur les pratiques coutumières.
Mais ces efforts restent limités sans une volonté politique forte et une action coordonnée à l’échelle nationale.
Que faire pour changer la donne ?
Pour combler l’écart entre les textes de loi et la réalité du terrain, Me Sylvain Mwela plaide pour une réforme systémique fondée sur l’harmonisation législative et une large vulgarisation des droits successoraux, en particulier auprès des femmes et des autorités coutumières.
Il recommande notamment de :
- Traduire et vulgariser le Code de la famille dans toutes les langues nationales, en ciblant particulièrement les milieux ruraux ;
- Encourager la rédaction de testaments, avec des modèles simplifiés et accessibles ;
- Former les chefs coutumiers et les agents de l’état civil aux droits des femmes ;
- Offrir une assistance juridique gratuite aux femmes victimes de spoliation successorale ;
- Sanctionner fermement les actes discriminatoires dans les partages d’héritage
Selon l’avocat, garantir aux femmes congolaises l’accès à l’héritage n’est pas qu’une question de conformité juridique : c’est un impératif de justice sociale, de sécurité économique et de respect de la dignité humaine.
« Le droit congolais est clair. Ce sont les mentalités et les pratiques qu’il faut désormais faire évoluer. Le respect du droit à l’héritage pour les femmes est une obligation, pas une faveur. Il ne s’agit pas d’opposer la coutume au droit, mais de faire évoluer la tradition dans le respect des principes fondamentaux inscrits dans notre législation », conclut Maître Sylvain Mwela.
Nancy Clémence Tshimueneka