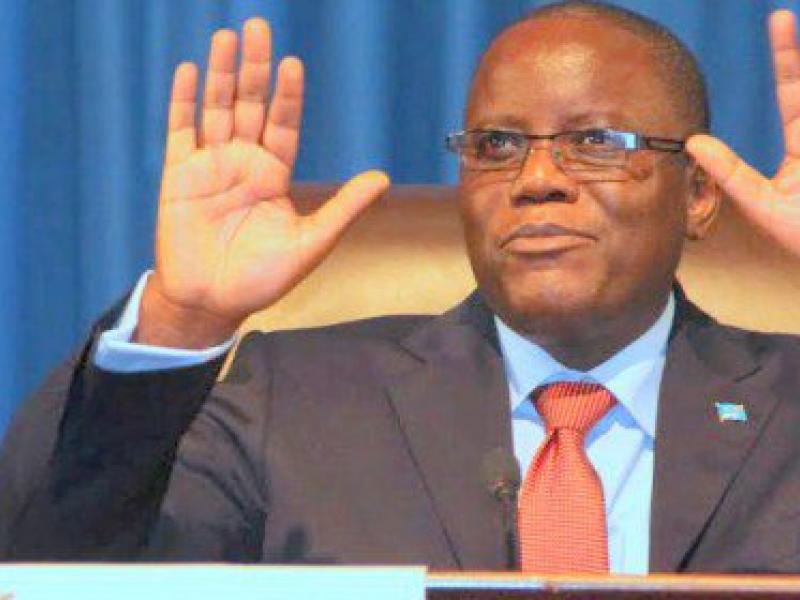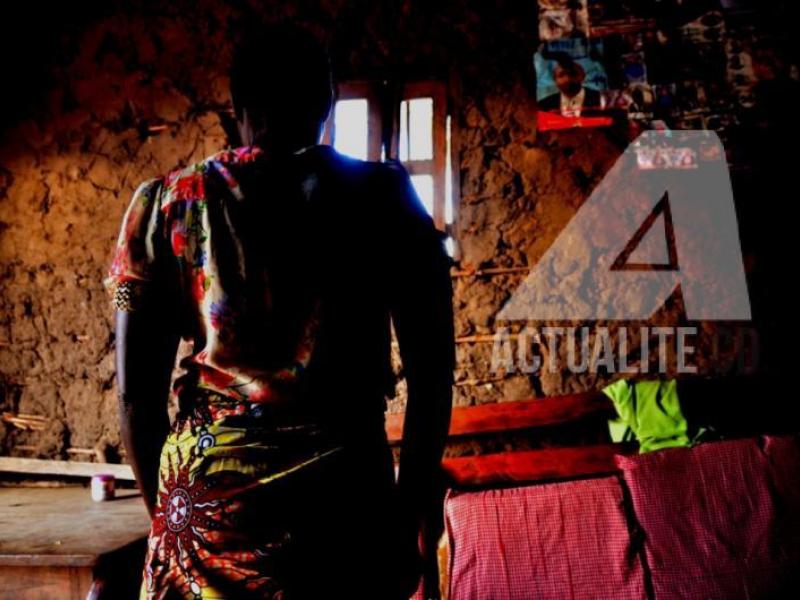La République démocratique du Congo affiche sur le papier des engagements en faveur de la santé sexuelle et reproductive des adolescentes. Pourtant, entre textes de loi et réalité quotidienne, un fossé persiste. A cet effet, le DeskFemme s'est entretenu avec Me Armand Munzeke, avocat spécialisé en droit de la santé pour comprendre ce paradoxe.
Selon l'avocat, sur le plan juridique, la contraception n’est pas interdite. Les adolescentes ont théoriquement accès à la planification familiale. « Le droit existe, mais l’absence de structures adaptées et la stigmatisation sociale empêchent beaucoup de jeunes filles d’en bénéficier », souligne-t-il. Même constat pour la protection contre les mariages précoces : le code de la famille fixe l’âge légal du mariage à 18 ans, mais les unions d’enfants demeurent fréquentes, faute de contrôle et à cause des pratiques coutumières.
L’éducation complète à la sexualité, clé pour prévenir les infections sexuellement transmissibles (IST) et renforcer la notion de consentement n’est ni obligatoire ni uniformément dispensée, poursuit-il. « Cette lacune entretient l’ignorance et fragilise les adolescentes face aux violences sexuelles », avertit l’avocat.
Le domaine de l’avortement révèle les contradictions les plus marquées. Les articles 165 et 166 du Code pénal prévoient des peines de prison pour toute interruption volontaire de grossesse. Pourtant, la RDC a ratifié en 2018 le Protocole de Maputo, qui autorise l’avortement médicalisé en cas de viol, d’inceste, de danger pour la santé de la femme ou de malformation grave du fœtus. « Le Protocole a force de loi, mais l’absence d’harmonisation avec le Code pénal expose les médecins et les jeunes filles à des poursuites même lorsque les conditions de ce texte sont réunies », explique Me Munzeke.
Au-delà de la loi, d’autres barrières limitent l’accès aux soins : méconnaissance des droits, poids des normes sociales, rareté des services de santé confidentiels, coûts et distance des structures. Ces freins découragent les adolescentes de rechercher contraception, dépistage des IST ou interruption de grossesse lorsque c’est légal.
Pour combler l’écart entre droits et réalité, l'avocat recommande une réforme du code pénal afin d’intégrer pleinement le protocole de Maputo, une formation systématique des magistrats et des professionnels de santé, la création de cliniques amies des jeunes et une vaste campagne d’information. Il insiste aussi sur la nécessité d’impliquer les leaders traditionnels et religieux afin de réduire la stigmatisation.
Ainsi, les droits des adolescentes congolaises à une santé sexuelle et reproductive complète sont officiellement reconnus, mais restent fragiles dans la pratique. Comme le conclut l’avocat : « Sans volonté politique, ressources suffisantes et changement culturel, ces droits resteront théoriques. »
Nancy Clémence Tshimueneka