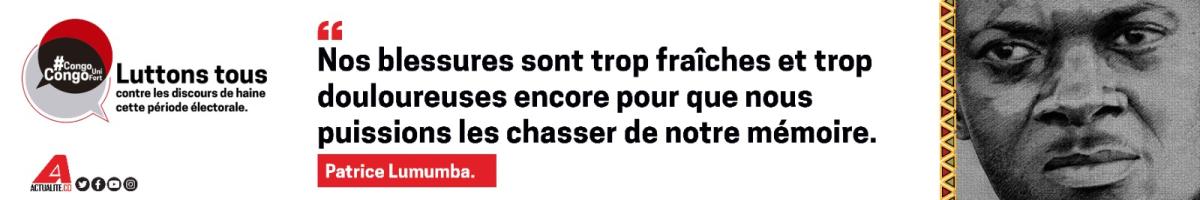« Comment peut-on espérer devenir un pays de grande littérature sans des bibliothèques publiques où le citoyen lambda s’en va à la rencontre de ce qui s’écrit de par le monde ? », Blaise Ndala (Entretien)

- Samedi 26 novembre 2022 - 00:11
L’écrivain canadien d’origine congolaise, Blaise Ndala, est intervenu sur ACTUALITE.CD à l’occasion de la journée internationale de l’écrivain africain. Célébrée le 7 novembre, elle est suivie de la journée mondiale des écrivains en prison, le 15 novembre ; une aubaine pour donner son regard sur la situation littéraire congolaise. 50 ans, né en RDC, Blaise s’est installé à Ottawa, au Canada, il y a plus de dix 10 ans.
Il publie son premier roman en 2014, intitulé « J’irai danser sur la tombe de Senghor » et a remporté le Prix du livre d’Ottawa en 2015. En 2017, il a sorti « Sans capote ni Kalachnikov » et en 2021 « Dans le ventre du Congo », avec lequel il remporte le Prix Ivoire, en 2021. Blaise Ndala est également par deux fois Prix Ahmadou-Kourouma (2021 et 2022).
ACTUALITE.CD : Que vous inspire la journée internationale de l’écrivain africain ?
Blaise Ndala : Pour moi, c’est une journée qui est importante à double titre. D’un point de vue positif, celui de la célébration, c’est un prétexte que nous offre le calendrier civil pour rendre hommage aux femmes et aux hommes de lettres du continent et de ses diasporas. Je pense tout particulièrement aux pionnières et pionniers qui ont dû tailler dans le rocher le chemin dans lequel nous marchons, à une époque où la littérature des peuples du continent, lorsqu’elle était reconnue comme telle, était réputée se cantonner à l’oralité.
Il a fallu investir d’autres formes sans répudier celles que nos sociétés anciennes avaient pratiquées depuis la nuit des temps. En nous emparant des langues et des codes de ceux au contact de qui nos mondes s’étaient transformés, il a fallu faire la démonstration, si besoin était, pour nous-mêmes davantage que pour ceux qui avaient beau jeu d’en douter, que les lettres africaines pouvaient dire la condition humaine autant que celles des sociétés à plus vieille tradition littéraire au sens où on l’entend aujourd’hui. Cela peut sembler anecdotique et prêter à sourire, mais il a bien fallu faire ce voyage à travers le temps.
Et puis, d’un point de vue réflexif, cette journée est l’occasion de mettre le doigt sur toute une série de défis auxquels sont confrontés les écrivaines et écrivains sur le continent, du Maghreb à l’Afrique australe en passant par l’Afrique centrale. Celle de se faire publier ; de faire circuler leurs livres d’un endroit à l’autre et même, dans bien de cas, à l’intérieur d’un même pays ; celle de disposer d’un lectorat qui porte leurs textes et se les approprie ; celle de trouver leur place dans le concert littéraire mondial, aussi bien par la présence des œuvres éditées en Afrique que par la participation directe des écrivains du continent aux événements littéraires organisés sous d’autres cieux. De ces défis et de bien d’autres encore, comme acteurs de la chaîne du livre et comme États, nous ne pourrons faire l’économie des solutions plus longtemps.
Quel est selon vous, le sujet qui devait faire réfléchir les écrivains africains en ce jour ?
Ma réponse précédente en livre un certain nombre, que d’autres ont dû soulever avant moi. J’y ajouterais l’absence de politique du livre dans la plupart des pays africains, à l’image de celui dont je suis moi-même originaire. Une telle carence se répercute forcément dans le difficile accès au livre en général et aux textes littéraires en particulier, notamment chez les plus jeunes.
Or comment peut-on espérer devenir un pays de grande littérature sans une jeunesse qui est exposée tôt aux genres littéraires qui font le prestige de pays que nous envions ? Sans des bibliothèques publiques où le citoyen lambda s’en va à la rencontre de ce qui s’écrit de par le monde ?
Pareillement, comment peut-on rêver de nouveaux Mudimbe et Labou Tansi, ces deux géants des lettres africaines qui ont fait leurs premières armes au Congo-Kinshasa, sans que le pays soit doté d’une seule maison d’édition qui réponde aux standards internationaux ? Sur ce dernier chapitre, je vois des choses bouger timidement, des initiatives que j’encourage et observe avec le plus grand intérêt, pour ne rien vous cacher.
Quel est votre regard, depuis l’étranger, sur la littérature congolaise actuellement ?
J’ai beau avoir épinglé tantôt les multiples défis qui se dressent sur le chemin de la littérature congolaise, je ne suis pas moins conscient d’une chose : à l’image du pays et de celle de tous nos États sur le continent, c’est une littérature jeune. Je crois donc que ses plus belles lettres sont devant elles, parce que l’extraordinaire richesse culturelle dont recèle le Congo et que l’on voit illuminer d’autres formes d’expression artistique comme la musique ou les arts visuels, constitue en soi une promesse.
Toutefois, ce grand potentiel a besoin d’une réelle impulsion, principalement de la part de l’État congolais, pour que le féru de littérature qui est en Amérique du Nord – j’aurais pu citer l’Europe ou l’Asie -, en entendant parler de la littérature congolaise, soit capable de citer plusieurs noms. Qu’il n’ait pas seulement lu un écrivain congolais publié à Paris ou à Montréal, mais idéalement, qu’il ait eu la chance de lire une poétesse publiée à Lubumbashi, un essayiste publié à Matadi ou un romancier publié à Kikwit. Le moins que je puisse dire, c’est que nous n’en sommes pas là. Cela dit, il existe au Congo et dans ses diasporas de très belles plumes, certaines plus connues que d’autres. Assez pour un pays de plus de 80 0000 habitants ? Hélas, non.
Quel rôle l’écrivain, la littérature peut jouer dans un contexte assez particulier comme celui de la RDC, marqué par des tragédies notamment à l’Est ?
Chaque société, à travers ses écrivains, produit une littérature qui ne saurait être un tout homogène. Je ne vais donc pas vous dire qu’en raison des tragédies qui ont cours à l’Est du Congo, il faille que l’écrivain congolais joue tel ou tel autre rôle. Ce n’est pas tout à fait ma vision de la littérature, espace de liberté par excellence. Pour lever tout malentendu, je ne dis pas que comme écrivain, il faille rester indifférent aux drames que connaît temporairement son pays.
Ce que je veux dire, c’est que l’écrivain, tout en puisant dans le substrat de la société où il vit, créé selon sa sensibilité la plus intime, qui pourrait ne pas être dictée par une tragédie, quand bien même celle-ci l’affecterait directement. Cela me fait d’ailleurs penser à la fausse querelle qui opposa autrefois deux de nos illustres aînés, le Camerounais Mongo Beti et le Guinéen Camara Laye. Les deux avaient commis leurs premiers écrits pendant la période coloniale marquée, comme on le sait, par la domination européenne et sa cohorte de tragédies.
Le premier reprocha alors au second de « se complaire dans une image stéréotypée de l’Afrique et des Africains » dans ses écrits, plutôt que de dénoncer les souffrances des Noirs sous le joug colonial. C’était, disais-je, une fausse querelle, car la puissance pamphlétaire du Pauvre Christ de Bomba publié par Mongo Beti en 1956 était et demeure de nos jours encore tout aussi pertinente que le pittoresque de L’Enfant noir commis par Camara Laye trois ans plus tôt.
Tout ça pour dire que l’écrivain congolais n’a de rôle que celui qu’il choisit librement, en âme et conscience. Quant à la littérature, elle sera toujours le champ de tous les possibles. Il est donc naturel que celle produite au Congo puise dans la tragédie de l’est du pays, mais il serait triste pour les lettres congolaises si elles venaient à se limiter à ce seul horizon.
Comment peut-on, avec la plume, changer les choses, faire évoluer des situations ?
D’emblée, je vous dirais qu’il faudrait réunir, comme écrivain, à tout le moins deux conditions : d’abord, avoir gagné en notoriété de façon très significative, pour que votre plume, justement, sorte de l’ombre et soit considérée par une masse critique de vos contemporains, comme une parole qui incite à l’action. Certains lauréats du Nobel de littérature nous en donnent des illustrations, à l’image du Nigérian Wole Soyinka ou de l’Américaine Toni Morrison, pour ne citer qu’eux.
Ensuite, rester très lucide et savoir qu’il est extrêmement rare que les écrits seuls produisent un changement visible du vivant de leur auteur, peu importe les sujets abordés. Je dois signaler qu’Émile Zola dont les textes engagés débouchent en un temps relativement court sur la remise en liberté, puis la réhabilitation du capitaine Alfred Dreyfus, constitue une exception suffisamment retentissante pour ne pas prêter à généralisation. Je reviens à Soyinka, puisqu’il l’a avoué lui-même lorsqu’il fut interrogé sur la raison qui l’avait incité à se lancer en politique dans un Nigéria phagocyté par une junte militaire : la plume, même celle d’un Prix Nobel de littérature, atteint très vite ses limites.
Ce que je crois, c’est que les œuvres littéraires changent avant tout notre perception du monde et celle de notre pouvoir comme acteur social doué de raison et du libre arbitre. À ce titre, elles peuvent nous amener à nous changer nous-mêmes. Il me semble que pour changer le monde, ce n’est pas si mal comme prémisse.
Propos recueillis par Emmanuel Kuzamba