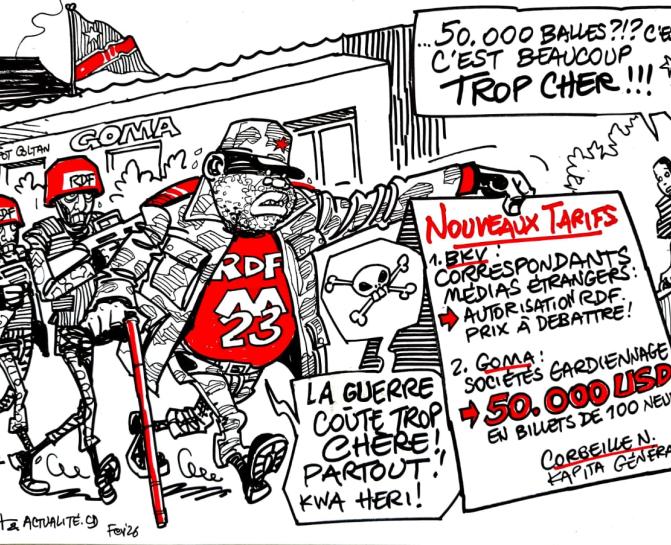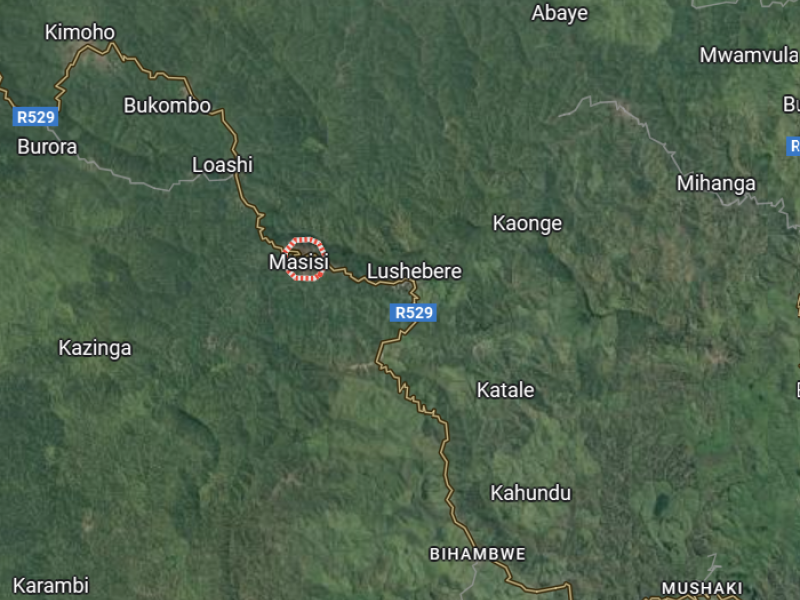Dans le quartier Pakadjuma, situé dans la commune de Limete à Kinshasa, de nombreuses femmes et jeunes filles vivent dans une extrême précarité. Livrées à elles-mêmes, sans encadrement ni repères, elles sont confrontées à une pauvreté persistante. Beaucoup abandonnent l’école très tôt, et certaines se retrouvent contraintes de se prostituer pour subvenir à leurs besoins.
La situation est aggravée par l’absence d’installations sanitaires adéquates, communément appelées « coup direct », ainsi que par l’insécurité grandissante liée au banditisme qui sévit dans ce quartier.
Les grossesses précoces y sont fréquentes. Il n’est pas rare de voir des adolescentes âgées de 14 à 19 ans déjà mères. Certaines ont jusqu’à trois enfants avant même d’atteindre 20 ans, souvent abandonnées par leurs partenaires. Le manque d’éducation, l’absence de structures d’encadrement et l’accès limité aux services sociaux exposent ces jeunes filles à une grande vulnérabilité. Entre déscolarisation, chômage, lourdes responsabilités familiales et absence de perspectives, leur quotidien reflète les dures réalités de plusieurs quartiers défavorisés de Kinshasa.
« Moi, j’étudie de temps en temps. Cette année, j’ai repris l’école, mais je ne compte pas continuer l’année prochaine. Nous sommes nombreux à la maison, et je n’aime pas trop l’école, ça me prend trop de temps. Je préfère sortir, faire l’ambiance. C’est plus rentable pour moi, parce que je rencontre des garçons qui me donnent de l’argent », confie une adolescente de 16 ans au Desk Femme de ACTUALITÉ.CD
Dès le matin, les ruelles de Pakadjuma s’animent. Devant les maisons en tôle, l’ambiance est rythmée par des danses comme le Mukombonso et la consommation d’alcool local, appelé Mokonzi. Pour certaines jeunes filles, ces pratiques servent d’échappatoire à la souffrance et à la détresse sociale.
La majorité des familles de ce quartier sont originaires de la province de l’Équateur. Les parents exercent principalement de petits métiers : pousse-pousseurs, chargeurs dans des usines privées ou encore vendeurs ambulants.
Sur l’avenue du Marain, une jeune femme de 22 ans, vendeuse, raconte comment elle a arrêté les études.
« Je me sens menacée à cause des mauvaises influences du quartier. Pour dire vrai, je n’ai pas de diplôme. J’ai arrêté l’école en 4e année des humanités parce que je me suis laissée entraîner par mes amies et par la vie d’ici. Aujourd’hui, j’ai une fille, j’ai 22 ans et je vis encore chez mes parents. Je regrette beaucoup, mais mes parents ont refusé de continuer à payer mes études. Maintenant, je vends du poisson pour survivre », explique-t-elle.
De son côté, Meda, une jeune femme vivant dans une église des environs, dénonce l’insécurité à tous les niveaux dans ce quartier.
« Ici, tu ne peux même pas utiliser ton téléphone tranquillement. Même des filles de 13 ans et plus traînent dans des coins pour menacer les gens et leur voler leurs téléphones, parfois même avec des policiers. Ils te disent : “Donne-moi ton téléphone”, et tu obéis par peur de recevoir une balle. Mais on est déjà habitués. Ce n’est plus un secret. Ici, le vrai problème, c’est l’éducation », souligne-t-elle.
Sans accès à l’éducation ni accompagnement adéquat, de nombreuses jeunes filles voient leurs rêves s’éteindre avant même d’avoir commencé à vivre. La déscolarisation expose directement ces jeunes filles aux grossesses précoces et à une dépendance économique accrue.
Déborah Misser Gbalanga, stagiaire