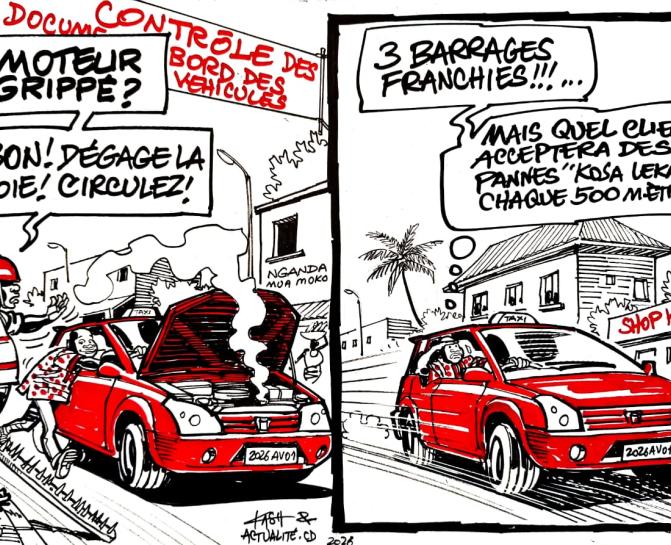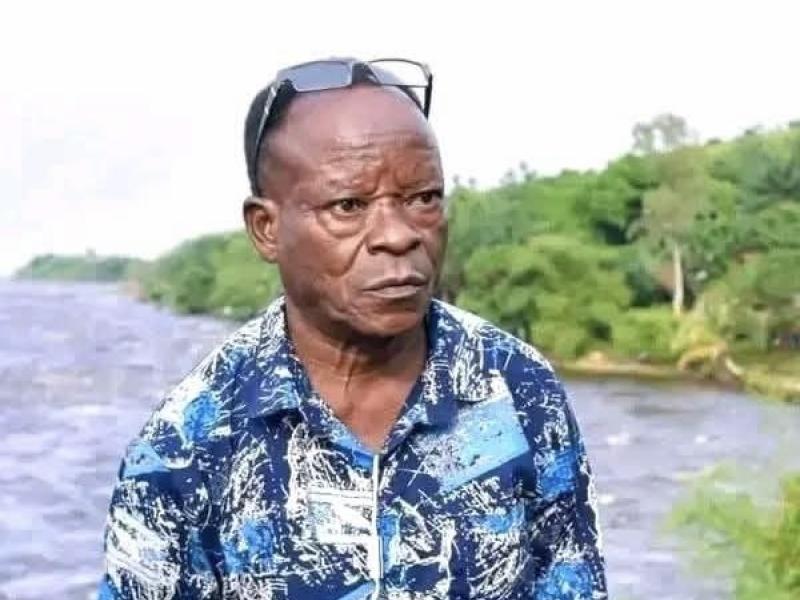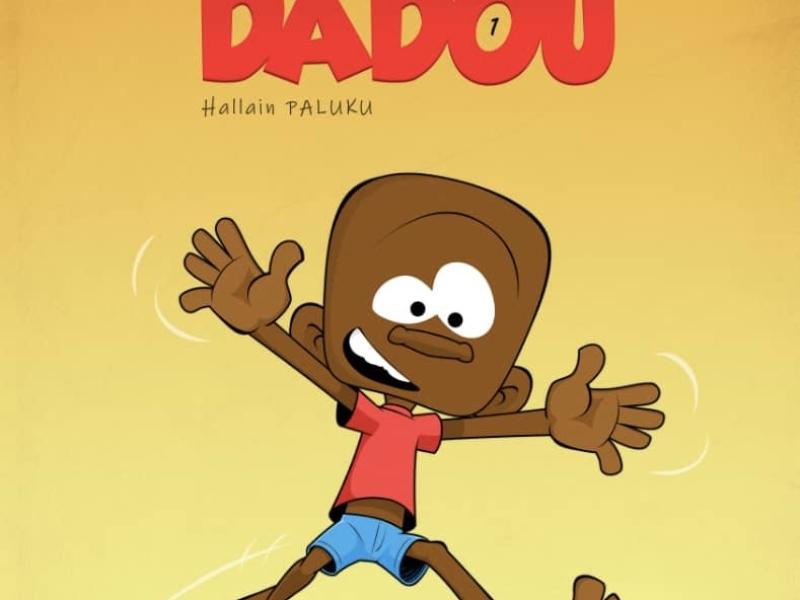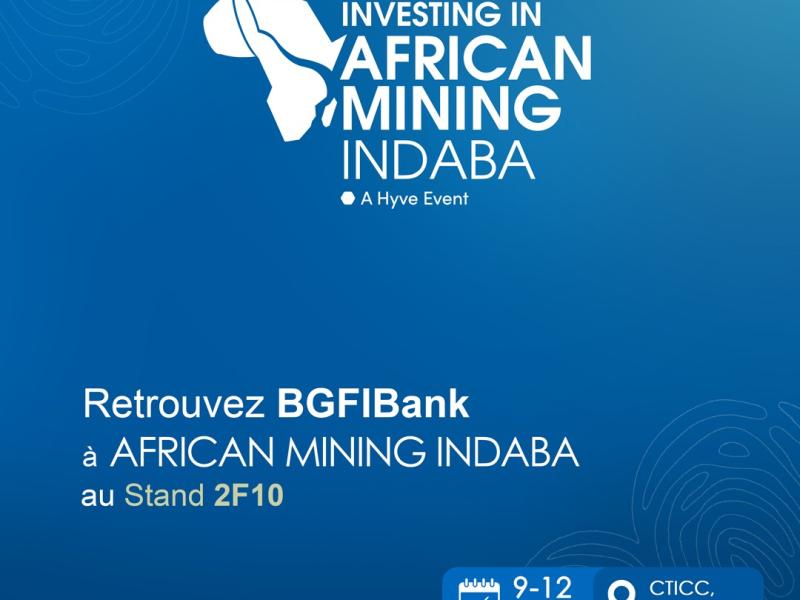La conservation et restauration des œuvres d’art est une nouvelle filière qui a été instaurée à l'académie des beaux-arts de Kinshasa. Les spécialistes issus de ce département sont dotés de compétences pointues en chimie, en physique, en histoire de l'art et en techniques artistiques, et sont capables d'identifier les matériaux constitutifs des œuvres, de comprendre les mécanismes de dégradation et de mettre en œuvre des traitements adaptés.
C’est un métier d’avenir, comme le confie à ACTUALITÉ.CD, la cheffe de ce département jeune et nouveau, Francine Mava. Dans cet entretien, elle évoque le fonctionnement de cette filière, les matières abordées, les opportunités et défis des conservateurs et restaurateurs dans la sphère artistique. Avec environ une centaine d’étudiants formés en près de 5 ans, elle estime que le métier a de l’avenir comparativement à certaines vieilles sciences qui n’intéressent pas les jeunes.
ACTUALITE.CD : C'est un département jeune à l'Académie des beaux-arts, c'était le juste moment pour l'instaurer ?
Francine Mava : Oui, ça en valait vraiment la peine parce que vous allez remarquer que nous, Congolais, nous avons un grand patrimoine. Ce n'est pas que la musique, c'est aussi le côté art plastique. L'art plastique, je vois tout ce qui est du côté des œuvres d'art palpables et tangibles. Alors, la naissance de ce département en valait vraiment la peine. Donc, c'est venu au bon moment, parce qu'ici, nous avons deux filières : la filière bois et la filière céramique. Vous le savez, dans les temps anciens, nos grands-parents nous ont laissé beaucoup plus d’œuvres en céramique et en bois. Donc, on a commencé, et puis dans les années qui viennent, on pourra aussi ajouter de la peinture, de la pierre, de la céramique émaillée, du fer et d'autres matériaux aussi.
Combien de conservateurs forme-t-on par année depuis l'instauration du département ?
Cela dépend aussi d'une année à une autre. Ça nous est arrivé de faire sortir pas nombreux. L'année passée, il n'y avait que deux étudiants, et puis, dès qu'ils ont fini, une autre année c'était 5 étudiants, puis une autre 6, et cette année, je crois que ce seront 8 étudiants qui vont sortir du département de conservation.
Est-ce qu'il y a une influence des étudiants ? Est-ce qu'ils aiment ce département ? Comment réagissent-ils face à ça ?
C'est un peu timide, pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle science. Quand les étudiants viennent, ils viennent pour autre chose : ils viennent soit pour la céramique, la sculpture, l’architecture. Mais parce qu'on fait le système de rotation des départements dans la première année de licence, c'est là qu'ils découvrent le département. Ils viennent, mais c'est un peu timide. Ce n'est pas comme dans d'autres départements où il y a beaucoup d'étudiants. Chez nous, c'est vraiment timide, et puis c'est minime.
Et vous souhaitez qu'il y ait plus d'étudiants ?
Oui et non, parce que c'est un métier qui est un peu noble. Vous avez vu nos laboratoires, ce n'est pas vaste. Si, à la limite, on a 20 étudiants, c'est déjà bon.
Et qu'est-ce qu'on apprend en gros dans cette filière de conservation et restauration des œuvres d'art ?
Du coup, on parle de l'ABC de la conservation et de la restauration. Donc, il n'y a pas que la partie restauration, mais il y a aussi la partie conservation. La partie conservation, pourquoi ? On doit préserver nos objets pour qu'ils ne soient pas endommagés et altérés. Si jamais les objets sont endommagés, là, du coup, on passe dans la partie restauration. Mais nous faisons de tout notre mieux pour que les objets ne soient pas endommagés. Donc, ils ont l'ABCD, ils maîtrisent toutes les techniques de la conservation et de la restauration.
En combien d'années devient-on restaurateur ?
Quand le département a commencé, il fallait avoir bac +1 ou bac +5, ça dépend. Il y avait la partie pré-licence. Avant, on faisait 3 ans. Maintenant, dans le nouveau système, c'est 4 ans pour être restaurateur et conservateur des œuvres d'art.
Un conservateur est-il un artiste à part entière ou encore un métier à côté des artistes ?
Un restaurateur n'est pas un artiste, mais je l'appellerais plutôt un médecin des œuvres d'art. Je le dis comme ça parce que tous les processus que les médecins utilisent, c'est ce que nous, conservateurs et restaurateurs, utilisons aussi. Donc, quand l'objet est là, un objet qui est endommagé, pour nous, c'est un objet qui est malade. On commence par faire des diagnostics, il doit y avoir une fiche de constat d'état, et au besoin, on propose aussi des traitements. Donc pour nous, je ne suis pas un(e) artiste, je suis scientifique, je suis médecin des œuvres d'art, je le dis comme ça.
Et les étudiants qui font la conservation et la restauration, quand ils terminent, comment entrent-ils dans le métier, dans la société ? Est-ce que vous les suivez ?
Bien sûr. C'est un métier libéral, mais nous, nous travaillons en partenariat avec notre grand Musée National du Congo, et nous avons quelques-uns de nos étudiants qui sont déjà embauchés là-bas, et ceux qui sont aussi dans d'autres organismes.
Et quels sont les principaux défis du conservateur des œuvres d'art en RDC ?
Les plus grands défis, je dirais, c'est une science qui n'est pas du tout connue. Alors, j’ai parlé de notre partenaire numéro 1, le Congo. Notre souci, parce qu'il y a des particuliers qui ont aussi des œuvres d'art qui sont endommagées, je trouve que c'est cher. Nous, nous ne sommes pas chers. Comme je le disais, nous sommes comme la médecine. Alors du coup, on a un grand souci d'objets. Nous ne sommes pas connus, comme je l’ai dit tout à l'heure. Dans l'autre temps, on aimerait aussi entrer chez les antiquaires. Il y a ceux qui ont des œuvres mais qui ne savent pas mettre ça à notre disposition. Et puis, il y a un souci de communication.
La conservation est-elle un métier d'avenir qui va attirer plus de jeunes dans le futur ?
Bien sûr que oui, parce qu'il y a des sciences qui sont vieilles. À l'heure actuelle, la conservation et la restauration, même sous d'autres cieux, font partie des sciences qui sont nouvelles. Alors je dis tout haut que ça va attirer les jeunes, parce que j'en ai l'expérience. Il y a ceux qui viennent pour s'inscrire chez nous, ici, au département de conservation.
Avez-vous un regard ou une critique par rapport à l'état des œuvres d'art ou de la conservation de ce qui se fait en termes de conservation pour les œuvres d'art en RDC ?
En RDC, le comble, nous avons beaucoup de musées. Dans les provinces, il n'y a pas beaucoup de restaurateurs. J’ai lu l'initiative de l'Institut des Musées Nationaux qui, en partenariat avec nos partenaires, avait envoyé des étudiants, personnellement des musées, qui sont venus étudier ici. Malheureusement, il y a ceux qui ont fini et dans l'autre temps... Nous avons au moins 26 provinces, et dans toutes ces provinces-là, je vous dis, il n'y a pas de conservateurs-restaurateurs formés.
Il y a ceux qui suivent les workshops, ils suivent des séminaires, mais n'ont pas de diplôme de conservation et restauration des œuvres d'art. Alors, j'invite tous ces membres-là et tous les musées-là à venir envoyer leur personnel. Il y a des formations comme ça, que le mouvement peut prendre en charge des jeunes pour la formation dans le département et pour pérenniser nos objets, nos œuvres d'art. Envoyez tout ce monde dans les provinces pour aller restaurer les œuvres d'art.
Ecouter cet entretien : Podcast : la conservation et restauration des œuvres d’art, un métier culturel d’avenir ?
Propos recueillis par Kuzamba Mbuangu